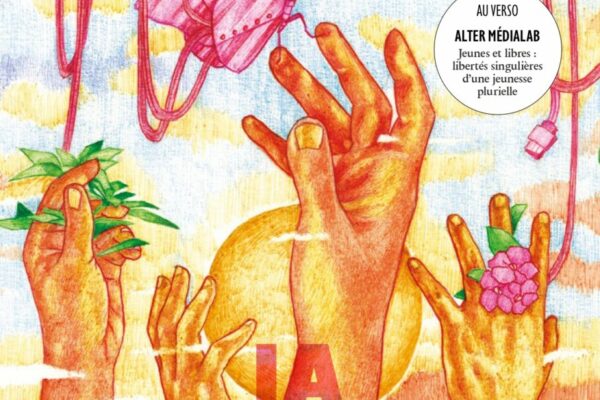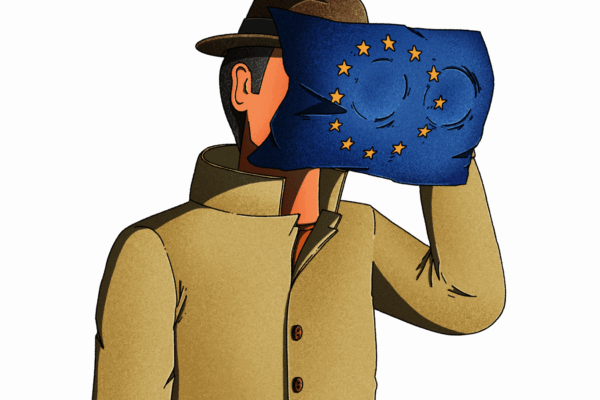Olivier Gilson coordonne les ateliers de design pour l’innovation sociale du Mad, le Centre bruxellois de la mode et du design, qui accueille de jeunes créateurs en résidence. Ce spécialiste du «design social» nous explique les contours d’une discipline peu connue du grand public, dont l’ambition est d’agir sur le réel.
Alter Échos: Qu’est-ce que le design social?
Olivier Gilson: Cela reste du design mais avec une approche plus participative et collaborative. Le design classique poursuit une finalité formelle. Il arrive en bout de course. Lorsque tout a été réfléchi au préalable, on demande au designer de proposer une belle forme, un bel objet. Avec le design social, chacun se met autour de la table, avec ses compétences propres pour déterminer, collectivement, un cahier des charges et construire quelque chose, ensemble. L’idée est de se mettre au service de l’intelligence collective… et d’améliorer la société. Nous sommes en contact avec les gens, nous travaillons avec eux, pour eux et nous voyons leur réaction.
AÉ: Le design social, c’est bien plus qu’une histoire d’objets…
OG: Au sein du Mad, on trouve de jeunes designers d’objets, mais aussi des graphistes, des architectes de l’espace, des designers de services. En gros, tout ce qui concerne la société nous intéresse. Le champ d’action est très large. Le design social est davantage une approche qu’un aboutissement formel. Le meilleur exemple de cette évolution, ce sont les designers de services, qui ne produisent rien de physique. Seulement du service. Ils proposent une réflexion. À partir de différentes pièces d’un puzzle, ils les assemblent pour que cela fonctionne.
«Nous ne prétendons pas apprendre aux associations ce qu’il faut faire.»
AÉ: Pourriez-vous être plus concret concernant le design de services?
OG: Nous travaillons sur la mobilité à Bruxelles. Nous recevons une petite subvention pour réfléchir à l’utilisation du vélo. Le thème, c’est de pouvoir permettre à des gens de quartiers défavorisés d’apprendre à rouler à vélo – ce qui n’est pas si évident que ça; dans certaines cultures, le vélo est mal accepté. Il faut donc d’abord leur apprendre à rouler, puis leur donner l’accès à un vélo, enlever les freins à son utilisation. Des services existent déjà, qui mènent des réflexions sur ces thèmes: il y a Pro Velo pour l’apprentissage. Il y a Cyclo, qui permet de louer ou d’acquérir des vélos à prix concurrentiels. Il faut faire fonctionner tout ça ensemble, trouver des réponses à de nombreux enjeux: apprendre à rouler, mais aussi obtenir un vélo, le sécuriser. Sera-t-il partagé? Y a-t-il de la place pour ranger un vélo chez les personnes concernées? Comment régler une série de petits soucis qui empêchent la personne de se lancer? Notre spécialiste en design de services réfléchit à cet ensemble de choses. Elle va interroger toutes les parties prenantes et penser une organisation, un prototypage de services qui sera mis à l’essai, puis modifié en fonction des remarques des associations et des utilisateurs. La démarche est très empirique. Le but est que ce service ait un impact sur les quartiers, en termes d’innovation sociale et sociétale.
Construire un projet commun
AÉ: D’accord, mais quelle est la différence entre le design de services et une simple coordination sociale mise en place par une association ordinaire?
OG: Nous sommes des facilitateurs. Nous facilitons avec des outils propres au «design thinking» – ce sont de grands mots, mais dans les faits nous mettons simplement les gens autour de la table pour construire un projet commun. Le problème pour une association classique, c’est que son rôle se cantonnera à la coordination sociale. À un moment donné, il faut une vue globale, plus créative et orientée vers le résultat. Le but du jeu, c’est d’arriver à un programme – comme dans le design industriel – qui puisse être reproductible. Les associations sont concentrées sur leurs problématiques. Nous, on vient de l’extérieur avec une vision beaucoup plus large.
AÉ: Reproduire des solutions qui fonctionnent, c’est au cœur de votre démarche?
OG: Tout à fait. Et, pour bien le comprendre, je vais vous donner un exemple. De grandes bâches avaient été utilisées lors des travaux de rénovation de la Grand-Place. Ces bâches étaient destinées à être jetées. Nous avons reçu un appel de l’échevinat qui les mettait à disposition, au cas où. Un designer, au Mad, était intéressé. Au même moment, une entreprise de travail adapté (ETA) – qui travaille avec des personnes handicapées – manifeste aussi un intérêt. La problématique de l’ETA est simple: ils ont de grosses commandes ponctuelles dans le cartonnage. Entre ces commandes, ils sont au chômage technique. Ils cherchent donc une activité pendant ces périodes creuses pour générer du revenu afin de payer correctement les personnes handicapées. Une réunion a eu lieu entre le Mad et l’ETA, un partenariat s’est noué. Le designer se dit qu’il faut faire quelque chose de ludique et sympa avec cette matière première – la bâche microperforée. Il imagine un sac sur lequel est cousue une plaquette en métal, avec un numéro qui correspond à une portion de l’une des maisons de la Grand-Place. À l’intérieur du sac, on trouve l’explicatif de ce projet social et écodurable. Ces objets ont été vendus au prix de 39 euros. En un jour et demi, tous les sacs sont partis. Cette ETA a ensuite été contactée par Bozar qui a aussi des bâches sur les bras. Et hop une nouvelle commande! Mais il faut aller encore un pas plus loin. Des bâches comme celles-là, il y en a de plus en plus, qui finiront à la poubelle; on va essayer de travailler avec les échevins pour que chaque demande soit automatiquement transférée à différentes ETA. Avec ce type de projets, le déchet n’est plus un déchet mais une matière première, le travail n’est plus une activité ponctuelle, mais un travail à part entière. Une activité économique nouvelle peut en naître.
AÉ: Dans quel contexte est né le design social?
OG: À un moment, le design était lié à l’industrie. Mais le design industriel, en Belgique, n’est plus vraiment florissant. Comment, dans ce contexte, reprend-on sa place? Comment réinventer son métier, avec de nouvelles technologies, de nouvelles dynamiques? Notre métier, à l’origine, était de trouver des solutions industrielles pour produire massivement des objets à des prix abordables pour les gens. En parallèle, il y a eu l’évolution commerciale, économique et marketing du design qui l’a tiré vers une production de luxe, chère, dont Stark était le modèle. Le design social propose de revenir à la base de notre métier, qui est de travailler pour la société, en lien avec elle. L’un des premiers à lancer la réflexion a été Victor Papanek. Il fut le premier à faire de «l’anti-design». Pour lui, le design ce n’est pas la forme, c’est le contenu. «On s’en fout de l’esthétique», c’est son message. Il est à l’origine d’interrogations très contemporaines: à l’heure où le design devient de plus en plus beau, formel et même anti-pratique, quel est le rôle du designer? Sommes-nous des artistes ou des gens qui travaillent le produit?
«Nous nous installons dans des quartiers difficiles, dans les endroits où ça se passe.»
AÉ: La différence avec le design classique se situe-t-elle dans la finalité du travail?
OG: Pas seulement. La finalité n’est pas la même, mais l’approche non plus. Quand quelqu’un veut ouvrir un nouveau restaurant et a besoin d’un architecte d’intérieur, cela ne nous intéresse pas. Cela nous intéresse si c’est un restaurant social. En cela, la finalité du travail est importante. Mais l’approche l’est aussi. Un architecte d’intérieur classique va penser clientèle, esthétique. Nous allons penser fonction et objectifs à atteindre. Si, à un moment donné, il faut que ça soit moche pour que ça fonctionne, et bien ça sera moche. Nous ne sommes pas là pour faire du beau, mais pour faire du juste. Pour faire du contenu et pas de la forme.
Le design social est un outil
AÉ: Vous vous situez donc clairement dans le champ d’action sociale, en nouant des partenariats avec le monde associatif. Mais le tissu associatif belge n’est-il pas méfiant, de prime abord, lorsqu’on lui parle de «design»?
OG: Oui, il y a de la méfiance. Mais nous nous installons dans des quartiers difficiles, dans les endroits où ça se passe. Nous montrons les projets que l’on a réalisés et nous proposons des outils. Nous sommes un outil. Nous ne prétendons pas apprendre aux associations ce qu’il faut faire. Nous proposons simplement de travailler ensemble.
AÉ: Vous travaillez par exemple sur des projets d’aménagement, dans des quartiers difficiles…
OG: Récemment, une association du quartier Anneessens voulait installer du mobilier urbain et des bacs potagers. Elle constatait qu’à chaque tentative le matériel était détruit en 15 jours. Nous avons fait le tour du quartier, rencontré les associations, les habitants et les jeunes qui ressentent une certaine frustration. Nous nous sommes demandé comment faire pour qu’ils reprennent la main sur leurs projets, sur leur environnement. C’est de là qu’est née l’idée de proposer un jeu assez simple autour de cet aménagement. C’est un jeu de construction basique, qui ne demande aucune compétence et qui permet à chacun de proposer quelque chose. Si tu mets les gens autour de la table en discutant «mobilier urbain», ils ne savent pas ce que c’est, ou ils n’ont pas envie de savoir. Si on leur explique, ils ont l’impression qu’on les dévalorise. Là, l’animateur a en main un outil accessible en posant une question: de quoi avez-vous besoin? Une fois que la composition, à partir du jeu, est terminée, la commande est passée au producteur qui livre la chose en pièces détachées. On pourrait imaginer un service qui s’occuperait de monter ce mobilier urbain. Une association qui donnerait de l’emploi à des personnes qui en ont besoin.
«Nous essayons d’intégrer au maximum l’open source, car cela fait partie intégrante de la logique participative.»
AÉ: Ces associations avec qui vous travaillez ne doivent pas avoir les moyens de se payer les services de designers…
OG: Tout d’abord, nous sommes un service public, financé par la Ville de Bruxelles, la Région et l’Union européenne. Ensuite, nous distinguons le type de commandes. Certains projets sont rémunérateurs. Vivacqua nous a par exemple contactés pour créer des fontaines mobiles devant permettre un accès à l’eau potable lors d’événements publics. D’un autre côté, lorsque nous travaillons avec des associations qui n’ont pas beaucoup de moyens, c’est le Mad qui paye le designer (et l’association paye généralement le matériau). On peut aussi travailler à la rédaction de cahiers de charges, avec images 3D, qui vont permettre aux associations d’aller chercher des budgets.
AÉ: Travaillez-vous en «open source» avec des logiciels libres?
OG: Nous essayons d’intégrer au maximum l’open source, car cela fait partie intégrante de la logique participative. Si une idée est bonne, elle peut être récupérée par quelqu’un d’autre qui pourra peut-être l’améliorer. Mais nous nous retrouvons dans un dilemme: comment le designer va-t-il se rémunérer? Car le design est lié à un droit d’auteur. Et ce droit d’auteur a tendance à disparaître dans ce cadre. Il faut donc réinventer la façon de rémunérer. Chez nous, le designer est payé à la mission.
En savoir plus
«Le mobilier urbain, objet de cohésion ou de dissuasion», Alter Échos n° 450, Marinette Mormont et Manon Legrand, 12 septembre 2017
«Les fab labs de la discorde», Alter Échos n° 450, Julien Winkel, 12 septembre 2017
«D4E1, le design au service des personnes handicapées», Alter Échos n° 450, Aubry Touriel, 12 septembre 2017
«Le beau banc du Vautour», Alter Échos n° 450, 24 août 2017, Cédric Vallet