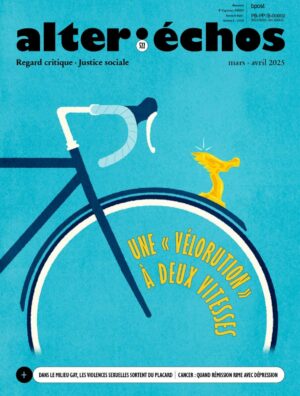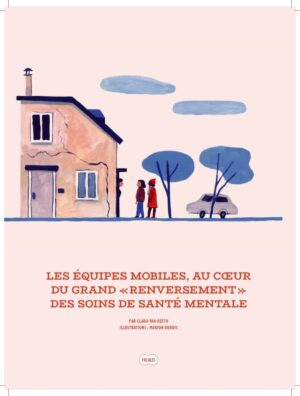Dans la vie d’une enfant comme Nina, tout est affaire de rencontres. Les rencontres manquées, comme celle de ce mercredi après-midi avec son papa, annulée par lui en dernière minute. Et les rencontres qui sauvent. Comme celle de Charlotte, qui a ouvert les portes de sa maison à la petite fille de presque 2 ans en décembre dernier.
Comme 7.000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Nina[1] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de sa famille. Quand alcoolisme, toxicomanie, violences, incarcération, troubles psychiatriques ou encore handicap mental nuisent au bien-être et à la sécurité d’un enfant, le mandant – service de l’aide à la jeunesse, service de protection de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse – peut décider de son placement en institution (c’est le cas pour environ 3.000 mineurs) ou en famille d’accueil (environ 4.000 mineurs). Il peut alors s’agir soit d’un membre de la famille (on parle alors de «placement intrafamilial»), soit d’un proche – comme un voisin, une prof ou un éducateur («placement dans le réseau élargi»), soit encore d’une famille dite «sélectionnée». Une famille qui ne connaissait pas l’enfant au préalable, sélectionnée par un service d’accompagnement en accueil familial (SAAF) agréé et subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, après examen de sa candidature, entretiens et visites à domicile, formation et signature d’une convention.
Ces familles sont à comprendre dans leur sens le plus large: couples hétéros ou homoparentaux, avec ou sans enfants, familles recomposées, mais aussi personnes seules, en grande majorité des femmes. Parmi elles, Charlotte, 43 ans, maman séparée de deux adolescents. Cette Liégeoise a décidé de se rendre disponible pour des accueils de bébés, d’urgence et de court terme. Sans emploi, habitée par l’envie de «faire quelque chose qui a du sens», Charlotte envisage son rôle d’accueillante presque comme un métier. Entre chaque «mission», elle s’accorde un temps de repos «pour décompresser». «Le fait de savoir qu’il y a une fin, ça change tout. Je ne me réjouis pas de les voir partir, mais le temps qu’ils sont chez moi, je leur donne tout, sans compter.»
Quand alcoolisme, toxicomanie, violences, incarcération, troubles psychiatriques ou encore handicap mental nuisent au bien-être et à la sécurité d’un enfant, le mandant – service de l’aide à la jeunesse, service de protection de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse – peut décider de son placement en institution (c’est le cas pour environ 3.000 mineurs) ou en famille d’accueil (environ 4.000 mineurs).
Un don de soi total et inconditionnel dont a bénéficié Nolan pendant près d’un an, avant Nina. Retiré à ses parents six jours seulement après sa naissance, le petit garçon est arrivé chez Charlotte à l’âge de 2 mois. Au fil des semaines, elle décèle chez lui les premiers signes d’un lourd handicap. Une relation fusionnelle se tisse avec le bébé, qui n’accepte de fermer l’œil qu’une fois allongé sur la poitrine de sa maman d’accueil. Des photos de lui tapissent encore la cage d’escalier. «Quand il est parti, j’ai pleuré un bon coup. Puis j’ai rangé la maison et je me suis reposée trois mois. Et puis c’était reparti.»
Pénurie et dérives
Ce type d’enfants au profil «lourd» pourrait bientôt être pris en charge par des familles d’accueil professionnelles. C’est en tout cas le souhait de la ministre de l’Aide à la jeunesse, Françoise Bertieaux (MR), qui s’inspire des Pays-Bas, de la France et de la Flandre. Un groupe de travail regroupant les acteurs du secteur a récemment été mis sur pied par le gouvernement, qui transmettra ses conclusions à la ou au successeur de la ministre.
L’objectif en ligne de mire: répondre à la pénurie de familles d’accueil. Selon la Fédération des services d’accompagnement en accueil familial (FSAAF), il manque 600 places en Belgique francophone. Conséquence: les accueils d’urgence, normalement limités à 45 jours au maximum, tendent à durer de plus en plus longtemps «faute de solutions pérennes en familles d’accueil à long terme ou en institution»[2]. Du côté de l’accueil à long terme, neuf demandes sur dix (!) sont refusées par les services, dans la quasi-totalité des cas pour cause d’absence de famille d’accueil disponible.
Certaines dérives sont plus problématiques encore. Les «bébés parqués» par exemple, ces enfants en bonne santé, mais contraints d’être hébergés à l’hôpital, faute de place dans les services concernés. Ou encore ces familles d’accueil «amies du SAJ», qui se portent, de manière informelle, volontaires pour l’accueil de beaucoup d’enfants et vers lesquelles le Service d’aide à la jeunesse (SAJ), sous pression, se tourne parfois faute de mieux. C’est d’une «famille» de ce type que provenait le petit Nolan, après que sa fermeture a été ordonnée par le SAJ et les six enfants qui y étaient hébergés, replacés en urgence. «Il n’avait aucune affaire, juste un pyjama et son doudou, qu’on m’a tendu du bout des doigts en me disant de le laver à 60 degrés, se souvient Charlotte. Les conditions d’hygiène étaient apparemment sordides.»
Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain: en dépit de ces rares cas de négligence, le placement en famille reste généralement la meilleure solution pour ces enfants aux parcours cabossés. Guy De Backer, président de la FSAAF, observe d’ailleurs depuis quelques années que «les enfants sont placés de plus en plus jeunes. Il y a cette notion des mille premiers jours, qui incite à prendre soin des enfants dès le début. Et les mandants vivent moins dans l’illusion que les parents biologiques vont forcément évoluer positivement et seront capables de prendre soin de leur enfant». En Belgique francophone, environ 80% des placements en famille d’accueil ont lieu avant l’âge de 5 ans et 28% des placements sont décidés au cours de la première année de l’enfant.
Certaines dérives sont plus problématiques encore. Les «bébés parqués» par exemple, ces enfants en bonne santé, mais contraints d’être hébergés à l’hôpital, faute de place dans les services concernés. Ou encore ces familles d’accueil «amies du SAJ», qui se portent, de manière informelle, volontaires pour l’accueil de beaucoup d’enfants et vers lesquelles le Service d’aide à la jeunesse (SAJ), sous pression, se tourne parfois faute de mieux.
C’était le cas de Robin, nouveau-né de 2 mois et «2 kilos à tout casser». Il est arrivé un soir d’octobre dans le foyer de Marie-Noëlle et de son époux prévenus le matin même par leur service d’accompagnement, après avoir été retiré d’une «situation familiale complexe» – un papa incarcéré et une maman en situation de «très grande précarité, avec difficultés à s’occuper d’un bébé».
Une configuration que les parents d’accueil, tous deux médecins généralistes au sein d’une maison médicale dans la commune précarisée de Dison, du côté de Verviers, ne connaissent que trop bien: «On était régulièrement en contact avec des enfants défavorisés. Combien de fois je n’ai pas voulu revenir à la maison avec certains enfants que je voyais dans mon cabinet. Des enfants de personnes isolées, sans ressources, qui finissaient en institution quand la situation dérapait», raconte Marie-Noëlle.
Déjà parents adoptifs d’un petit garçon mozambicain et d’un fils biologique, ils décident donc en 2010 de devenir famille d’accueil (urgence et court terme) pour bébés. Après l’arrivée de Robin, la famille s’agrandira encore avec trois filles, suivant la même configuration: une adoptée, une biologique, une accueillie.
Zéro réintégration
Ce mercredi midi, à peine rentré de l’école, Robin vient se blottir dans le fauteuil aux côtés de Marie-Noëlle, la tête sur ses genoux, la main dans sa main. Le bébé a bien grandi. Il est aujourd’hui à cet âge de transition ingrat à cheval entre l’enfance et l’adolescence, voix qui mue et appareil dentaire. Ce qui ne devait être qu’un accueil de court terme est devenu un lien familial qui dure depuis quatorze ans.
Chaque année, Robin passe devant le juge de la jeunesse qui décide de renouveler ou non la mesure de protection dont il fait l’objet. «Au début c’était un gros stress, confie celle qu’il appelle ‘maman’. Mais aujourd’hui on sait qu’il y a très peu de chances qu’il retourne dans sa famille biologique. Il faudrait d’abord que les rencontres mensuelles avec sa maman aient lieu comme prévu, qu’elles se passent bien… Après quoi, leur fréquence augmenterait progressivement. On verrait la chose venir.»
Qu’en est-il des réintégrations des enfants placés? Autrefois «sujet tabou», la FSAAF n’hésite plus, aujourd’hui, à communiquer ouvertement: «En 2023, il y a eu zéro retour en famille pour les accueils de moyen et long terme en familles sélectionnées. Idem en 2022, en 2021, en 2020…» En fait, depuis quatre ans, aucun enfant sur plus de mille n’a réintégré sa famille d’origine. «La réintégration se fait sur décision des mandants: s’il n’y en a pas, c’est donc qu’il n’y a pas eu de demande de réintégration ou que la réintégration envisagée a échoué», poursuit Guy De Backer. Forte de ce constat, la FSAAF a remis, le 9 avril dernier, un avis favorable à un avant-projet de décret de la FWB qui propose d’allonger la durée des mesures de protection afin d’offrir plus de stabilité aux enfants.
En Belgique francophone, environ 80% des placements en famille d’accueil ont lieu avant l’âge de 5 ans et 28% des placements sont décidés au cours de la première année de l’enfant.
Après avoir avalé trois œufs en chocolat, Robin attrape un petit album photos dont il fait défiler les pages. Sur un des clichés, quatre enfants agglutinés dans un fauteuil, dont un bébé sourire aux lèvres. «Ça, c’est le jour de son départ, je m’en souviendrai toute ma vie», glisse Marie-Noëlle. En 2011, au terme de la durée maximale de l’accueil à court terme (neuf mois), le juge estime, dans l’intérêt de Robin, que celui-ci ne doit pas retourner dans sa famille. Aucune famille d’accueil long terme n’étant disponible, Marie-Noëlle et son conjoint décident alors de changer de plan et se portent volontaires pour accueillir le petit garçon autant de temps qu’il le faudra. Mais la procédure est longue et le temps administratif n’est pas en phase avec celui d’un bébé. Il faudra attendre neuf autres mois durant lesquels Robin est placé dans une pouponnière, une institution spécialisée dans l’accueil d’enfants de 0 à 6 ans. «C’était très difficile. Dès le début, on s’était préparés à ce qu’il reparte, mais c’était censé être pour un mieux: soit dans sa famille, soit dans une autre famille d’accueil à long terme. Là, il allait dans un orphelinat, et on savait qu’il le vivait très mal.»
Face à la pénurie de familles d’accueil, de nombreux (jeunes) enfants sont placés en institution. Parfois pour des années, parfois jusqu’à leur majorité. Dans une étude consacrée à l’accueil familial, la chercheuse Stéphanie Charretier (ULiège) note que «la Belgique fait partie du peloton de tête des pays d’Europe occidentale qui se caractérisent par le nombre le plus important d’enfants en bas âge placés en institution. La proportion d’enfants placés en institution en Fédération Wallonie-Bruxelles reste très importante (45%) et, contrairement à nos pays voisins d’Europe occidentale, la moitié de ces enfants ont moins de 5 ans»[3].
«La Belgique est régulièrement pointée du doigt pour mettre trop d’enfants en institution, pointe Guy De Backer. La Convention internationale des droits de l’Enfant le dit: les enfants doivent évoluer en famille, ils ont besoin de construire un lien de l’attachement stable. On commence enfin à s’inspirer d’autres régions, comme le Québec, qui est très avancé dans la voie de la désinstitutionnalisation.» L’atout des familles d’accueil est également financier. La FSAAF estime que le coût du placement d’un enfant en institution résidentielle oscille entre 50.000 et 60.000 euros par an, contre 8.000 à 12.000 euros annuels en moyenne pour un placement en famille d’accueil à long terme. Soit environ cinq fois moins.
Vocation ou mission?
La proposition de professionnalisation de la ministre de l’Aide à la jeunesse va dans ce sens: renforcer l’attrait et donc le nombre de familles d’accueil pour freiner les placements en institution. «Il est essentiel de repenser en partie le modèle de l’enfance en danger et en difficulté. Recourir davantage aux familles d’accueil et apporter davantage de flexibilité dans une série de domaines me semblent être de bon sens», a déclaré Françoise Bertieaux dans un communiqué.
Le débat a le mérite d’être ouvert. Mais les questions qu’un tel statut soulève sont nombreuses. Marie-Noëlle a récemment participé à un échange par visioconférence avec des familles d’accueil professionnelles françaises, à l’initiative de son SAAF verviétois. «Elles étaient fort interpellées par la grande attention qui est apportée chez nous à l’apparentement, soit au fait de réfléchir à la meilleure configuration possible, pour un accueil optimal de l’enfant: tenir compte de son âge, de ses besoins, de l’âge des autres enfants de la fratrie, des souhaits émis par la famille d’accueil… En France, comme ce sont des professionnels, il y a un peu plus cette logique de dire ‘il y a un enfant, peu importe son profil, c’est votre job de pouvoir l’accueillir’.»
L’atout des familles d’accueil est également financier. La FSAAF estime que le coût du placement d’un enfant en institution résidentielle oscille entre 50.000 et 60.000 euros par an, contre 8.000 à 12.000 euros annuels en moyenne pour un placement en famille d’accueil à long terme. Soit environ cinq fois moins.
Outre la rémunération qu’impliquerait un statut professionnel (actuellement, les familles d’accueil belges francophones sont bénévoles et «indemnisées» entre 400 et 450 euros par mois, par enfant), se poserait aussi la question des vacances. En tant que professionnels, les parents d’accueil français ont droit à quatre semaines de congés, sans leur(s) enfant(s). Une réalité qui peut être difficile à vivre, et à comprendre, par ces derniers. «C’est vrai que ce principe nous a un peu choqués, même si les familles qu’on a rencontrées nous ont dit qu’elles partaient quand même le plus souvent avec leur enfant en vacances.» Cet été, la famille de Marie-Noëlle sera au grand complet; direction la montagne, tous à bord du Combi neuf places – sans oublier le «septième enfant», Sparletta le chien. Une famille patchwork, qui donne corps à cette conviction de Guy De Backer: «Il n’y a pas que les liens du sang qui font famille.»
[1] Tous les prénoms d’enfants cités dans cet article ont été modifiés.
[2] Rapport d’activité FSAAF 2022.
[3] S. Chartier, «Comment améliorer les relations entre les parents et leur enfant placé?», ULiège, 2022.