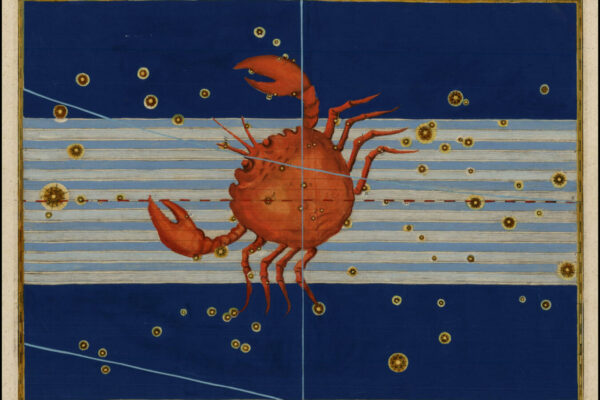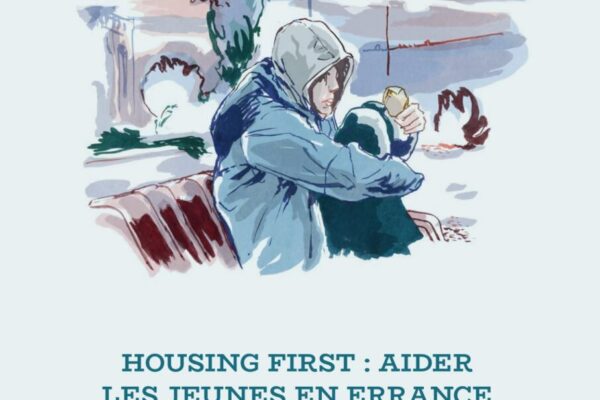Le nombre de séjours dans les services pédopsychiatriques augmente chaque année. Selon les données publiées par le SPF Santé publique en mars dernier dans le rapport «Données phares: soins en santé mentale», il est passé de 5.318 en 2005 à 7.197 en 2018, soit une augmentation de 35%.
Pourtant, depuis 2015, la «nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents» vise à renforcer les soins ambulatoires pour diminuer le recours aux hospitalisations (relire notre article «Réforme en santé mentale: le péril jeune», Alter Échos n° 435-436, décembre 2016). Cette réforme a permis de créer 11 réseaux, un par province, pour coordonner le travail des membres de la société civile et celui des soignants. Elle a aussi mis en place des équipes mobiles pour prendre en charge les jeunes dans leur environnement plutôt qu’à l’hôpital.
En théorie, une hospitalisation en psychiatrie n’est nécessaire que lorsqu’il faut commencer ou ajuster un traitement médicamenteux sous surveillance médicale ou quand le patient représente un danger pour lui-même ou pour son entourage, indique Murielle Makuch, coordinatrice adjointe de la réforme. Mais en pratique, «il y a plein d’autres raisons, surtout quand la famille n’a pas eu le sentiment d’être entendue et ne sait plus quoi faire».
Les équipes mobiles vont «à la rencontre des jeunes et de leur famille qui ont du mal à accéder aux soins de première ligne». Jean Philippe Mathy, coordinateur des équipes mobiles du Brabant wallon
De nouvelles ressources pour davantage de soins
Quand ils se sentent démunis, les proches peuvent avoir tendance à se tourner vers les urgences. Mais ce n’est pas toujours adapté. Pour améliorer les prises en charge, la réforme a donc voulu séparer les soins urgents, lorsque le pronostic vital est engagé, et les soins «de crise». Des lits spécifiques, les «lits K de crise», ont été créés. Mouna Al Husni Al Keilani, cheffe de clinique adjointe du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF) à Bruxelles, distingue plusieurs cas pour lesquels ils sont nécessaires: «Ce sont souvent soit des jeunes qui en arrivent à faire une tentative de suicide, où le facteur de stress est identifiable et on se dit donc que la prise en charge de crise sera suffisante, soit ce sont des jeunes avec des relations familiales compliquées et là on accueille pour apaiser les choses.» Ces nouveaux lits accueillent des jeunes dans les 72 heures pour une durée maximale de cinq jours. Ils leur permettent de faire «une pause avec l’environnement familial, avec l’école», ajoute la soignante. Ces lits de crise ont donc permis de gérer des situations qui n’étaient pas prises en charge auparavant, ce qui explique en partie l’augmentation des hospitalisations depuis 2015.
On peut faire le même constat avec les équipes mobiles: créées dans le cadre de la réforme, elles regroupent des professionnels de différents secteurs (psychiatres, éducateurs, assistants sociaux, etc.). Elles sont réparties dans chaque réseau en deux groupes: l’un pour les soins de «crise» et l’autre pour les soins de «longue durée». Elles atteignent une population qui n’a pas facilement accès aux soins en santé mentale. Ce sont souvent des partenaires du réseau qui les contactent. Parfois le jeune est déjà suivi par un médecin, mais celui-ci fait appel aux équipes mobiles pour avoir un autre point de vue et explorer la situation à domicile, explique Katalijne van Diest, coordinatrice du réseau MATILDA, dans la province de Luxembourg. Mais Murielle Makuch observe aussi que de plus en plus de parents font eux-mêmes les démarches, par exemple grâce à des permanences téléphoniques.
Un pédopsychiatre est présent dans chaque équipe mobile. C’est lui qui décide d’hospitaliser ou non le jeune. Si la vie de ce dernier et celle de son entourage ne sont pas en danger et qu’il n’y a pas de risques de violences, il privilégiera les soins ambulatoires, indique Rédouane Boukhari, coordinateur des équipes mobiles de Bruxelles. Ces soins sont eux aussi indiqués pour des cas de «crise» ou de «longue durée», ce qui a poussé les réseaux à développer deux équipes mobiles chacun. Ces équipes vont «à la rencontre des jeunes et de leur famille qui ont du mal à accéder aux soins de première ligne parce qu’elles ont du mal à identifier leurs besoins d’aide ou à faire des démarches», explique Jean-Philippe Mathy, coordinateur des équipes mobiles du Brabant wallon. Il ajoute que cela permet de compenser les problèmes de mobilité dans les régions où les soins sont moins accessibles pour cause de «fragilités institutionnelles».
Quand on lui demande comment les situations qui arrivent maintenant jusqu’aux équipes mobiles ou aux lits de crise étaient gérées avant la réforme, la Dre Al Husni Al Keilani répond avec un rire gêné: «Je pense qu’on bricolait…» Car les moyens n’étaient pas suffisants.
La santé mentale des jeunes se dégrade
Mais l’augmentation des hospitalisations n’est pas uniquement due à une meilleure communication autour des soins. Les professionnels qui travaillent avec des enfants observent une détérioration de leur santé mentale. L’épidémie de Covid-19 n’a pas arrangé les choses: «On a plus de jeunes avec des troubles anxieux, qui font des tentatives de suicide ou qui viennent avec un épisode dépressif», indique la cheffe de clinique adjointe (Lire à ce sujet: «Coulez jeunesse», Alter Échos n° 490, janvier 2021). Elle voit aussi une augmentation des troubles des conduites alimentaires, comme l’anorexie, et de plus en plus de jeunes qui n’arrivent plus à aller à l’école. Mais la pandémie a accentué des problèmes qui existaient déjà. Dans un rapport publié en juillet dernier, le Conseil supérieur de la santé indique que «les vulnérabilités existantes au sein d’une famille ont été exacerbées, avec des conséquences tangibles. Cette crise sanitaire n’a fait qu’intensifier les inégalités sociales et d’apprentissage».
Les jeunes sont déjà très touchés par les problèmes de santé mentale, souvent des «troubles émotionnels», comme la dépression et l’anxiété, car leur environnement peut grandement affecter leur état psychologique. Dans une enquête publiée en 2018, Sciensano repérait aussi quatre autres types de problèmes: les troubles des conduites (crises de colère, tricherie…), le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, les troubles relationnels (agressivité, isolement…) et les comportements prosociaux (ne pas être attentif aux autres, ne pas partager…). Selon le centre de recherche, 48% des enfants présentaient au moins une de ces difficultés.
Emmanuel De Becker, pédopsychiatre aux Cliniques universitaires Saint-Luc, s’inquiète de l’évolution des problèmes pris en charge: «On voit une augmentation des troubles anxieux, des décompensations, des tentatives de suicide. Ici, dans un hôpital général de Bruxelles, on a quand même une augmentation sérieuse aux urgences et des soins intensifs après des tentatives de suicide: chutes d’un étage à l’école, prises de médicaments…» Selon lui, l’utilisation des réseaux sociaux est en partie responsable, car l’image qu’on renvoie y prend une place importante: «On est très vite évalué, très vite jugé pour ce qu’on vit, ce qu’on mange, ce qu’on est, pour l’image qu’on donne.» Et chez les jeunes, cela conduit souvent à du harcèlement en ligne, voire en dehors, particulièrement chez les adolescentes. Les hospitalisations en pédopsychiatrie ont d’ailleurs bien plus augmenté chez les filles que chez les garçons: +56% entre 2005 et 2018, contre +17%. Depuis 2015, elles sont davantage hospitalisées, alors que les garçons étaient toujours majoritaires les années précédentes.
«On voit une augmentation des troubles anxieux, des décompensations, des tentatives de suicide.» Emmanuel De Becker, pédopsychiatre
Si certains troubles semblent donc s’aggraver, d’autres sont plutôt mieux détectés, par exemple les troubles du spectre autistique chez les filles. Le docteur De Becker explique que les symptômes peuvent être moins visibles ou plus tardifs chez elles, ce qui complique les diagnostics. Mais, ces dernières années, les parents et les professionnels ont été sensibilisés à ces différences, ce qui a permis de mieux détecter ces troubles.
Depuis la réforme, les enfants de 0 à 3 ans sont également davantage surveillés pour favoriser les diagnostics précoces. À Namur, une unité psychiatrique réservée aux mamans et à leurs bébés a par exemple été mise en place. Un an avant la réforme, l’HUDERF était le premier hôpital belge à créer une telle unité. «C’est le plus précoce qu’on peut faire. C’est pour détecter rapidement les troubles relationnels précoces parent-enfant ou les difficultés de certains bébés ou de certains parents», explique la Dre Al Husni Al Keilani. Cette évolution peut donc expliquer pourquoi les hospitalisations des 0-3 ans ont plus que doublé depuis 2015: avant la réforme, on en comptait environ 50 par an, alors qu’il y en a eu 120 en 2018.
Un nombre de lits toujours insuffisant
Mais même si la réforme a permis de prendre plus de problèmes en charge, tous ses objectifs ne sont pas atteints. Si le nombre d’hospitalisations est important, la demande l’est encore plus, mais les places manquent. Et elles ne sont pas équitablement réparties dans chaque province, surtout en Wallonie. Dans la province de Luxembourg, on ne compte qu’un seul hôpital psychiatrique qui peut accueillir des enfants. La coordinatrice du réseau MATILDA explique qu’il n’y a pas assez de lits ni assez de personnel, et que des jeunes sont donc hospitalisés ailleurs. Ils sont alors éloignés de leur famille et cela rend les soins plus difficiles. Murielle Makuch explique aussi que le manque de places pousse à faire sortir des personnes qui auraient encore besoin de soins. Or, cela aggrave le problème. Les jeunes qui n’ont pas l’accompagnement adéquat à cause de l’éloignement et ceux qui sortent trop vite risquent d’être à nouveau hospitalisés, car ils n’auront pas été assez bien soignés. Et ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’une hospitalisation alors qu’elle serait nécessaire risquent de voir leur santé mentale se dégrader et donc de finir par avoir besoin d’une hospitalisation plus longue que s’ils avaient été pris en charge. À Bruxelles, Rédouane Boukhari se désole face à ce manque de moyens: «La santé, c’est des ressources limitées pour des besoins illimités. Et la Belgique est souvent le dernier élève de l’Europe en termes de santé mentale.» Il cite alors l’exemple de la France, des Pays-Bas et de l’Angleterre où les équipes mobiles ont été créées il y a plus de 10 ans.
«La santé, c’est des ressources limitées pour des besoins illimités. Et la Belgique est souvent le dernier élève de l’Europe en terme santé mentale.» Rédouane Boukhari, coordinateur des équipes mobiles de Bruxelles
Enfin, même si la réforme a permis de mettre en réseau différents partenaires du monde médical, elle n’a pas encore réussi à suffisamment mobiliser les membres de la société civile. M. Boukhari comprend qu’il puisse y avoir une certaine méfiance, puisque le projet est encore jeune, mais c’est pourtant ce qu’il manque le plus selon lui. Car si tous les professionnels qui travaillent avec des enfants et des adolescents (professeurs, éducateurs, Aide à la jeunesse…) étaient davantage sensibilisés aux problèmes de santé mentale, les jeunes pourraient être mieux accompagnés et le recours aux hospitalisations diminuerait.
Les membres des réseaux vont donc travailler pour mieux collaborer avec la société civile, mais aussi pour aider les jeunes à s’impliquer dans leur suivi. Dans la province de Luxembourg, «on va mettre en place un conseil des jeunes pour qu’ils puissent prendre la parole sur la santé mentale à l’école, dans les clubs de sport, etc.», explique Katalijne van Diest. Les soins vont aussi être rendus plus accessibles. Depuis le mois de septembre, plusieurs séances de soins psychologiques peuvent être en partie remboursées, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et Rédouane Boukhari rappelle que les interventions des équipes mobiles sont gratuites: «Notre objectif, c’est l’accès aux soins pour tous!»
En savoir plus
«Les soins de santé mentale sortent-ils vraiment de l’hôpital?», Alter Échos n° 395, janvier 2015, Marinette Mormont.