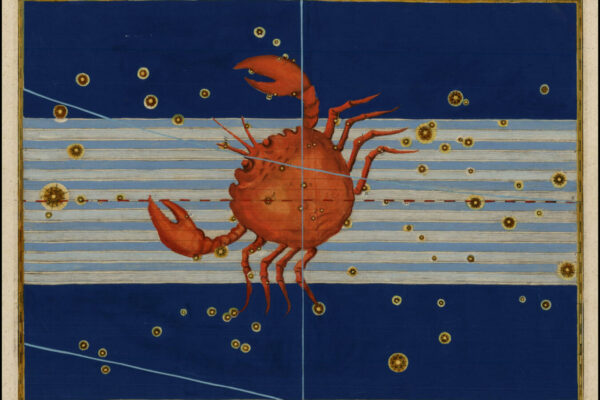Alter Échos: Charles de Gaulle, dans ses Mémoires, a écrit à propos du maréchal Pétain: «La vieillesse est un naufrage.» Vous, vous estimez qu’elle peut aussi constituer un «bel âge». À quoi cela tient-il?
Pierre Pestieau: C’est très subjectif, le bel âge. Paul Nizan a écrit: «J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie.» On peut être heureux et épanoui très longtemps, dans la vie. Les derniers jours ou derniers mois peuvent être très difficiles, mais il y a parfois des façons de réussir sa sortie. Pensez à l’euthanasie. Mon frère se savait condamné, il a décidé de se faire euthanasier. À partir du moment où il a pu choisir son départ, il était plus apaisé et ne s’est plus laissé humilier. C’est ce sentiment d’humiliation qui est intolérable. Albert Camus disait que le suicide était le «seul problème philosophique vraiment sérieux». C’est le seul choix qui nous est offert, tout le reste nous est imposé par l’histoire et la société. Mais écoutez, je suis économiste, pas philosophe.
AÉ: Votre ouvrage confirme que pour vivre heureux longtemps, mieux vaut être un homme riche, et en bonne santé…
PP: Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles ne vivent pas beaucoup plus longtemps en bonne santé. L’espérance de vie sans incapacité (EVSI) correspond au nombre d’années qu’on peut espérer vivre sans être trop limité dans ses activités du quotidien: s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer… On s’aperçoit que les femmes sont plus dépendantes que les hommes, car elles vivent plus longtemps. Ajoutez à cela les questions de revenus: souvent, être plus riche signifie être plus éduqué. Les riches ont tendance à être mieux informés sur ce qu’est une alimentation saine: ils ont les moyens d’acheter des produits de meilleure qualité. Ils exercent aussi généralement des activités moins pénibles et commencent à travailler plus tard. Cela varie tout de même selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, l’espérance de vie est beaucoup plus basse que dans la plupart des pays européens, en raison de ce qu’on a appelé les «morts de désespoir». Il s’agit d’une partie de la classe moyenne blanche non diplômée qui, désespérée de se retrouver sans travail ou perspectives, consomme quotidiennement de l’alcool et des opioïdes. Tout cela paraissait anecdotique il y a quelques années, mais constitue désormais une réalité.
D’un côté, nous sommes responsables de notre santé, car elle dépend de notre mode de vie mais de l’autre, cette responsabilité reste soumise à la gestion politique de nos pays.
AÉ: Sommes-nous responsables de notre bonne santé?
PP: C’est une question très compliquée, car elle est porteuse d’idéologies. Prenez la fable de la cigale et la fourmi. Vous avez deux lectures. La première, que je dirais conservatrice, qu’on trouve beaucoup aux États-Unis, serait plutôt de culpabiliser l’individu. Si la cigale crève de faim l’hiver, c’est de sa faute, on ne l’aidera pas. La seconde, peut-être plus bienveillante, consisterait à dire qu’elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires ou les ressources psychologiques, économiques, pour anticiper l’hiver. C’est clair qu’il y a une question de curseur, qu’on a tendance à placer à gauche ou à droite de l’échiquier politique. Bref, d’un côté nous sommes responsables de notre santé, car elle dépend de notre mode de vie, mais, de l’autre, cette responsabilité reste soumise à la gestion politique de nos pays.
AÉ: L’État n’a-t-il pas tout intérêt à ce que ses citoyens vivent longtemps en bonne santé?
PP: Je ne sais pas. Je pense que les personnes âgées dépendantes ne font pas partie des priorités de nos gouvernements européens. En Belgique, les programmes qui existent sont éclatés entre les pouvoirs locaux, les Régions et le gouvernement fédéral, qui ne se coordonnent pas. Il y a trente ans, j’étais scandalisé par la manière dont les personnes âgées étaient traitées, et particulièrement les femmes qui avaient une retraite en dessous du seuil de pauvreté. Un ministre belge, que j’ai rencontré à ce sujet, m’a dit: «Mais mon cher ami, vous êtes naïf, ce ne sont pas ces gens-là qui vont manifester dans la rue!» Ça en dit long.
AÉ: Vous expliquez que nous avons les moyens de bien vieillir, à condition d’accepter notamment «le travail plus longtemps pour ceux qui ont la santé requise»…
PP: En Belgique, l’avenir du système de retraite n’est pas assuré. Comprenez que la durée de retraite, à savoir le temps entre le départ à la retraite et la mort, est très variable. Elle peut être négative — c’est le cas si vous mourez avant la pension — mais elle peut aussi dépasser 40 ans si vous optez pour une retraite anticipée et mourez vieux. Mais, en moyenne, la durée de retraite ne cesse d’augmenter depuis cinquante ans. L’État ne parvient plus à financer cela. Avec l’allongement de la vie, il est inévitable pour notre système économique de relever l’âge effectif de départ à la retraite.
AÉ: Vous risquez de ne pas vous faire que des amis…
PP: Ce ne serait pas la première fois. La question de la résistance à ce sujet est intéressante. En France, le gouvernement s’y est très mal pris. Sa réforme semblait dire qu’il s’agissait essentiellement de demander aux gens de travailler deux ans de plus. Mais augmenter l’âge de départ à la retraite est différent d’augmenter l’âge légal. On peut plutôt jouer sur plusieurs paramètres, augmenter la durée de carrière nécessaire pour obtenir les pleins droits, supprimer une série de régimes de préretraite… En s’assurant que les personnes fragiles puissent bénéficier de programmes particuliers. Aussi, les travaux que nous avons menés à Liège montrent que la durée d’activité a une influence sur notre état de santé. Paradoxalement, plus vous travaillerez tard, plus vous serez en meilleure santé. Pas dans tous, mais dans beaucoup de métiers. Une retraite anticipée conduit souvent, à moins que les personnes conservent une activité physique et sociale importante, à accélérer des phénomènes comme la démence. C’est dans ce sens-là que je milite en faveur d’une vie active prolongée, au travers du bénévolat ou de la culture, par exemple.
AÉ: La question de la dépendance est aussi directement reliée à ce qu’il y a dans notre portefeuille.
PP: En plus de mourir généralement plus jeunes, les pauvres sont plus dépendants. Notamment en raison de leurs conditions de travail très difficiles. Après vingt ans de travail à genoux sur le sol, on a les rotules complètement détruites. Il y a des moyens de réduire la pénibilité de ces métiers en modifiant les conditions de travail: davantage de protection, des rythmes moins exigeants… Cela aura un coût et nécessitera un contrôle continu des pouvoirs publics. Ce n’est pas différent du problème que pose le respect de l’environnement: seul un contrôle des autorités sur les entreprises peut les y obliger.
AÉ: Pour profiter d’une meilleure longévité, vous proposez donc de «modifier notre approche de la dépendance»…
PP: Miser sur le préventif plutôt que sur le curatif, oui. Malheureusement, le préventif ne se résout pas nécessairement à coups de billets, mais demande que l’on modifie nos comportements: mieux manger, moins boire, ne pas fumer, faire de l’exercice. Et cela, c’est en dehors des compétences des gouvernements. Mais ni la prévention ni le curatif ne sont accessibles à tous. Notre système est tel qu’une partie de la population, parmi les plus pauvres, n’a pas accès à des soins de qualité. Notez que les soins de santé représentent un peu plus de 10% du PIB. À la louche, si l’on souhaitait bénéficier d’une couverture réellement universelle, cela coûterait environ 1% du PIB, pas plus.
AÉ: Il y a la question de comment vieillir, et aussi d’où vieillir.
PP: Il faut permettre aux gens de réaliser des choix libres, en matière de logement. Reste-t-on chez soi? Va-t-on dans une maison de repos? Les études montrent qu’à toutes choses égales, et en contrôlant les autres facteurs, terminer ses jours en maison de repos conduit à une mortalité plus précoce que rester chez soi. À cet égard, nous avons besoin d’une politique beaucoup plus proactive, afin de nous assurer que les maisons de repos soient autre chose que des mouroirs.
L’État doit intervenir en créant des mécanismes de solidarité, tendre vers la cinquième branche de la sécurité sociale, qui sera l’assurance dépendance.
AÉ: Finalement, vivre heureux longtemps, combien ça coûte?
PP: Ah oui… C’est une bonne question!
AÉ: C’est vous qui la posez.
PP: C’est mon éditeur qui a choisi le titre… Mais première chose: il est difficile de donner une évaluation, car le coût le plus important n’est pas financier, mais réside dans un changement de comportement et de mode de vie. Cela passe notamment par l’éducation et la solidarité intergénérationnelle. Deuxième chose: j’ai tendance à distinguer les problèmes qui se posent aux pauvres et ceux qui se posent aux classes moyennes intermédiaires et supérieures. Pour les premiers, l’État doit intervenir en créant des mécanismes de solidarité, tendre vers la cinquième branche de la sécurité sociale, qui sera l’assurance dépendance (NDLR: l’assurance dépendance est une protection financière qui aide à couvrir les coûts liés à la perte d’autonomie et à la dépendance physique ou mentale). Les seconds doivent être incités à recourir à une assurance dépendance privée, qui permettrait de soulager les personnes qui vivent plus longtemps sans autonomie. Malheureusement, il n’existe pas encore d’assurance dépendance très sérieuse en Belgique.
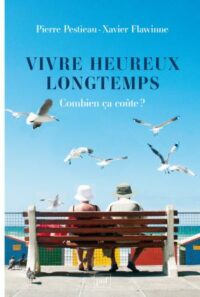 Vivre heureux longtemps ー Combien ça coûte?, Pierre Pestieau, Xavier Flawinne, 185 p., Presses universitaires de France, 16 €.
Vivre heureux longtemps ー Combien ça coûte?, Pierre Pestieau, Xavier Flawinne, 185 p., Presses universitaires de France, 16 €.