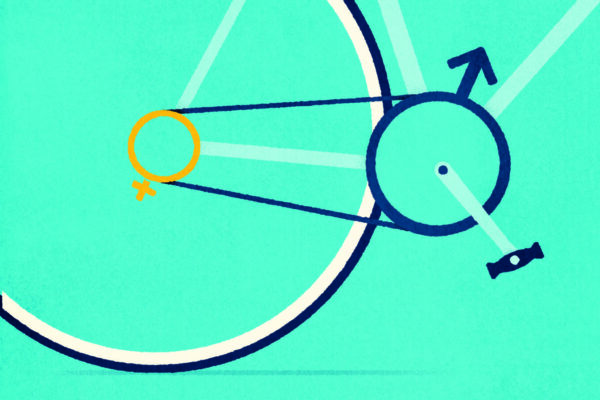Alter Échos: Qu’est-ce qui vous a amenée à croiser enjeux interculturels et de genre?
Audrey Heine: Dans le cadre de mon cours de psychologie interculturelle à l’ULB, j’invite des professionnels exerçant auprès de personnes migrantes à venir expliquer leurs pratiques de terrain. La question du genre est systématiquement évoquée parce que dans les parcours de migration et les processus d’acculturation, les personnes les plus vulnérables sont généralement les femmes, les familles, les enfants. Une série de questions surgissent alors autour des pratiques professionnelles lorsque les personnes accompagnées se trouvent à la croisée d’oppressions multiples. Par ailleurs, il y a quelques années, j’ai codirigé un ouvrage collectif sur les pratiques de psychologie interculturelle. Dans le processus d’écriture, incluant des associations antiracistes, citoyennes et interculturelles, tout le monde s’est là aussi rendu compte que les questions interculturelles étaient intriquées à d’autres facteurs, les inégalités de classe et de genre. Ce fut le point de départ de la réflexion que je mène aujourd’hui avec mes collègues québécoises.
AÉ: Vos collègues québécoises, Estibaliz Jimenez et Caterine Bourassa-Dansereau, sont toutes deux professeures à l’Université du Québec. Avec elles, vous avez réalisé et dirigé deux ouvrages collectifs: Violences genrées: enjeux interculturels et féministes (2022, éd. Academia) et Pratiques interculturelles féministes (2023, éd. Acamedia). Ces ouvrages se situent à la jonction des questions d’origine et de genre, mais aussi des mondes académiques et associatifs. Pourriez-vous en parler?
AH: Ce sont des ouvrages collectifs, qui ont en commun d’avoir été écrits pour et par des professionnels du travail social, de la santé, de l’aide aux personnes… Ils sont également tous deux inspirés de témoignages de femmes, ponctués de récits autant de professionnelles que de femmes migrantes qui s’expriment à travers les voix des professionnelles. Le point commun des deux livres, c’est aussi de valoriser les pratiques de terrain et de présenter comment ces pratiques peuvent se transformer. Quand on porte un intérêt sur cette double perspective, enjeux de genre et enjeux d’origine, comment concrètement les intégrer dans ses pratiques de terrain? Deux questions de départ ont été soumises aux professionnelles. D’abord, qu’est-ce qui est difficile, en tant que praticiens et praticiennes, quand vous travaillez les questions de genre et d’origine avec vos publics, qu’est-ce qui coince à la fois dans la relation, dans l’organisation et au niveau sociétal? Et, la seconde question, qu’est-ce qui a fait ressource, qu’est-ce qui permet de dépasser les blocages interpersonnels, organisationnels, sociétaux? En effet, c’est important de pouvoir reconnaître les compétences. En tant que professionnels qui accompagnent des femmes migrantes, on veut surtout reconnaître les difficultés que vivent ces femmes et insister sur le fait qu’elles sont victimes de… Mais la plupart des femmes insistent sur le fait qu’elles sont aussi agentes. Ce sont des guerrières qui mènent à terme ces parcours migratoires et ces femmes impulsent du changement. Dès lors, comment reconnaître ces habiletés et ces forces développées pendant les parcours migratoires?
AÉ: Qu’est-ce qui différencie ces deux ouvrages, sortis à moins d’un an d’intervalle?
AH: Le premier, Violences genrées: enjeux interculturels et féministes, porte sur la thématique des violences dans les trajectoires migratoires, dans le pays d’origine, pendant le trajet et à l’arrivée. Y sont abordées les violences basées sur l’honneur, les violences de l’accueil… Au Canada et en Belgique, on est assez bien équipé au niveau des textes légaux pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais, en pratique, l’action associative s’organise différemment. On trouve donc dans ce livre des témoignages d’associations, belges et québécoises, accompagnant des femmes migrantes en précarité de séjour. Quant au deuxième ouvrage, Pratiques interculturelles féministes, il propose plusieurs entrées thématiques: la santé mentale, le travail, le corps et l’intime…
Au Canada et en Belgique, on est assez bien équipé au niveau des textes légaux pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais, en pratique, l’action associative s’organise différemment.
On y aborde aussi les transformations institutionnelles: comment une organisation qui travaille sur les questions interculturelles, par exemple, en est venue à intégrer structurellement, dans son mode de fonctionnement au quotidien, les questions de genre? Cet ouvrage est donc plus large sur le plan des thématiques, mais propose un continuum: comment travailler les pratiques interculturelles féministes dans l’intervention auprès des femmes, mais aussi auprès des organisations?
AÉ: Adopter des «pratiques féministes interculturelles», voire des «pratiques intersectionnelles» comme vous les nommez également, ça se traduit comment, concrètement, sur le terrain?
AH: Je parle en effet de plus en plus de pratiques intersectionnelles, dans l’idée de croiser davantage encore les formes d’oppression et les discriminations: diversité des genres, origine, classe… Dans le second ouvrage, ma collègue québécoise Caterine Bourassa-Dansereau a tenté de conceptualiser ces pratiques, grâce au travail mené avec les associations. Elle propose de réfléchir sur l’intervention interculturelle féministe avec un modèle à trois entrées. Le premier niveau est celui de l’interpersonnel: comment adopter une posture intersectionnelle dans la relation avec la personne? Il s’agit, en tant que professionnel, de se décentrer, de travailler sur sa posture, de conscientiser ses propres privilèges, préjugés et représentations, de porter une attention à l’inclusion dans l’accueil de son public… C’est la base de la relation, mais ce n’est pas suffisant, car, en s’arrêtant à cela, on dépolitise la notion d’intersectionnalité. D’où, le second niveau, qui se situe dans l’organisationnel: comment avoir un impact sur les processus organisationnels, comment rendre structurelle la question intersectionnelle pour ne pas qu’elle reste juste dans la relation? Qu’un thérapeute fasse de la psychologie féministe interculturelle dans son coin, c’est très bien, mais comment toute l’organisation de soin, de santé mentale, par exemple, va s’approprier ce regard sensible au genre, à l’origine, à la pauvreté des femmes… Cela implique aussi des politiques publiques et on entre alors dans le travail de plaidoyer que les organisations peuvent mener chacune à leur niveau.
Qu’un thérapeute fasse de la psychologie féministe interculturelle dans son coin, c’est très bien, mais comment toute l’organisation de soin, de santé mentale, par exemple, va s’approprier ce regard sensible au genre, à l’origine, à la pauvreté des femmes…
Enfin, le troisième niveau est sociétal. C’est une attention à ce qui vient se jouer dans les rapports de pouvoir, plus socialement, dans les croisements entre femmes-hommes, entre différents groupes minoritaires-majoritaires. Donc, comment travailler au niveau sociétal sur la question des privilèges? Il n’y a pas de hiérarchie entre ces trois niveaux et, idéalement, il faut pouvoir travailler sur tous ces différents niveaux, sinon on reste confronté à des freins.
AÉ: Avez-vous le sentiment qu’actuellement, les professionnels du terrain social-santé parviennent à prendre en compte ces inégalités multiples dans leur travail?
AH: De par nos contextes nationaux, les politiques d’immigration et d’intégration propres à chaque pays, nous sommes dans des temporalités différentes au Québec et en Belgique dans la mise en oeuvre du travail intersectionnel. En Belgique, les associations déploient beaucoup de créativité pour intégrer la diversité de leur public mais il y a des enjeux pour formaliser et rendre structurelles ces actions. Le secteur féministe s’est emparé des questions intersectionnelles depuis plusieurs années et du côté du secteur interculturel, ça bouge également ! Les intervenants se rendent bien compte qu’il y a des enjeux en termes de croisement des inégalités et mettent en place des projets pour travailler sur les questions de genre. Lorsque subsiste le gender blind, cet aveuglement aux questions de genre, cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Historiquement, le genre a toujours été le parent pauvre.
En Belgique, les associations déploient beaucoup de créativité pour intégrer la diversité de leur public mais il y a des enjeux pour formaliser et rendre structurelles ces actions. Le secteur féministe s’est emparé des questions intersectionnelles depuis plusieurs années et du côté du secteur interculturel, ça bouge également !
Par ailleurs, tous les professionnels sont d’accord pour dire qu’il ne faut pas hiérarchiser les problématiques, mais sur le terrain, ce n’est pas si facile. Imaginons une femme en demande d’asile, vivant des violences conjugales et dépendant de son conjoint pour rester, à quoi le professionnel qui l’accompagne s’attaque-t-il en premier? Il y a aussi le fait que la plupart des professionnels sont volontaires sur ces questions de genre mais expriment manquer d’outils. Et celles et ceux qui les travaillaient à un niveau interpersonnel, avec leur public, doivent faire face à des freins institutionnels.
AÉ: Quels futurs souhaitez-vous à ces ouvrages et à l’ensemble de ces travaux? Quels prolongements éventuels?
AH: Ces livres ont permis de mettre en place un réseau d’associations avec une dimension internationale. Ce que notre réseau constate aujourd’hui, c’est la nécessité d’aller beaucoup plus loin sur les questions décoloniales, de pauvreté, de diversité de genres… À mon sens, cette approche intersectionnelle doit aussi être davantage envisagée dans le contexte multi-crises que nous vivons actuellement: crise écologique, crise politique, crise économique… Ces crises affectent tout le monde, mais affectent néanmoins beaucoup plus les femmes et les personnes migrantes. Les personnes isolées ou en précarité de séjour sont encore plus isolées. Les paradigmes sociaux bougent. Le travail social bouge lui aussi. Dès lors, dans ce contexte de société en mouvement, comment faire vivre ces pratiques intersectionnelles au plus près des réalités actuelles des travailleurs sociaux et travailleuses sociales? Avec les différentes associations du réseau, il y a donc à penser des conceptions de formations et certainement encore des projets d’écriture. Et dans ces nouveaux projets d’écriture et de formation, il y a, selon moi, à aller chercher davantage encore dans ce que disent les femmes migrantes et les personnes vulnérables. Ce sont elles les expertes du vécu.