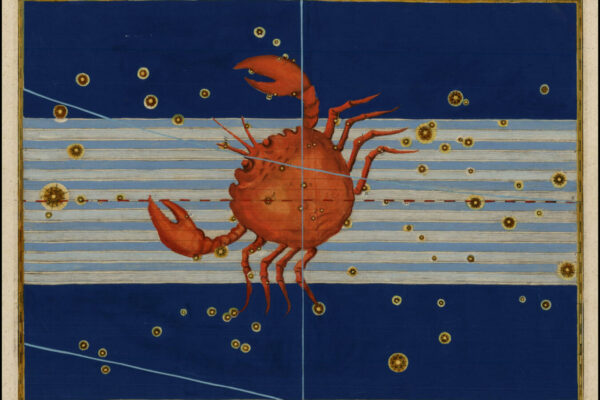Alter Échos: Les politiques publiques pour une alimentation saine ont évolué au cours des dernières décennies. Pouvez-vous nous dire comment?
Stephan Van den Broucke: On a vu, au cours des 30-40 dernières années, de grandes évolutions par rapport à l’attention portée aux liens entre alimentation et santé dans la communication des pouvoirs publics et chez l’ensemble du corps soignant. C’est aussi la société dans son entièreté qui a évolué. L’enseignement est devenu un acteur important en la matière, non seulement par le biais des cours donnés, mais aussi en termes d’offre alimentaire. À ce jour, il n’y a plus grand monde qui ne connaisse pas l’importance de l’impact de l’alimentation sur la santé. Même constat en ce qui concerne l’activité physique. Ce qui est un peu plus récent, c’est le lien avec le développement durable: en général, une alimentation bénéfique pour la santé est aussi celle qui est la meilleure pour la terre. Cela commence à faire partie des choix des gens en matière de consommation alimentaire.
AÉ: Au niveau politique, quelles mesures politiques peuvent-elles être prises pour favoriser une alimentation plus bénéfique?
SVDB: Le politique est relativement éloigné des choix des personnes. Mais des mesures législatives peuvent créer un environnement social et législatif plus bénéfique. Exemples? L’imposition de la réduction de certains ingrédients qui ont un impact négatif comme le taux de sel ou le sucre, les taxes sur les aliments non bénéfiques, l’interdiction des publicités pour des produits sucrés à destination des enfants ou encore celle de la vente de sodas et de snacks sucrés dans les écoles. Mais, ensuite, le choix se joue dans les endroits où il y a une offre alimentaire: les commerces, les écoles, les entreprises. Si l’offre est plus large et plus attirante, il y aura plus de chance que de meilleurs choix pour la santé soient faits.
«Les campagnes de sensibilisation ont eu un effet. Mais il y a mille fois plus de messages qui vont dans l’autre sens, qui sont beaucoup mieux construits et avec des budgets incomparables.»
AÉ: La connaissance des impacts sur la santé n’est qu’un facteur parmi bien d’autres dans le choix alimentaire…
SVDB: Le choix alimentaire est complexe. La santé et le développement durable en font partie, mais il y a aussi le prix, la disponibilité, la facilité de préparation, les préférences et le goût, ainsi que ceux des autres membres de la famille. Les habitudes et la familiarité jouent aussi un rôle. Quand on a la possibilité de goûter des choses qu’on ne connaît pas, on réduit cette barrière. Les commerces font goûter les nouveaux produits, mais cela se fait très rarement pour des produits bénéfiques pour la santé. Des activités cuisine à l’école aident à réduire cette infamiliarité.
AÉ: Vous avez travaillé sur le nudging en matière d’alimentation. Cette technique est largement utilisée par les acteurs commerciaux. Qu’en est-il des pouvoirs publics?
SVDB: Le nudging («coup de pouce») consiste à modifier des aspects du contexte afin d’influer sur les choix et prises de décision. L’idée n’est donc ni d’obliger ou d’interdire, ni de jouer sur les prix, mais plutôt d’attirer vers un choix en le mettant en avant ou en le rendant plus attrayant. C’est une approche appliquée depuis très longtemps au niveau commercial mais qui a commencé à être utilisée dans les politiques publiques, notamment dans les domaines de la santé, du développement durable ou de la sécurité routière. Cette approche est davantage utilisée dans les pays anglo-saxons où il y a beaucoup plus de résistances face aux interdictions ou aux taxes (comme les sugar taxes) dans le cadre de l’économie de marché. Le «nudge» reste un choix libre. Évidemment, certains trouvent cette approche paternaliste puisqu’on pousse les gens sans savoir s’ils sont d’accord ou pas; en termes de décision démocratique, un impôt ou une interdiction sont plus clairs. Mais, personnellement, je pense que c’est une discussion stérile. En matière d’alimentation, cela peut être utilisé dans une cafétéria où on peut faciliter les choix les plus sains en les rendant plus visibles ou plus attrayants par exemple.
AÉ: L’étiquetage ou le Nutri-Score devraient également permettre de faciliter le choix de produits qui ont une meilleure qualité nutritionnelle. Qu’en est-il?
SVDB: C’est une question complexe. L’étiquetage est évidemment important. Il faut des informations correctes sur les produits, notamment pour les personnes qui ont des allergies. Mais c’est souvent un langage trop technique pour être utilisé dans ses choix alimentaires. Le Nutri-Score est une tentative pour rendre les choses plus faciles à comprendre. C’est un effort intéressant et qui a un réel impact. Le problème, c’est qu’il simplifie une matière très compliquée, ce qui amène à des résultats parfois surprenants: une pomme frite peut avoir un meilleur résultat qu’un autre produit plus bénéfique. Ce n’est donc pas une solution miraculeuse.
«Malgré la reconnaissance des inégalités de santé depuis des décennies, il est très difficile de combler ce fossé, qui a même tendance à s’élargir.»
AÉ: En Belgique, un enfant sur cinq est en surpoids1 (Lire aussi dans ce dossier «Obésité infantile: en finir avec la culpabilisation» et «Cachez ces chips dans les boîtes à tartines…»). La protection des enfants a fait l’objet d’un accord de certains annonceurs belges2 qui se sont engagés à limiter leur publicité vers les enfants de moins de 12 ans. Mais aujourd’hui les réseaux sociaux, les influenceurs ou les advergames (jeux vidéo publicitaires) brouillent les codes de la publicité, rendant les messages plus difficiles à décrypter…
SVDB: La population, y compris les jeunes, est au courant des pratiques alimentaires bénéfiques à leur santé. Les campagnes de sensibilisation ont eu un effet. Mais il y a mille fois plus de messages qui vont dans l’autre sens, qui sont beaucoup mieux construits et avec des budgets incomparables. Ce n’est pas une compétition juste. Or le public jeune n’a pas encore complètement acquis les connaissances et les compétences qui lui permettent de maîtriser l’information. Il faut donc des campagnes plus ciblées et des canaux de communication plus modernes. Il faut aussi collaborer avec les acteurs situés au niveau où les gens font leurs choix – les supermarchés, les restaurants – sans diaboliser les intérêts commerciaux. Ces acteurs ne sont pas comparables à l’industrie tabagique: leur intérêt, c’est de vendre des produits alimentaires, pas de vendre le plus de produits malsains. Dans les magasins, la santé et le développement durables sont d’ailleurs devenus des arguments de vente. Évidemment, dans certains cas, les intérêts divergent, il faut trouver des équilibres.
AÉ: Beaucoup d’acteurs dénoncent les effets pervers des campagnes nutritionnelles sur les populations défavorisées. Ces messages seraient culpabilisants pour des personnes qui n’ont pas toujours la possibilité de se fournir en produits sains ou de cuisiner.
SVDB: Les personnes les plus favorisées sont aussi celles qui un ont un style de vie bénéfique pour la santé. Malgré la reconnaissance des inégalités de santé depuis des décennies, il est très difficile de combler ce fossé, qui a même tendance à s’élargir. Il peut y avoir une question de connaissances et de compétences moins élevées, mais les personnes dans une situation défavorisée n’ont pas non plus toujours les moyens de mettre en pratique leurs connaissances. Les produits plus sains sont souvent aussi les plus coûteux – même si ce n’est pas le cas de tous. Il y a une question d’accès. Aux États-Unis, il y a des endroits où il est impossible d’acheter des produits frais sans avoir de voiture: ce sont les food deserts. Le contexte social joue aussi: quand on est entouré de personnes qui ne mangent pas sainement, cela devient la norme. Enfin, quand on a du mal à payer son loyer, les perspectives à long terme ne sont pas les mêmes. Les résultats d’une alimentation saine ne se feront sentir que 10, 20, 30 ans plus tard. Ce n’est donc pas une priorité.
AÉ: Quels sont les dispositifs les plus propices pour toucher ces publics?
SVDB: Il faut un meilleur accès aux aliments sains mais aussi travailler sur les normes, les habitudes qui font que cette offre n’est pas utilisée même quand elle existe. On parle parfois de la littéracie alimentaire: ce sont les compétences liées à nos connaissances des impacts de l’alimentation sur notre santé. Les campagnes générales ne fonctionnent pas. Il faut travailler avec les associations, les centres de santé locaux et créer des approches avec les gens plutôt que pour les gens. Ce sont tout de même eux qui connaissent le mieux leur contexte de vie, leurs difficultés et défis (voir encadré).
Aide alimentaire: participer pour mieux manger
Plusieurs recherches participatives se sont attelées, ces dernières années, à décrypter les liens entre pauvreté et alimentation de qualité3. L’une d’elles, menée en 2018 et 2019 par ATD Quart Monde, l’UCL et la Fédération des services sociaux (FdSS), a dressé le portrait sombre de l’aide alimentaire dont dépendraient, aujourd’hui, 600.000 personnes en Belgique (contre 100.000 dans les années 2000)4. Dans une optique de croisement des savoirs – savoirs expérientiels, savoirs d’action des professionnels et savoirs académiques –, les cochercheurs ont mis en avant les violences et logiques de domination exercées à l’encontre de ses bénéficiaires: l’aide alimentaire est violente et dégradante du fait d’imposer une démarche de demande d’aide pour pouvoir manger; elle est jugeante quand elle exige des justifications des dépenses; elle se révèle excluante par ses critères d’accès; elle est, enfin, souvent peu qualitative et contraignante, limitant les possibilités de choix de produits alimentaires.
Hector Guichard, militant ATD Quart Monde depuis 1985, ancien bénéficiaire de l’aide alimentaire, ancien bénévole dans la distribution de colis, rappelle les constats établis par cette recherche: «Les pauvres sont toujours regardés d’une certaine manière, comme des gens qui mangent mal et la distribution n’est pas égalitaire: certains repartent avec un sac, d’autres avec deux… Il n’y a pas de variété dans les produits, ce sont surtout des conserves issues de l’agro-industriel. Beaucoup de bénéficiaires se sont aussi plaints de se retrouver avec des produits périmés.» Hector Guichard conclut: «Dans cette recherche, on a beaucoup parlé de violences. Puis on a fait beaucoup de recommandations.»
Comment sortir de la violence induite par ce système? Quelles solutions alternatives mettre en place? Quel avenir pour les personnes qui y ont recours? Le rapport de recherche5 élabore des pistes d’action, parmi lesquelles l’idée d’un syndicat des usagers ou encore la formation des bénévoles. Mais c’est aussi notre système global – notre modèle alimentaire, les inégalités sociales – qui est pointé du doigt et doit être transformé. Continuant sur sa lancée, Hector milite aujourd’hui pour la distribution de chèques alimentaires, participe à un groupe de recherche sur l’idée de sécurité sociale alimentaire et promeut la création de liens entre petits agriculteurs et personnes en situation de pauvreté.
- Enquête de santé 2018
- www.belgianpledge.be, désormais élargi à certains acteurs présents sur Internet
- Lire notamment les réalisations du projet Solenprim, projet de recherche-action, développé collectivement par des organisations d’aide alimentaire, une plateforme d’achats solidaire et la Fédération des Services Sociaux. Il a pour objectif un accès durable pour tous à une alimentation diversifiée et de qualité sur https://solenprim.com
- https://www.alterechos.be/lalimentation-bientot-integree-dans-la-securite-sociale/
- L’expérience de l’aide alimentaire. Quelle(s) alternative(s) ? Rapport d’une recherche en croisement des savoirs, UCL, ATD Quart Monde en Belgique, FdSS, 2019. En ligne sur atd-quartmonde.be/
En savoir plus
Réécoutez notre podcast réalisé dans le cadre de l’Ecole de transormation sociale: «La précarité alimentaire: quand se nourrir dignement est une galère».