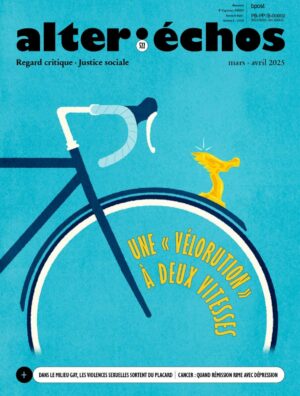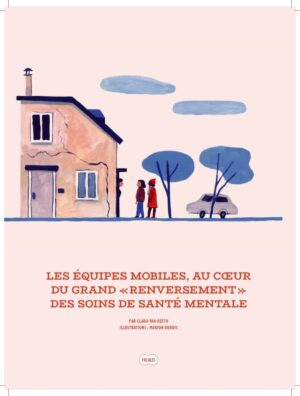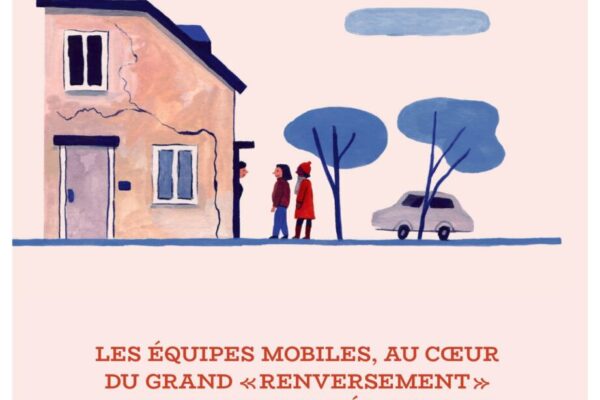«J’ai bu beaucoup pendant près de 15 ans. J’ai commencé jeune, à l’université, avec les copains, pour faire la fête. Puis à 30 ans, je ne pouvais plus m’en passer. Quand j’en ai pris conscience, j’ai eu honte et suis tombée en dépression. J’ai essayé d’arrêter, j’ai ramé et j’ai cru que j’allais mourir.» À 32 ans, Françoise* a poussé la porte des Alcooliques anonymes d’une commune bruxelloise. C’est avec ses «amis» qu’elle fête ce jeudi de décembre son anniversaire de 35 ans d’abstinence, des années durant lesquelles elle a appris petit à petit «à s’amuser à nouveau».
Parmi les huit femmes sur les 14 personnes autour de la table, il y a aussi Marie*, abstinente depuis plus de 20 ans. «J’ai commencé à boire après ma séparation, autour de mes 40 ans, raconte-t-elle. C’est parti d’un petit plaisir pour mettre un peu de lumière dans ma vie seule avec mes enfants. C’est devenu un besoin après chaque problème. Je buvais pour soigner le trop-plein, la dépression, jusqu’à ce que mon fils me mette face à mon problème.» Tour à tour, s’ils le veulent, femmes et hommes racontent leur parcours, leur journée, égrènent leurs achoppements et leurs victoires, les difficultés éprouvées et les plaisirs retrouvés.
Menton enfoncé dans son écharpe, la benjamine du groupe, trentenaire, assiste à sa première réunion. Elle explique boire seule depuis sa rupture il y a trois ans. «J’ai perdu mes amis… Je n’ai plus envie de boire. Je ne sais pas comment je vais faire.» Pour elle, «dire le mot alcoolique est encore trop difficile». «Tu as fait le plus dur», s’empresse de lui dire sa voisine, qui la félicite d’avoir eu le courage de franchir la porte. «Chez les AA, on vit 24 heures à la fois et demain n’existe pas», répète aussi la modératrice.
Honte et dissimulation
Des femmes qui boivent, on en connaît, voire on en est. On en voit, souvent, et partout. Dans la rue, dans les bars, au repas du personnel, au marché de Noël, au cinéma, à la table de famille…
Mais comment la société regarde-t-elle et se préoccupe-t-elle de celles qui boivent beaucoup, celles qui boivent trop, celles qui ne peuvent plus s’en passer?
«Dans le passé, l’homme ‘pouvait boire’, la femme devait ‘tenir la maison’. C’était impensable de penser qu’une femme buvait, au risque de faire vaciller ce modèle. Le regard social a bien sûr évolué, mais on associe toujours plus les femmes à la modération et on juge les femmes qui boivent plus sévèrement. De ce fait, l’alcoolodépendance féminine est plus cachée, explique Thomas Orban, médecin généraliste et addictologue. Cela s’inscrit aussi dans le langage; on dit d’un homme qu’il est pété, on dira d’une femme qu’elle est pompette.»
«Dans le passé, l’homme ‘pouvait boire’, la femme devait ‘tenir la maison’. C’était impensable de penser qu’une femme buvait, au risque de faire vaciller ce modèle. Le regard social a bien sûr évolué mais on associe toujours plus les femmes à la modération et on juge les femmes qui boivent plus sévèrement. De ce fait, l’alcoolodépendance féminine est plus cachée.»
Thomas Orban, médecin généraliste et addictologue
«On attend des femmes qu’elles soient irréprochables et encore plus des mères. De nombreux jugements moraux et sociaux entourent l’alcoolodépendance féminine, analyse Justine Drossart, psychologue et alcoologue. Cela génère de la culpabilité et de la honte chez les femmes, qui mettent du temps à demander de l’aide.» Constatant une augmentation des femmes dans leurs consultations, elles ont, avec Maïté Rogie, psychologue et alcoologue, lancé en 2021 au sein du Centre régional psychiatrique Les Marronniers à Tournai le programme «Femmes et alcool». Inédit sur le territoire belge, il rassemble au maximum huit femmes sur une base volontaire pour 10 séances d’ateliers en groupe articulés autour de volets psycho-éducatifs, émotionnels et psychocorporels.
Moins nombreuses
Si l’on regarde les chiffres, les femmes boivent moins que les hommes. «Les hommes sont plus enclins que les femmes à présenter un profil à risque, que ce soit au niveau de la consommation quotidienne (13,5% H > 6% F), de l’hyper-alcoolisation (au moins six boissons en une seule fois, NDLR) hebdomadaire (11,5% H > 4% F), du binge drinking hebdomadaire (6% H > 3% F) et de la consommation problématique de l’alcool (9,5% H > 5% F)», rapporte Sciensano dans son Enquête de santé de 2018.
Les repères de consommation à risque sont fixés par le Conseil supérieur de la santé à 10 verres standards au maximum par semaine, deux par jour et au moins deux jours sans alcool par semaine. Le CSS recommande aussi aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux «femmes enceintes, celles qui souhaitent le devenir et les femmes qui allaitent, de ne pas boire de boissons alcoolisées».
Si la consommation présente des risques pour tout le monde, les femmes partent perdantes face à la boisson quand on regarde l’influence du sexe biologique.
«Elles métabolisent l’alcool de façon différente que les hommes. Le corps des femmes possédant en moyenne moins d’eau, l’alcool va se diluer moins bien, ce qui fait qu’à quantité égale, elles vont avoir une alcoolémie plus élevée que l’homme. D’autres effets comme des problèmes hépatiques et neurologiques apparaissent plus tôt chez les femmes», souligne Justine Drossart.
«En plus des autres cancers associés à la consommation d’alcool, un verre par jour augmente de 10% le risque relatif de cancer du sein, avec deux verres ce chiffre est doublé et ainsi de suite… On met hélas encore très peu les femmes au courant de ce lien», ajoute Thomas Orban.
Un terreau fertile
Chez Infor Drogues & Addictions, on ne définit pas la dépendance par la quantité ou la fréquence. «Une personne est dépendante à l’alcool lorsqu’elle ne sait pas remplir des besoins autrement qu’avec sa bouteille», explique Antoine Boucher, porte-parole de l’association bruxelloise. Et de poursuivre: «Les drogues répondent à des fonctions: créer du lien social, se donner une identité (sociale, professionnelle…) et gérer ses émotions. L’alcool, à la différence d’autres produits, comme la morphine par exemple, répond à ces trois fonctions, d’où sa présence massive et son succès», encouragés aussi par le fait qu’il est totalement légal.
«Elles métabolisent l’alcool de façon différente que les hommes. Le corps des femmes possédant en moyenne moins d’eau, l’alcool va se diluer moins bien, ce qui fait qu’à quantité égale, elles vont avoir une alcoolémie plus élevée que l’homme. D’autres effets comme des problèmes hépatiques et neurologiques apparaissent plus tôt chez les femmes.»
Justine Drossart, psychologue et alcoologue
Si les femmes boivent moins, leurs conditions de vie ne les préservent donc pas de la consommation. Loin de là. «Les injonctions pèsent lourd sur les femmes. On doit être des super-nanas, des mères exemplaires. C’est un terreau fertile pour l’alcool qui permet de tenir et d’échapper à la pression», observe Justine Drossart. À rebours du stéréotype des femmes «débauchées», l’alcoolodépendance concerne aussi des femmes actives et instruites, et touche toutes les catégories d’âge. «Les transformations de la société pourraient d’ailleurs venir augmenter les chiffres, avance Antoine Boucher. Les femmes sont de plus en plus confrontées au stress de la société de compétition.»
Rôle à tenir, rôle à jouer
En matière d’identité, l’alcool n’échappe pas aux normes sociales de la féminité et de la masculinité. La publicité l’a bien compris. Ciblant les hommes d’abord, elle a peu à peu élargi le marché aux femmes (et fait de même pour les jeunes), usant de multiples stratégies: utilisation du rose, marketing autour de boissons à faibles calories, slogans d’empowerment…
«Le regard porté sur les femmes qui boivent évolue, fait observer à ce titre Justine Drossart. Dans les films ou la publicité, l’alcool est de plus en plus valorisé. Boire est corrélé à l’amitié, à l’émancipation. Ce n’est plus Sue Ellen qui boit toute seule dans son salon.» Aujourd’hui, il y a donc des femmes qui «boivent comme des hommes» reprenant à leur compte un alcoolisme bravache qui leur était longtemps interdit. Tout comme il y a aussi des hommes qui consomment, non pas au bistrot ou au stade de foot, mais dans le secret et la solitude.
Selon les contextes et les prescrits sociaux, des femmes vont dissimuler leur consommation pour rester conformes aux standards attendus de la féminité, mais d’autres useront de la boisson pour les transgresser.
Ce fut le cas d’Anaïs, 35 ans, qui vient de passer le cap d’un an de sobriété. «Boire m’a permis de ne pas être réduite aux carcans de la féminité attendue, de me faire une place en tant que femme, queer, lesbienne. J’ai toujours eu une bonne descente, du coup je buvais ‘comme un bonhomme’ dès l’adolescence. J’en ai joué et ça a alimenté quelque chose de fortement identitaire chez moi dès le plus jeune âge.» Si aujourd’hui elle utilise «alcoolique» pour parler d’elle, elle fut longtemps dans le déni. «Je ne me suis jamais identifiée à l’image de l’alcoolique qui boit son whisky dès le matin, poursuit-elle. J’ai longtemps caché ma dépendance derrière la sociabilité et la passion du vin nature.» Mais la boisson grignotait pourtant insidieusement son estomac, sa santé mentale, son estime d’elle-même, ses relations. Elle devenait aussi un sparadrap très collant sur un passé trop violent.
Traumas et addictions
Outre son rôle de lubrifiant social, l’alcool est aussi utilisé comme anesthésiant des souffrances. Et là aussi, les femmes trinquent. «Des études menées sur des femmes (ex-)consommatrices révèlent que des traumas vécus pendant l’enfance et l’adolescence sont fréquemment à l’origine de ruptures familiales accompagnées d’une entrée dans la consommation», rapporte la Fédération bruxelloise Drogues et Addictions (FEDA), dans une analyse de 2023 sur le rapport du genre aux assuétudes. Les violences psychologiques, physiques ou sexuelles peuvent amener la victime à adopter des conduites dites «dissociantes» pour ne pas faire face au souvenir de l’agression.
«L’alcool joue un rôle de dépresseur et d’anxiolytique. Les femmes l’utilisent comme automédication contre leurs souffrances psychosomatiques», constate aussi Charlotte Bonbled de DUNE, dispositif de réduction des risques liés à l’usage de drogues en milieu précaire, qui depuis 2018, consacre chaque lundi un espace spécifiquement dévolu aux femmes afin de leur apporter l’attention et la prise en charge spécifiques requises. De plus, l’ensemble des services PMS leur est réservé une fois par mois et des maraudes spécifiquement attribuées. «Les femmes que nous rencontrons subissent des violences inouïes et, bien souvent, elles n’ont que la consommation pour s’apaiser», observe-t-elle.
Thomas Orban pose systématiquement la question des violences à ses patientes, «non pas pour stigmatiser les femmes, mais pour leur montrer que la dépendance ne vient pas de nulle part, précise le médecin. Des patientes me confient aussi que l’alcool les aide à endurer les violences conjugales, comme un antidépresseur, alors qu’il renforce l’état dépressif».
C’est un cercle vicieux. L’alcool «apaise», mais il altère aussi la sensibilité et la vigilance, et peut mettre les femmes en situation de danger et de violences. Une vaste étude scientifique française de 2024 a montré qu’il était un facteur déterminant des violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant, relevant une consommation, tant chez les auteurs (qui constitue une circonstance aggravante pour l’agresseur devant la loi belge) que chez les victimes. «Constat devant être appréhendé, pour les secondes comme des éléments de vulnérabilisation», précise l’étude. Pourtant, là aussi, les stéréotypes ont la peau dure. «Une femme qui boit est regardée comme une femme émancipée, une ‘bonne vivante’, mais aussi comme une femme qui prend des risques, voire une ‘fille facile’. On est toujours sur une ligne de crête», déplore Anaïs.
Des espaces où parler
Pour prévenir l’alcoolodépendance féminine, il faut d’abord en connaître les ressorts. «Or, elle est encore trop souvent appréhendée et traitée comme l’alcoolisme masculin», remarque Maïté Rogie. «En consultation, on va moins vite penser à l’alcool chez une femme que chez un homme», regrette aussi Thomas Orban.
Justine Drossart et Maïté Rogie ont lancé «Vers elles», groupe de discussion réservé aux femmes en dehors de l’hôpital. «Notre objectif est de toucher celles qui ne portent pas encore les stigmates de la dépendance. Car entre le moment où l’on a un problème et le moment où l’on se dit qu’il y a un problème, ça peut prendre dix ans.» Elles plaident pour la multiplication d’espaces en non-mixité «où les femmes peuvent parler librement et en sécurité de sujets intimes difficiles», «retrouver l’estime de soi et solidariser».
«L’alcool joue un rôle de dépresseur et d’anxiolytique. Les femmes l’utilisent comme automédication contre leurs souffrances psychosomatiques.»
Charlotte Bonbled de DUNE, dispositif de réduction des risques liés à l’usage de drogues en milieu précaire
Sachant que les violences et la dépression sont de grands facteurs de risques, Charlotte Bonbled préconise – à la place de la culpabilisation, qui prend des contours de répression (comme les arrêtés communaux interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique) quand il s’agit de femmes précarisées – «de travailler sur les raisons qui mènent les femmes à consommer et d’investir dans l’accès à la santé mentale, mais aussi à l’accès au logement, etc.».
La parole se libère
Si les yeux commencent à s’ouvrir sur l’alcoolodépendance féminine, c’est certainement parce que les femmes prennent la parole avec une force désarmante. Ces dernières années voient fleurir des podcasts, livres ou comptes Instagram. Les femmes y racontent leurs années de lendemain de veille, leurs stratégies pour cacher leur conso, leur recherche de sobriété heureuse ou leur chemin de modération, leurs premières vacances ou date sans alcool. Autant de témoignages qui esquissent des vies non pas toujours sans alcool, mais pas systématiquement avec.
Anaïs a elle aussi documenté certaines étapes de son chemin sur Instagram. «Des femmes comme Claire Touzard, Charlotte Peyronnet (autrices de Sans Alcool et de Et toi, pourquoi tu bois?, NDLR) ou Anna Toumazoff (journaliste qui tient un compte Instagram, NDLR) m’ont tellement aidée à me sentir moins honteuse et moins seule dans un monde où l’alcool nous suit presque partout, que je trouve important aujourd’hui d’en parler même si ce n’est pas simple», explique-t-elle. Car sortir de la dépendance, c’est aussi renoncer à l’illusion de soi, faire face à des émotions longtemps refoulées. Loin de vouloir célébrer une résilience ou une volonté individuelle ou même de stigmatiser la boisson, ces récits mis bout à bout contribuent à déconstruire les pratiques de dépendance féminine et à sortir d’un déni collectif.
*Ces prénoms ont été modifiés.