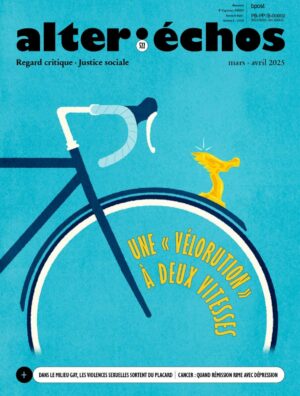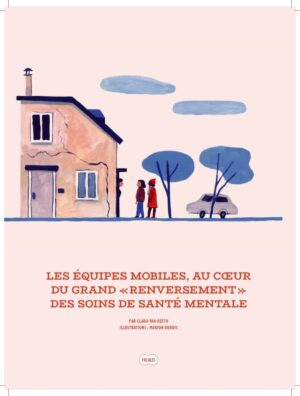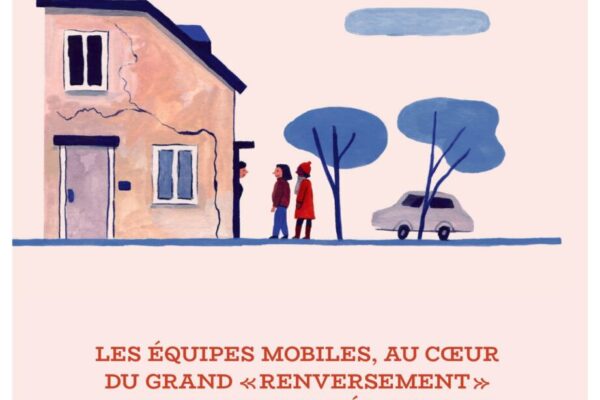Dès sa création le 15 mars 1899, l’Union fixe ses priorités: rassembler les femmes belges victimes de l’alcoolisme de leur mari et protéger leurs enfants. Elle leur propose des lieux pour se distancier des conséquences de l’alcoolisme, leur apporte une aide matérielle (notamment alimentaire) et un accès, bien que limité, à la connaissance. «L’objectif était de mobiliser ces femmes pour qu’elles participent activement à la lutte contre la surconsommation de boissons alcoolisées, explique Sophie Matkava, historienne. À l’époque, il s’agissait principalement de bière de brasserie et non de spiritueux. Mais ce qui posait problème, c’étaient les énormes quantités consommées.»
Au Centre d’archives et de recherches pour l’histoire des femmes (Carhif), le peu de documentation sur le sujet révèle rapidement la rareté des travaux consacrés à cette union. Plusieurs occurrences du nom de Sophie Matkava apparaissent parmi les quelques spécialistes du sujet. Aujourd’hui archiviste à Bozar, elle est l’une des seules à avoir consacré son mémoire de fin d’études à une analyse de la lutte anti-alcoolique portée par l’Union, en 1995. «Ça remonte!, s’exclame-t-elle lors de notre entrevue. J’ai dû me replonger dans mes travaux, car je n’ai plus abordé ce sujet depuis.»
Au début du XXe siècle, les efforts de l’Union se concentrent principalement sur la consommation des hommes issus des classes ouvrières et, plus marginalement, sur la jeunesse. La lutte anti-alcoolique de l’époque s’organise en dehors du système de soins. «Les ouvriers qui sombraient dans un alcoolisme profond ne finissaient pas en cure de désintox comme aujourd’hui, explique Sophie Matkava. C’était de la ‘préventioneke’ par rapport à ce qu’on connaît actuellement.»
Les discours anti-alcooliques généralement diffusés à cette époque par les classes dirigeantes dénoncent les méfaits de la substance dans une perspective de rentabilité économique plutôt que de santé publique. «Il faut se remettre dans le contexte d’un patronat qui a la mainmise sur ses ouvriers, d’une sécurité sociale inexistante, rappelle l’historienne. L’intérêt économique du pays à disposer d’une main-d’œuvre saine et rentable prime sur l’enjeu de santé publique ou sur une volonté d’améliorer les conditions de vie des ouvriers. Et des travailleurs qui arrivent alcoolisés à l’usine parce qu’ils ont trop traîné au bar, ce n’est pas rentable.»
Militantisme anti-alcoolique
Les tout premiers mouvements anti-alcooliques apparaissent dès 1878, avec la Ligue patriotique contre l’alcoolisme, dont les membres sont principalement des médecins, des notables et des femmes de la bourgeoisie. La famille Nyssens, au cœur de la création de l’Union des femmes belges contre l’alcoolisme, évolue elle aussi dans une bourgeoisie libérale-socialiste de la capitale. «La famille s’inscrivait dans un milieu commerçant et industriel, instruit, préoccupé d’améliorations sociales et politiquement engagé, décrit Sophie Matkava. Chez les Nyssens, il est vrai qu’une plus grande place est accordée aux femmes. Et même si quelques hommes rejoindront le conseil d’administration de l’Union, ce sont surtout des figures féminines et féministes de trois générations de la famille Nyssens qui seront les chevilles ouvrières de l’Union.»
«Il faut se remettre dans le contexte d’un patronat qui a la mainmise sur ses ouvriers, d’une sécurité sociale inexistante. L’intérêt économique du pays à disposer d’une main-d’œuvre saine et rentable prime sur l’enjeu de santé publique ou sur une volonté d’améliorer les conditions de vie des ouvriers. Et des travailleurs qui arrivent alcoolisés à l’usine parce qu’ils ont trop traîné au bar, ce n’est pas rentable.»
Sophie Matkava, historienne
Ces femmes éduquées, bourgeoises, vont donc dénoncer les ravages de l’alcool dans les milieux ouvriers et prôner la sobriété. Mais même s’il n’est pas nié, l’alcoolisme des femmes ne sera jamais abordé par l’Union. L’historienne émet plusieurs hypothèses pour expliquer ce silence: «Qu’il ait existé ne paraît faire aucun doute, mais il constituait probablement une mauvaise publicité au sein d’une organisation anti-alcoolique féminine. Qui plus est dans une union qui était l’œuvre de femmes issues de la bourgeoisie, même progressiste, de Bruxelles. Quoi de plus navrant que d’avoir une sœur, une épouse ou une mère alcoolique?»
L’Union ne regarde donc pas trop dans sa propre assiette. Sa lutte anti-alcoolique est non seulement genrée, mais également socialement orientée: tout comme l’alcoolisme des femmes, celui des classes aisées reste largement absent de ses discours.
Modération versus abstinence
Si l’action de l’Union reste à ce jour peu documentée, la lutte anti-alcoolique et ses implications en Belgique ont intéressé davantage d’académiques. Comme Joffrey Liénart, maître en histoire contemporaine à l’Université libre de Bruxelles (ULB), et Fabienne Liénart, docteure au sein du service de médecine interne du CHU Tivoli, à La Louvière. Ensemble, ils cosignent un article intitulé «L’alcoolisme au tournant du XXe siècle: les positions belges dans les débats européens», paru dans la Revue médicale de Bruxelles en 2013. Le duo explique qu’entre 1880 et 1914, l’alcoolisme est considéré comme un véritable fléau social et «constitue plus que jamais une inquiétude chez les bourgeois bien-pensants pour les ravages qu’il cause dans leur classe populaire (les milieux ouvriers, NDLR)».
Sur le Vieux Continent, deux écoles anti-alcooliques s’affrontent alors: la tempérance d’une part – qui prône la modération – et l’abstinence de l’autre. Faut-il condamner seulement l’alcool distillé ou toute forme de boisson alcoolisée comme le vin et la bière? Dans ce débat houleux, la Belgique opte avec la France et la Hollande pour la tempérance. L’Angleterre, la Suisse et l’Allemagne forment plutôt un bloc d’abstinents. Des études quantitatives pleuvent pour défendre chaque politique anti-alcoolique, mais sur ces années de combat entre partisans européens, la Belgique reste sur sa ligne et défend la tempérance «pour servir les enjeux économiques (et patriotiques) de sa boisson nationale: la bière», indique le duo Liénart.
Sur les pages jaunies d’un «Almanach de la jeune fille et de la femme» édité par l’Union des femmes belges contre l’alcoolisme en 1914, on lit d’ailleurs que celle-ci «ne demande à ses adhérents aucune promesse de s’abstenir de bière ou de vin. Son but est de leur faire connaître la question alcoolique; elle laisse au jugement et à la conscience de ses adhérents le soin de déterminer eux-mêmes la position qu’ils doivent prendre à ce sujet». Même si l’almanach affiche aussi des dictons anti-alcooliques moralisateurs comme «L’alcool tue les fleurs et l’enfant du buveur».
Sur le Vieux Continent, deux écoles anti-alcooliques s’affrontent alors: la tempérance d’une part – qui prône la modération – et l’abstinence de l’autre. Faut-il condamner seulement l’alcool distillé ou toute forme de boisson alcoolisée comme le vin et la bière? Dans ce débat houleux, la Belgique opte avec la France et la Hollande pour la tempérance.
Plusieurs sections locales de l’Union sont également arrangées en «cafés de tempérance» dans des bassins ouvriers, surtout à Liège. Des bars qui ne servent pas d’alcool distillé. Le quartier général de l’Union, lui, est niché en plein cœur du quartier d’Ixelles, à Bruxelles, non loin de son «restaurant hygiénique», installé au Sablon. L’établissement propose des repas (végétariens et sans alcool) à prix abordables, abrite une petite bibliothèque où l’on peut lire du Tolstoï, et permet aussi aux femmes d’assister à des conférences féministes.
Féminine mais pas féministe
Cependant, même si plusieurs figures du féminisme belge ont pris part à l’Union (comme Marie Popelin, Marie Parent, Joséphine Keelhof-Nyssens et sa nièce Marguerite Nyssens) et même si plusieurs académiques classent celle-ci parmi les premiers mouvements féministes du plat pays, l’historienne Sophie Matkava précise: «Il serait incorrect de désigner l’Union comme une association féministe. Un combat féministe et pacifiste l’a traversée jusqu’à la fin de son activité en 1951. Mais pour l’Union, si la femme peut restaurer une société mise à mal par l’alcoolisme des hommes, cette nouvelle fonction ne la détourne pas de sa vraie mission qui reste de s’occuper du foyer et de l’éducation des enfants. On ne peut pas parler d’un féminisme radical ou révolutionnaire comme on l’entend aujourd’hui.»
Si l’action de l’Union des femmes belges contre l’alcoolisme n’a pas directement influencé le cadre législatif, elle a néanmoins contribué à faire évoluer l’opinion publique. Ses membres ont milité pour le droit de vote des femmes qui n’était pas encore entériné lors de sa création. La loi Vandervelde de 1919, qui limitait la consommation d’alcool dans les milieux ouvriers en interdisant sa vente dans certains lieux, s’inscrivait dans une dynamique de sensibilisation amorcée par ces premiers mouvements. «Depuis le XXe siècle, on assiste à un intérêt croissant pour cet enjeu, conclut Sophie Matkava. Même si l’alcoolisme reste un sujet tabou, il s’est imposé comme un thème central des politiques de santé publique aujourd’hui, ce qui n’aurait certainement pas été possible sans l’action des premiers mouvements anti-alcooliques.»