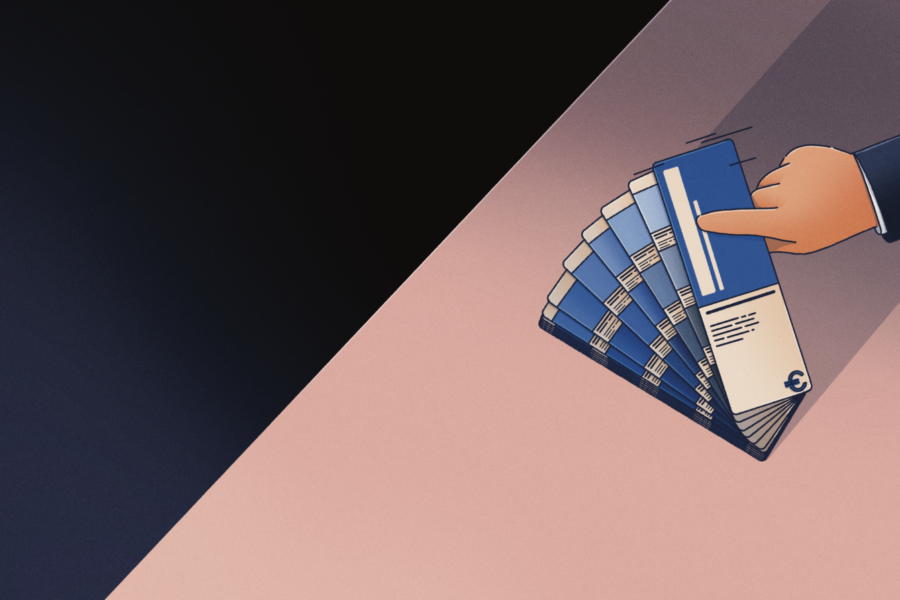Alter Échos: D’un bout à l’autre du spectre politique, il y a peu, voire pas grand monde pour vanter ouvertement les mérites du néolibéralisme. Le néolibéralisme est-il un gros mot?
Zoé Evrard: Le terme «néolibéralisme» a connu une évolution assez significative depuis sa création. C’est un néologisme créé dans les années 30 par des intellectuels qui, à l’époque, s’en revendiquent et ambitionnent de repenser le libéralisme, qui connaît alors une crise importante. Ils introduisent une rupture épistémique en disant: «Acceptons que l’État soit toujours davantage présent que ce qu’on souhaiterait, mais repensons son rôle.» Ils rompent ainsi avec un certain naturalisme libéral du «laisser-faire», qui envisageait un rôle très minimal de l’État. Le cœur du néolibéralisme, ce n’est donc pas moins d’États, mais un autre État. Un État au service des marchés, qui les protège de toute velléité d’intervention publique.
Par la suite, cet usage du néolibéralisme tombera progressivement en désuétude, notamment parce que les néolibéraux sont à l’époque relativement marginaux. Le terme est redécouvert dans les années 70, cette fois par des voix critiques des transformations néolibérales à l’œuvre notamment dans le Chili de Pinochet. Cet usage critique s’étend dans les années 80 face aux gouvernements Reagan (aux États-Unis, NDLR) et Thatcher (au Royaume-Uni, NDLR). En 2018, lors des oppositions aux mesures jugées néolibérales du gouvernement Michel, Corentin de Salle, directeur du centre d’études Jean Gol du MR, avait carrément réfuté l’existence du néolibéralisme, le qualifiant de «mystification intellectuelle». Il faut dire que l’agenda néolibéral, bien souvent, n’est pas populaire. Ses transformations sont longues et difficiles et rencontrent toujours une résistance assez importante au sein de la population.
AÉ: Vous l’avez dit, le néolibéralisme, ce n’est pas moins d’État (et de dépenses publiques), mais un État autrement. Malgré son niveau de dépenses publiques, la Belgique est donc bien engagée dans une voie néolibérale…
Damien Piron: L’enjeu n’est pas de savoir quel est le poids de l’État mais à quoi vont ses dépenses. Il y a évidemment beaucoup de dépenses sociales en Belgique, mais elles sont souvent remises en cause. On met de plus en plus l’accent sur la notion de «dépenses productives»: des politiques de relance ou de déploiement économique qui visent à stimuler la compétitivité économique de la Belgique (tax-shift, mise à disposition d’infrastructures publiques de qualité pour encourager les entreprises à s’installer en Belgique). La dépense publique n’est pas un concept univoque, elle renvoie à des réalités et des finalités distinctes.
«Il y a évidemment beaucoup de dépenses sociales en Belgique, mais elles sont souvent remises en cause. On met de plus en plus l’accent sur la notion de «dépenses productives»: des politiques de relance ou de déploiement économique qui visent à stimuler la compétitivité économique.»
Damien Piron
ZE: Et puis, le néolibéralisme peut parfois coûter cher. Par exemple, les partenariats publics-privés (PPP)…
DP: En effet. On sait qu’un PPP coûte plus cher, ça a été démontré par la Cour des comptes. Mais on en fait quand même, notamment pour des raisons de contrôle budgétaire européen. C’est une vraie redéfinition de l’État: un service public qui est géré par le secteur privé.
AÉ: Vous montrez dans votre ouvrage que la gauche a joué un rôle sinon déterminant au moins ambigu face à l’essor du néolibéralisme. Avec un tournant majeur dans les années 80 et le gouvernement de coalition entre sociaux-chrétiens et libéraux «Martens-Gol»…
ZE: C’est un moment de rupture à plusieurs égards. Le premier, c’est le type de politiques publiques menées et leur objectif principal. Avec le gouvernement Martens-Gol (Wilfried Martens est alors Premier ministre, Jean Gol, vice-Premier ministre, NDLR), on place la compétitivité au centre par rapport à d’autres objectifs poursuivis, comme le plein emploi. Jusque-là contestées, les premières mesures d’austérité sont adoptées via les pouvoirs spéciaux (gel des salaires, sauts d’indexation, premières lois sur la compétitivité…). Ces changements inédits sont placés sous l’exceptionnalité de la crise économique du début des années 80.

Le PSC (Parti social-chrétien) et le CVP (Christelijke Volkspartij) sont des partis centristes qui ont une aile «capital» et une aile «travail». La gauche du pilier social-chrétien est représentée dans le gouvernement Martens-Gol, et les politiques qu’il met en œuvre sont en partie négociées avec le monde syndical chrétien.
La question du rôle de la gauche se pose aussi avec le positionnement des socialistes, qui va profondément évoluer dans la foulée de la crise de 1980. Auparavant, ils avaient un rapport au capitalisme et un horizon de critique sociale sensiblement plus significatifs et consistants que de «simplement» vouloir protéger les plus faibles.
AÉ: De fait, en 1988, la coalition «rouge romaine» (socialistes et sociaux-chrétiens) ne renverse pas la vapeur mais confirme au contraire le tournant néolibéral de la Belgique. Quelle influence a eu le contexte européen dans ces changements?
DP: Quand le PS revient au pouvoir en 1988, on est dans la phase de négociation du traité de Maastricht, où se joue la création de l’UE et de la zone euro. Une série de réformes adoptées au tournant des années 80-90, à l’initiative notamment de Philippe Maystadt (ministre des Finances PSC entre 1988 et 1998, NDLR), accentuent la libéralisation du secteur financier de la Belgique. Ces changements sont soutenus, ou en tout cas pas contestés, par les socialistes. Le discours de l’époque est le suivant: l’horizon européen commun nous impose de remettre de l’ordre dans notre politique monétaire et budgétaire, nous n’avons pas le choix. Les privatisations se sont donc faites au nom de l’intégration européenne.
«La question du rôle de la gauche se pose aussi avec le positionnement des socialistes, qui va profondément évoluer dans la foulée de la crise de 1980. Auparavant, ils avaient un rapport au capitalisme et un horizon de critique sociale sensiblement plus significatifs et consistants que de «simplement» vouloir protéger les plus faibles.»
Zoé Evrard
AÉ: Faisons un bond dans le temps. En 2016, le PS se rebelle: Paul Magnette, alors ministre-président de la Wallonie, dit «non» au CETA, l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada. Quel bilan tirer de cette résistance aujourd’hui?
DP: Ce cas est intéressant parce que, d’une part, il met en évidence la dimension «multi-niveaux» de la Belgique. La Belgique est un État extrêmement fédéral dans le cadre duquel les entités fédérées ont de très grands domaines de compétence, notamment en politique internationale. Cela crée des leviers potentiels de contestation du néolibéralisme. Le discours de Paul Magnette contre le CETA a eu l’avantage de repolitiser le commerce international, en posant la question de ce qui s’échange, de ce qui fait partie du grand marché international, de ses limites… Question qui fait encore l’actualité aujourd’hui avec les agriculteurs.En revanche, en pratique, mis à part quelques concessions relativement mineures d’un point de vue juridique, la résistance de la Wallonie n’a pas mis fin au CETA. Il y a bien eu politisation et contestation, mais pas de renversement stratégique fondamental de la politique de commerce européenne.
AÉ: Le fédéralisme est une spécificité du néolibéralisme à la belge, dites-vous. Vous affirmez aussi que le financement des entités fédérées est sous-tendu par une logique néolibérale. Pouvez-vous expliquer en quoi?
DP: La loi spéciale de financement, qui est en quelque sorte la colonne vertébrale du financement des entités fédérées en Belgique, est votée en 1989. Elle arrive dans l’espace politique belge au même moment que ces économistes néolibéraux flamands qui transcrivent la recette du néolibéralisme aux aspects du fédéralisme en Belgique.

(c) Jean-Louis Wertz
On retrouve dans le financement des Régions la logique qu’on appelle du «juste retour», qui n’est rien d’autre que celle du «I want my money back» promue au même moment par Margaret Thatcher au niveau européen: celui qui contribue doit recevoir une partie juste de l’effort qu’il a fourni. En Belgique, c’est évidemment plus complexe que ça, parce qu’un certain nombre de contreparties sont «offertes» aux francophones – notamment la création d’un mécanisme de solidarité – mais la logique reste de dire que la Région qui crée le plus de richesses, à travers la contribution à l’impôt, va recevoir le plus de financements (une logique très favorable à la Flandre). Un autre élément, c’est la participation des entités fédérées à l’austérité budgétaire, qui est consolidée par la loi spéciale, un véhicule supra-législatif. Le dernier point, c’est le rôle important qui est confié à des instances que l’on nomme «non majoritaires» (des instances technocratiques expertales comme la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur des finances), pour définir la trajectoire budgétaire par exemple. Ce faisant, on sort ces questions du débat parlementaire.
AÉ: En Flandre, le néolibéralisme a davantage le vent en poupe, tandis qu’en Wallonie, l’adhésion y est moins assumée. Comment expliquez-vous ce clivage?
ZE: Côté flamand, le néolibéralisme se couple à un projet national. Il est ainsi affirmé et revendiqué par une frange importante des partis politiques. Le principal parti wallon, le PS, a lui un rapport plus ambigu au néolibéralisme: il met en avant des plans volontaristes mais qui ne sont pas vraiment en rupture avec le néolibéralisme.
DP: Le plan Marshall est un exemple de cette ambiguïté: il s’agit d’une mise à disposition de moyens publics importants en vue de stimuler l’économie et de repositionner la Wallonie dans la compétition internationale. On investit dans des secteurs de niche («clusters», «pôles de compétitivité») à travers des véhicules semi-publics (la Société régionale d’investissement de Wallonie, par exemple), qui agissent dans une logique d’investisseurs, attendant donc un retour sur investissement. Et qui utilisent des instruments de financement qui ne sont pas différents de ceux de fonds d’investissement privés.
On a donc un contrôle public fort et des ressources importantes, qui sont mises au service du déploiement économique et de l’entrepreneuriat privé.
AÉ: Votre ouvrage soulève une question en creux: est-il possible de résister au néolibéralisme de l’intérieur, comme a parfois tenté de le faire la gauche?
DP: On constate une mue stratégique du PS, qui adapte son programme et ses politiques publiques au contexte néolibéral. C’est une vraie refondation idéologique: le bien-être personnel passe désormais par le travail. Certes, le PS continue de mettre l’accent sur certains pans de la sécurité sociale, mais jusqu’où est-il prêt à aller dans la remise en cause de la logique néolibérale? On constate que la Wallonie réalise parfois des contournements à la marge des objectifs budgétaires, mais sans jamais remettre fondamentalement en cause la règle budgétaire…
L’une des définitions du néolibéralisme que j’affectionne, c’est «le désenchantement de la politique par l’économie»: on se prive de penser un projet politique alternatif – des transports en commun gratuits, une politique climatique ambitieuse menée par l’État… – à cause de contraintes budgétaires. Dans notre ouvrage, en décrivant la trajectoire du néolibéralisme en Belgique, nous avions envie de montrer que ce qui a été fait peut aussi être défait.
ZE: Résister au néolibéralisme, ce n’est pas plus compliqué que ce que la gauche a toujours fait, à savoir rêver, mobiliser, ouvrir l’horizon des possibles. Nous disons qu’il existe des marges de créativité car ces transformations néolibérales sont le fruit de choix politiques. C’est ce que le retour à l’histoire permet de montrer. Et en Belgique, on manque cruellement d’une littérature qui problématise le caractère politique de ces évolutions économiques.
Damien Piron et Zoé Evrard (dir.), Le(s) néolibéralisme(s) en Belgique, Cadre macroéconomique, applications sectorielles et formes de résistance, Collection «Science politique», novembre 2023.