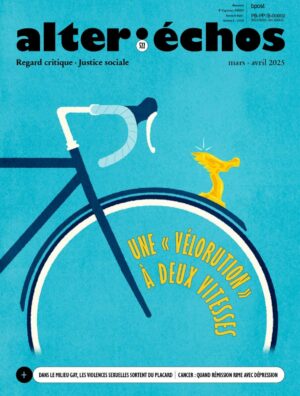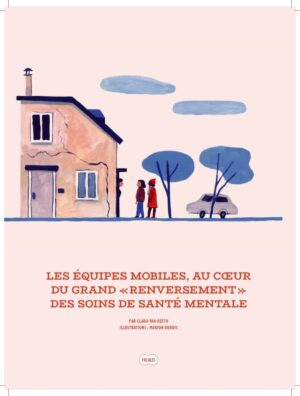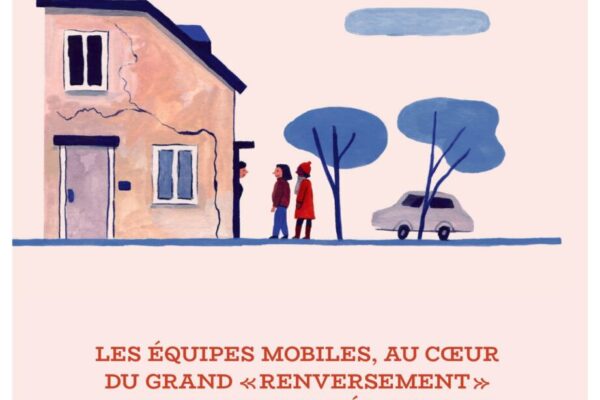Mardi 5 novembre, 20 heures, 8, rue Jardin des Olives, 1000 Bruxelles. Dans un coin de la salle: du café et des biscuits. Sur la table: des fiches plastifiées reprenant les principes du programme en 12 étapes de Narcotiques anonymes (NA). Ici, si les membres sont invités à vivre dans l’abstinence totale de toutes les drogues, y compris l’alcool, la seule condition d’adhésion est «le désir d’arrêter de consommer». Assises sur des chaises en cercle, une dizaine de personnes. Parmi le groupe autogéré, trois trentenaires, deux vingtenaires. Pendant une heure trente, à tour de rôle, chacun, chacune raconte une peine, une joie, une difficulté ou un bout de son histoire. Entre ces murs, plus que n’importe où ailleurs, on peut déposer son fracas intérieur. Alice*, 29 ans, est «clean» depuis plus de deux ans. Comme la plupart de celles et ceux présents ce soir, elle se rend au moins une fois par semaine «en réunion». Elle prend la parole: «Alice, dépendante, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je me sens un peu fragile en ce moment. Les journées raccourcissent, émotionnellement, c’est compliqué. Ça me fait du bien d’être là. Franchir cette porte il y a deux ans et demi est le plus beau cadeau que je me suis fait.»
La pandémie, amplificateur des dépendances
Quelques jours plus tard, dans un café du centre-ville, Alice revient sur son arrivée chez les NA. «J’ai commencé à boire à l’adolescence. Au début, c’était surtout festif, mais ça m’arrangeait bien de me mettre à l’envers. Au fil des années, j’ai consommé de plus en plus, j’avais envie de tester des produits. Et puis la conso’ a commencé à avoir des impacts sur ma vie sociale, sur mon travail, ma santé, mon couple. C’est devenu catastrophique, je consommais toujours à l’excès. Je ne me souvenais pas de mes soirées… Je mentais, je trompais, je manipulais.» Un jour, elle touche «son fond».
Habituée des NA depuis 30 ans, Aline observe un net rajeunissement des publics «notamment depuis la pandémie, qui a amplifié les dépendances».
Après un énième excès et un passage aux urgences, elle entre en cure dans une institution. «Un duo de bénévoles de NA est venu faire une ‘information publique’ (une présentation, NDLR). Je me suis vraiment identifiée au vécu de l’une des deux.» Alice franchit la porte d’une première réunion. «Le truc qu’on répète chez NA, c’est ‘24 h à la fois’. J’avais 27 ans, les principes m’ont petit à petit parlé, j’ai continué à revenir.» Aux côtés d’Alice, dans le café, Aline, 59 ans. Habituée des NA depuis 30 ans, elle observe un net rajeunissement des publics, «notamment depuis la pandémie, qui a amplifié les dépendances. Chez NA, il n’y a aucune obligation: on vient, on ne vient pas, on partage, on ne partage pas. Certains adhèrent directement au programme, pour d’autres cela prend plus de temps». Alice ajoute: «Faut pas prévenir, tu te pointes à une réunion, tu poses tes fesses et voilà.»
Une communication adaptée aux nouvelles générations
Ce rajeunissement s’observe aussi chez les Alcooliques anonymes (AA). Environ 200 groupes sont actifs à Bruxelles et en Wallonie. Les réunions sont organisées bénévolement pour et par des dépendants en rétablissement afin de s’entraider à rester abstinents. La version belge francophone du programme, mis sur pied en 1935 aux États-Unis, s’est d’ailleurs offert un coup de fraîcheur au niveau de sa communication. S’adapter à l’air du temps, c’est une idée de Nathalie. Dans un café nivellois, elle revient sur ce projet: «Pour moi, les AA, c’était un truc pour les vieux hommes.» C’est à 29 ans, en 2011, qu’elle pousse pour la première fois la porte d’une réunion. «Je suis arrivée, ça sentait bon le café, les gens étaient super-accueillants. Mais, effectivement, la moyenne d’âge était de 60 ans et il y avait très peu de femmes.»
Environ 200 groupes AA sont actifs à Bruxelles et en Wallonie. Les réunions sont organisées bénévolement pour et par des dépendants en rétablissement afin de s’entraider à rester abstinents. La version belge francophone du programme, mis sur pied en 1935 aux États-Unis, s’est d’ailleurs offert un coup de fraîcheur au niveau de sa communication.
Après s’être concentrée sur son abstinence, Nathalie lance une réflexion pour réaliser une brochure adaptée aux jeunes. «Il existait une version très ringarde qui ne convenait plus du tout, donc j’ai un peu milité pour qu’on évolue.» Pour créer cette brochure et des vidéos pour les réseaux sociaux, Nathalie monte alors un «groupe de travail» spécifique aux questions «jeunes». «Chacun a amené les jeunes qu’il connaissait dans les groupes. Chez AA, dès qu’on veut changer un truc, on marche sur des œufs, mais nous sommes arrivés à respecter les traditions tout en adaptant le message à nos vécus.» Résultat: un dépliant intitulé «L’alcool? T’inquiète, je gère!» avec des questions pour analyser son degré de dépendance, du style: «Est-ce que je consomme pour fuir mes études, mes problèmes à la maison ou une situation particulière?» Le tout avec un graphisme coloré, reprenant l’iconographie 3.0 des likes et smileys.
Sortir, draguer: des réalités spécifiques
Outre les aspects communicationnels, le «groupe jeunes» a mis en place des sorties spécifiquement réservées aux membres AA de moins de 40 ans. «Une fois, ça a fini en karaoké, on s’est éclatés, se souvient Nathalie. Pour les récents abstinents, c’est essentiel d’avoir un cadre hyper-sécurisé. Par peur de craquer, beaucoup se privent de vie sociale, c’est pour ça que ces moments entre nous sont importants. On devient une famille.» De son côté, NA a lancé un groupe de parole spécifique à la communauté LGBTQIA+. Non pas pour diviser mais pour ouvrir une porte supplémentaire. Lors de ces réunions, la proportion de jeunes est particulièrement élevée. «On a créé ce groupe pour une question d’identification. Dans le milieu, il y a des types de consommation différents, il y a aussi un stigma sur cette communauté», insiste Alice. Du côté des AA, si le sujet d’ouvrir des réunions spécifiques pour les jeunes fait débat, jusqu’ici, l’organisation n’a pas fait ce choix. «On se dit que c’est mieux de rester mixtes. On a besoin de l’expérience des plus vieux. Ce truc de profils variés, c’est vraiment important. Par exemple, moi, c’est en entendant une autre membre plus âgée que j’ai pu me projeter dans la réalité de devenir mère un jour.»
Le parrainage, jamais seul
Vendredi 10 janvier, 20 h 30, 26, rue de la Victoire, Saint-Gilles. Sur la table: du café, des bougies. Sur le mur: l’horaire des réunions des AA. Dans ce lieu refuge de compréhension mutuelle, le groupe lit la pensée du jour: «L’union fait la force». Point de départ de la réunion, la citation libère la parole. «Je ne pouvais pas vivre en buvant, je ne pouvais pas vivre sans boire. Ici, j’ai trouvé un lieu où je peux être qui je suis. Sans vous, je n’aurais pas pu reconstruire ma vie», explique un homme arrivé aux AA au début de sa trentaine. Dans la salle ce soir-là, une certaine joie, beaucoup d’autodérision. La force du programme: l’entraide. Et pour parvenir à une «abstinence heureuse», l’un des socles des groupes de rétablissement repose sur le parrainage. Sous le principe de la paire-aidance, les anciens dépendants soutiennent les nouveaux venus. Au bout du fil ou en face-à-face, une très grande disponibilité et une écoute sont deux clés pour éviter les craquages, les «cravings». «Moi, j’accompagne un jeune de 30 ans depuis un an. Mon rôle, c’est de l’aiguiller s’il en a besoin et de partager mon expérience. En l’écoutant, ça me fait parfois un effet miroir de ce que j’ai pu vivre, témoigne Nathalie. Il me raconte, par exemple, que les premiers ‘dates’ sans alcool, c’est super dur. Les premières relations intimes, n’en parlons même pas, il faut pouvoir se sentir à l’aise! On dit que l’alcoolisme, c’est la maladie des émotions. Quand tu es jeune, tu es là avec tes émotions et tu ne sais qu’en faire. Moi, quand j’ai arrêté de boire, je ne savais pas qui j’étais…»
La pop culture qui lève les tabous
S’il n’existe pas d’études approfondies sur le rajeunissement des publics au sein des groupes de rétablissement liés à l’alcool, partout le phénomène est observé. Quelles sont les raisons? Pour Nathalie, la réponse est la prise de conscience précoce des nouvelles générations. Aline observe une plus grande médiatisation du sujet. Les organisations, quant à elles, participent à de nombreuses «informations publiques», ce qui permet aussi d’aller toucher de nouvelles personnes. «Il y a aussi des personnalités connues qui parlent de leur dépendance», pointe Alice. C’est le cas notamment de Cara Delevingne, Daniel Radcliffe, Adèle ou Nicki Minaj. Très populaires aux USA, les réunions sont aussi le décor de nombreux films, comme récemment dans le très beau long métrage Memory, dont l’héroïne Sylvia est membre de l’organisation depuis des années. En Belgique, la série humoristique diffusée sur Tipik, «Les Anonymes», mettant en scène de jeunes comédiens, reprend les codes des réunions et les tourne en dérision… Autant d’éléments qui participent à lever les tabous et à faire évoluer les imaginaires.
«J’ai connu l’enfer, mais le fait d’avoir arrêté de boire à la fin de ma vingtaine, c’est génial, car, comme ça, j’ai pu construire ma vie: garder mon boulot, avoir un enfant. Et le fait qu’on répète ‘juste aujourd’hui, 24 h à la fois’, ça m’a apaisée aussi en tant que jeune, parce qu’au début, imaginer mon mariage, la naissance d’un enfant, tous ces éléments sans alcool, c’était hyper-angoissant», explique Nathalie. Elle rappelle aussi le nombre de ses amis qui sont morts en raison de leur dépendance: «C’est une chance immense quand on est jeune de ne pas avoir de conséquences sur notre santé.» Aline conclut: «Quand on choisit l’abstinence jeune, on a encore la vie devant soi. Et si avant, on connaissait bien le mode d’emploi pour vivre mal, chez NA on apprend à vivre bien.»
*Les prénoms ont été modifiés.
Besoin d’aide?
Alcooliques anonymes: 078/15.25.56 https://alcooliquesanonymes.be/
Narcotiques anonymes: 0476/64.30.54 https://na-belgium.org/fr/