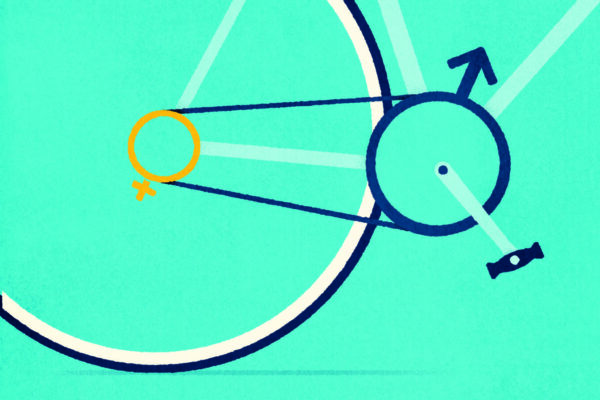L’Université des femmes organisait ce 22 mars un colloque consacré aux femmes sans toit. Avec l’ambition d’apporter un regard féministe sur la prise en charge du sans-abrisme des femmes.
Existe-t-il une féminisation du sans-abrisme bruxellois? L’idée est régulièrement avancée ces dernières années dans les discours publics. Docteure en sociologie (Université Saint Louis, Bruxelles), Marjorie Lelubre a ouvert cette journée d’étude en interrogeant et objectivant ce phénomène, à l’aune des statistiques des opérateurs bruxellois l’asile de nuit Pierre d’Angle et le Samu social, complétées par les statistiques centralisées par La Strada (son article complet ici). Si l’on regarde les chiffres du Samu social par exemple, il y a bel et bien eu une augmentation de femmes: elles sont passées entre 2002 et 2011, de 337 à 1092, avec un pourcentage relativement constant de femmes par rapport au total d’hébergés qui tourne autour des 15%. Les dénombrements de la Strada (Centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri) indiquent une augmentation de quatre femmes entre 2010 et 2014. En 2017, sur 3981 personnes dénombrées (pratiquement le double par rapport à 2008) on compte 21% de femmes, contre 24% en 2010. «Si en termes d’effectifs absolus, l’hypothèse d’une augmentation peut paraître fondée, c’est nettement moins clair en termes relatif», observe Marjorie Lelubre, pour qui «la hausse du nombre absolu de femmes sans abri (en rue et en structure d’hébergement d’urgence, NDLR) s’inscrit dans une augmentation générale de la population de sans-abri». La Strada soulignait aussi dans un rapport sur les femmes en rue publié en 2014 que,«ni les trois dénombrements de 2008, 2010 et de 2014 (les chiffres concernant les femmes étaient plus ou moins identiques), ni les chiffres du RCD 2010-2014 ne permettent réellement d’affirmer une évolution spécifique du nombre de femmes». Cela ne veut pas dire que les femmes souffrent moins du mal-logement. «Elles ont un recours plus fréquent au réseau informel, amis, famille, que les hommes», explique la chercheuse, «une stratégie qui demande beaucoup de mobilité, beaucoup d’énergie et qui peut être coûteuse pour les femmes». Ce recours au réseau informel engendre aussi un phénomène d’invisibilité des femmes sans abri.
Sans-abrisme et violences
Les femmes sont majoritaires en matière de précarité du logement, notamment du fait de leur situation de monoparentalité (plus de 2/3 des familles monoparentales sont des femmes). Les discriminations croisées (sexistes, racistes, situation sociale, familiale, etc.) les fragilisent également (lire «Mal-logement, mal féminin», 2 octobre 2017). Si des mesures ont été mises en place pour lutter contre le mal-logement au féminin, Nicolas Bernard, juriste et philosophe spécialiste en droit du logement, insiste que «sans réel outil de lutte contre les discriminations, sans mesure d’encadrement des loyers et augmentation du parc de logements sociaux, le mal-logement féminin va persister».
Évoquer la question du mal-logement «au féminin» implique nécessairement d’aborder la question de la violence à l’encontre des femmes. La violence de la rue, bien sûr. Plusieurs intervenantes ont souligné le danger de la rue pour les femmes, notamment les violences sexuelles, et les stratégies déployées par celles-ci pour s’en protéger. Les femmes sans abri ont parfois tendance à nier, dissimuler leur féminité, ce qui concourt aussi à les invisibiliser.
La violence conjugale a également un impact sur le logement des femmes. «Il y a un lien substantiel entre violence entre partenaire et/ou intra-familiale et précarité», a souligné la ministre Céline Frémault, lors de la table ronde politique de clôture de cette journée. «Une femme sur deux hébergée dans notre maison d’accueil a été victime de violence», a rapporté Josiane Coruzzi, directrice de l’asbl Solidarité femmes et Refuge pour femmes victimes de violences.
«Une femme victime de violences conjugales n’est pas une personne sans domicile fixe ou sans solution d’hébergement, mais une personne en danger dans sa résidence, explique la travailleuse de terrain, ces femmes font de longs séjours en maison d’hébergement, le temps de trouver un autre logement pour ne pas remettre les pieds dans le domicile familial, peu sûre et lourd de mauvais souvenirs». Et de souligner qu’elles retrouvent relativement vite un logement social, entre 3 et 9 mois grâce au mécanisme d’attribution préférentielle en vigueur en Wallonie qui, en donnant des points supplémentaires aux femmes victimes de violence conjugale, les rend prioritaires sur la liste d’attente du logement social. Josiane Coruzzi tempère toutefois, «ce n’est pas non plus la panacée de se voir «attribuer» un logement, sans pouvoir le choisir». À Bruxelles, il existe aussi un mécanisme pour faciliter et accélérer le relogement des victimes de violences conjugales. Il est depuis 2016 obligatoire que 3% des logements sociaux soient réservés aux femmes prêtes à quitter la maison d’accueil. 43 places ont ainsi été dégagées en 2017.
La double peine des femmes migrantes
Les situations de violences et de mal-logement sont décuplées pour les femmes migrantes, soit en procédure de regroupement familial ou sans papiers. Des femmes invisibles et sous-protégées. Selma Benkhelifa, avocate à Progress Lawyers Network, rappelle que loi sur le regroupement familial prévoit que la personne étrangère reste 5 ans avec le conjoint pour obtenir le droit de séjour individuel. Pour les cas de violences, certaines clauses de protection existent: la victime, quand elle veut quitter le domicile doit prévenir l’Office des étrangers, déposer plainte à la police avec certificat médical (seules les violences physiques et sexuelles sont prises en compte). En outre, pour partir, la personne doit bénéficier de ressources suffisantes. «C’est totalement aberrant quand on sait que les migrantes n’ont en général pas ou peu de réseau social en général pas de travail dans le cas de violences conjugales», dénonce l’avocate. «C’est une situation facile pour les hommes violents qui ont le droit et l’État de leur côté. Les femmes, elles, si elles veulent partir risquent de perdre leur toit et leurs papiers et donc de se retrouver à la rue sans protection», observe-t-elle.
Sans-abrisme et prostitution
Autres victimes de premier plan dans le mal-logement: les femmes prostituées. «Le loyer est une dépense prioritaire pour les femmes. La prostitution peut donc constituer chez certaines une alternative à la rue», avance Ariane Dierickx, directrice de l’Îlot. La présidente d’Isala, ASBL de soutien aux personnes prostituées, confirme le lien extrêmement ténu entre prostitution et logement précaire. «Chaque femme prostituée doit payer un loyer de 250 euros par jour pour se prostituer, ça fait 7500 euros par mois, soit environ 150 clients. Et elle n’a encore rien payé de son loyer personnel», explique Pierrette Pape, les femmes prostituées et les victimes de traite sont donc bien souvent mal-logées, et en changement constant de logement». «On ne peut pas dissocier la lutte contre le sans-abrisme et celle contre le système prostitutionnel et ça n’est pas un hasard si ce dernier est si clivant», conclut la directrice de l’Îlot.
Prise en charge sur le terrain
«Le secteur de l’aide aux personnes sans abri, comme tous les autres d’ailleurs, peine encore à développer une approche féministe», constate Ariane Dierickx. Développer une approche féministe passe par une prise en charge adaptée aux femmes. «Mais il est nécessaire aussi de tenir compte des femmes quand on s’occupe du public sans-abri masculin», souligne-t-elle. Et d’illustrer: «On fait de l’accompagnement des hommes sans abri en oubliant qu’ils sont pères. Par exemple, on s’assure leur insolvabilité en cas de dettes afin qu’ils aient un logement sans se poser la question du payement de la pension alimentaire à la mère en charge des enfants, qui risque, elle aussi de tomber dans la précarité».
Comment améliorer sur le terrain la prise en charge des femmes qui ont à vivre l’expérience du sans-abrisme? Des formations aux travailleurs et travailleuses de terrain, des structures plus adaptées aux femmes, qui respectent leur intimité et leur autonomie (à l’instar de la Maison Rue Verte), des dispositifs d’accueil à long terme au lieu de l’urgence, des moyens financiers et des politiques structurelles, l’individualisation des droits sociaux en tête (lire «L’individualisation des droits sociaux, le retour d’un vieux débat», 27 février 2018), font partie des pistes avancées durant cette journée d’étude.