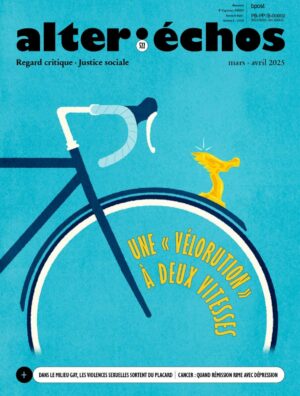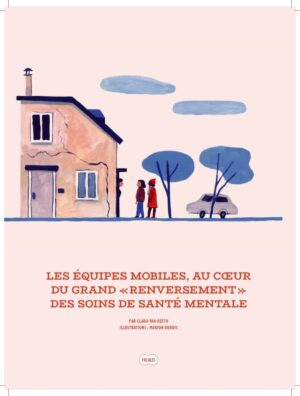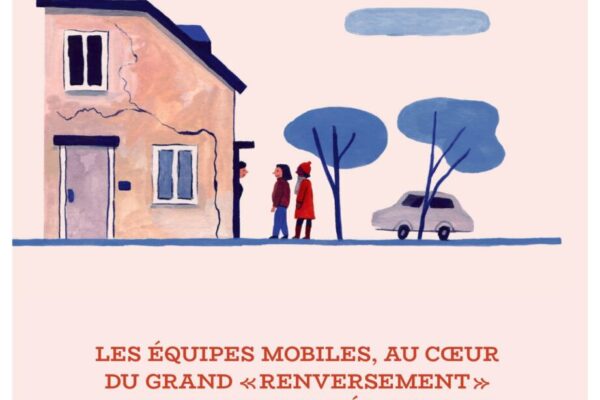Alter Échos: En tant qu’ancienne coprésidente d’Écolo, comment analysez-vous les récentes défaites électorales du parti en Wallonie et à Bruxelles?
Sarah Turine: En quittant la politique pour m’impliquer dans la société civile, j’ai réalisé à quel point les élus étaient déconnectés du reste du monde. Même si on essaye de faire du terrain, on est quand même en contact avec un public qui est a priori intéressé par la chose politique. Et quelque part, c’est sur ce public acquis qu’on se base pour communiquer et vérifier que nos positions sont comprises. Ensuite, Écolo a perdu des électeurs militants, car le parti s’est senti obligé de montrer qu’il était un parti aussi raisonnable que les autres. Ces dernières années, d’élections en élections, au moment où il a fallu former un gouvernement fédéral, où il a fallu «sauver la Belgique» en quelque sorte, Écolo est entré dans des négociations, même quand le rapport de force n’était pas en sa faveur, ce qui a signifié faire de sérieux compromis. Selon moi, les écologistes ne sont pas là pour sauver la Belgique, mais pour porter en avant des questions environnementales et de justice sociale. J’ai ressenti beaucoup de colère et de déception du secteur associatif à la suite de l’entrée d’Écolo dans le gouvernement fédéral sous la coalition Vivaldi.
AÉ: D’après vous, Écolo propose-t-il encore un programme de transformation profonde de la société?
ST: De là où je suis, j’ai la sensation qu’il n’est plus considéré comme un parti alternatif vers lequel se tourner quand on se méfie des partis traditionnels. Je fais partie de celles et ceux qui pensent qu’Écolo n’est pas assez radical dans sa volonté de transformation de la société. Y remet-on encore en question le système capitaliste et ultralibéral? Tout cela entraîne une lassitude dans la population. On est sans cesse tiraillés entre l’espoir du grand soir et le changement par petites touches. Mais la politique des petits pas, ça ne marche que si on reste très longtemps au pouvoir. En y étant seulement de temps en temps, on obtient des résultats qui ne sont pas satisfaisants et on perd en crédibilité.
En quittant la politique pour m’impliquer dans la société civile, j’ai réalisé à quel point les élus étaient déconnectés du reste du monde. Même si on essaye de faire du terrain, on est quand même en contact avec un public qui est a priori intéressé par la chose politique. Et quelque part, c’est sur ce public acquis qu’on se base pour communiquer et vérifier que nos positions sont comprises.
AÉ: Il existe des dissensions au sein du parti écologiste concernant les questions de laïcité. Pensez-vous que ce débat a contribué aux défaites d’Écolo dans les urnes?
ST: D’après moi, oui. Ce sont des questions compliquées parce qu’elles sont émotionnelles et qu’il s’agit d’une grille de lecture supplémentaire. Avec les enjeux de laïcité, ce n’est plus simplement l’axe «gauche-droite» ou «progressiste-conservateur» qui compte. Ce n’est pas nécessairement parce qu’on se dit laïc qu’on est progressiste, et ce n’est pas parce qu’on se dit non laïc qu’on est nécessairement conservateur. Tous les partis, de gauche comme de droite, sont traversés par cette division. Écolo a perdu des voix non seulement chez les défenseurs d’une laïcité «à la française», mais aussi chez les tenants d’une laïcité plus inclusive.
AÉ: Quelle est votre conception de la laïcité?
ST: Je défends une laïcité inclusive. Penser que la foi est uniquement liée à la vie privée est une erreur, parce que cela voudrait dire qu’on veut la cacher. Mais ce n’est pas parce qu’elle est cachée qu’elle n’intervient pas sur qui on est. C’est même presque plus rassurant d’avoir cette transparence, au moins on sait d’où la personne parle. Personnellement, je n’ai aucun souci à ce que quelqu’un porte un signe convictionnel, même dans la fonction publique. Ça se fait dans les pays anglo-saxons. Sont-ils pour autant plus soumis à un retour du religieux dans les prises de décisions? Je n’en suis pas sûre.
On est sans cesse tiraillés entre l’espoir du grand soir et le changement par petites touches. Mais la politique des petits pas, ça ne marche que si on reste très longtemps au pouvoir. En y étant seulement de temps en temps, on obtient des résultats qui ne sont pas satisfaisants et on perd en crédibilité.
AÉ: Vous ne pensez pas que cela peut pousser des gens à adhérer à des courants religieux rigoristes?
ST: Au contraire. Parlons clairement de l’islam puisque c’est cette religion qui, aujourd’hui, fait peur. Et ce, depuis les attentats du 11 septembre, et plus récemment chez nous en 2016. Il y a des craintes au sein de la population et elles sont légitimes, mais je suis persuadée que si certaines personnes ont radicalisé leur adhésion identitaire à la religion, c’est parce qu’une part de leur identité a été menacée et non reconnue par la société dans laquelle elles vivent. C’est ainsi qu’émerge un terreau social et culturel où les questions identitaires peuvent se nourrir de radicalisme.
AÉ: Dans le contexte scolaire, notamment à Bruxelles, le dialogue interculturel et interreligieux semble de plus en plus compliqué…
ST: Oui, il faut rester attentifs à ce qui se passe dans les écoles où des professeurs tirent la sonnette d’alarme, car ils ne savent plus comment discuter de la religion, entre autres sujets, en cours. Je pense qu’il faut outiller les enseignants, via des formations par exemple, pour que le débat puisse avoir lieu. Je me souviens d’une maman marocaine, musulmane et voilée, qui était venue me voir quand j’étais échevine à Molenbeek. Elle me disait regretter que l’école de sa fille autorise le foulard, car au fil du temps, elle avait vu son enfant se transformer. Elle a commencé à porter le voile, puis à s’habiller tout en noir et elle a fini par s’interdire d’écouter de la musique. Certes, à l’adolescence, on teste la question de l’absolu. Le problème, c’est qu’avec la religion, ce côté absolu fait qu’un autre avis que le sien est tout de suite vu comme blasphématoire. Ça, c’est dangereux.
Je défends une laïcité inclusive. Penser que la foi est uniquement liée à la vie privée est une erreur, parce que cela voudrait dire qu’on veut la cacher. Mais ce n’est pas parce qu’elle est cachée qu’elle n’intervient pas sur qui on est. C’est même presque plus rassurant d’avoir cette transparence, au moins on sait d’où la personne parle.
AÉ: Quelles sont les conditions d’émergence de la tolérance?
ST: Quand on reste entre soi, on se fait des films sur qui est l’autre. C’est vrai pour nous toutes et tous, alors que le monde est multiple et qu’on peut se trouver des points communs avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Voilà la tolérance. Mais c’est sûr que l’entre-soi, c’est notre zone de confort. À mes yeux, plus tôt on provoque la rencontre, plus tôt l’altérité fera partie de notre zone de confort.
AÉ: Quand vous êtes arrivée à la direction du centre Fedasil de Mouscron, en 2019, il venait d’ouvrir ses portes. Ensuite, il a grandi très fort, très vite. Comment s’est passé le dialogue avec les riverains du quartier?
ST: Nous avons dû apprendre à les rassurer et à atténuer les nuisances. Aujourd’hui, le centre fait vraiment partie du quartier. Certains se sont résignés, d’autres ont gardé un sentiment d’insécurité, même si les chiffres montrent que ce n’est pas justifié. Après, je peux comprendre qu’on ait peur quand on ne connaît pas le public qui fréquente le lieu, qu’on voit parfois la police intervenir, qu’il y a plus de bruit qu’avant, etc. Il était important pour nous de respecter les riverains dans ce qu’ils étaient, même si certains tenaient des propos offensants, voire pires. Cela n’aurait servi à rien d’entrer dans un débat idéologique et de les renvoyer à leurs propos d’extrême droite parce qu’alors, on aurait refermé le dialogue.
AÉ: Après six ans à la tête de cette institution, quels sont les enseignements principaux que vous tirez?
ST: Je suis assez engagée depuis toujours, mais je pense que c’est le boulot où je me suis sentie le plus utile au quotidien. En tant que directrice, je devais gérer l’équipe, mais j’ai aussi été en contact avec les résidents. L’expérience a été extrêmement riche. Être une oreille pour eux, même si je n’ai aucun impact sur la décision, a été gratifiant. L’autre enseignement, c’est qu’il y a bien une violence institutionnelle envers des personnes qui vivent des choses très difficiles.
AÉ: Une violence à laquelle Fedasil participe également?
ST: Je pense que toutes les institutions publiques, étant donné leur structure, leur organisation, leurs moyens, dégagent une certaine forme de violence. Si on adopte une approche strictement égalitariste, cela peut mener à une forme de violence parce que chacun peut se dire qu’on ne tient pas compte de sa spécificité. Bien sûr, nous sommes les garants de l’État de droit, que l’on soit en accord avec la loi ou non. Mais chez Fedasil, nous ne sommes pas de simples fonctionnaires. Il est important que nos travailleurs portent des valeurs sociales fortes. Sans ça, la violence institutionnelle serait encore plus forte.
Je suis assez engagée depuis toujours, mais je pense que c’est le boulot où je me suis sentie le plus utile au quotidien. En tant que directrice, je devais gérer l’équipe, mais j’ai aussi été en contact avec les résidents. L’expérience a été extrêmement riche.
AÉ: Quel regard posez-vous sur la politique migratoire et l’accueil des exilés en Belgique?
ST: C’est devenu un sujet trop politique où on n’écoute pas assez la voix des experts sur la question de l’immigration, qui démontrent que ce n’est pas en fermant les frontières qu’on a un impact sur les flux migratoires. Tout simplement parce qu’il y a un besoin légitime pour ces gens de bouger, que ce soit pour des raisons économiques, de sécurité, de santé et maintenant, environnementales. En fermant les frontières, on crée des filières parfois criminelles et une souffrance qui complique encore l’accueil des exilés.
AÉ: Vous ne comptez pas retourner en politique, mais bien ouvrir un café créatif. C’est une autre voie pour s’engager?
ST: Je le vois vraiment comme un projet à la dimension sociale forte: les personnes pourront venir boire un verre, mais aussi découvrir l’artisanat autour de la laine comme moyen de se ressourcer et de valoriser l’économie collaborative. Si je le fais à Ath et pas dans mon village, c’est pour être dans un centre-ville et toucher des gens différents. Je pense qu’on est de plus en plus nombreux à se dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société, sans savoir quoi exactement. J’ai envie qu’on puisse entrer dans mon café pour boire un verre, et que ça déclenche un déclic sur le fait de vivre différemment. Pour moi, prôner un autre modèle de société est aussi une manière de contribuer au débat démocratique. Ce n’est pas parce que je deviens indépendante que je vais voter MR ou ne penser qu’à moi.
En fermant les frontières, on crée des filières parfois criminelles et une souffrance qui complique encore l’accueil des exilés.
AÉ: Vous n’êtes donc pas dégoûtée de la politique?
ST: Absolument pas! Je pense en revanche qu’on ne doit pas rester trop longtemps en politique parce que personne n’est à l’abri de faire passer ses intérêts privés avant l’intérêt commun. Plus on y reste, plus on a l’impression qu’on ne sait plus rien faire d’autre, et qu’on doit absolument être réélu pour continuer à vivre. Parfois, je sens le virus de la politique revenir, puis je me rappelle que j’ai fait ma part et que d’autres doivent y aller. Pas parce que j’en ai marre, mais parce que le pouvoir doit circuler. C’est pour cette raison que je crois beaucoup au collectif.