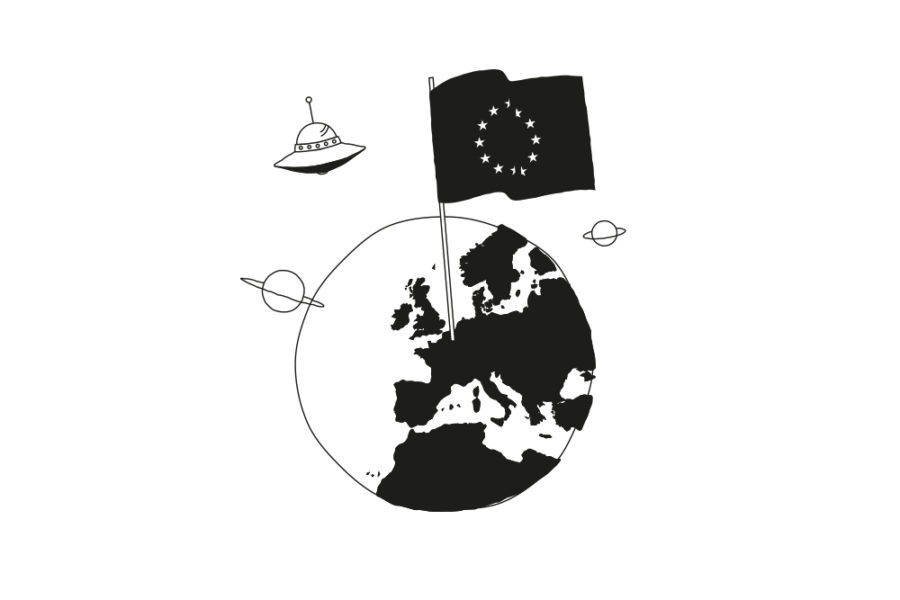«Si j’ai l’air énervée, c’est parce que je le suis!» Fin février, au Parlement européen, l’eurodéputée néerlandaise Lara Wolters n’a pas caché son désarroi alors que les États membres de l’Union européenne (UE) venaient d’envoyer droit dans le mur le texte qu’elle avait durement négocié durant des mois, concernant le «devoir de vigilance» des entreprises. Le texte pour lequel la socialiste avait déployé une énergie monstre. Le texte qui devait sonner la fin de l’impunité pour les Nike, Zara et autres grands noms aux méthodes de production souvent douteuses. Et décriées.
L’objectif de ce texte est d’obliger les entreprises à surveiller l’impact de leurs activités sur les droits humains et sur l’environnement, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, l’esclavage, l’exploitation du travail, la pollution, la déforestation, la consommation excessive d’eau ou les dommages causés aux écosystèmes. Concrètement, le but de cette législation est de rendre juridiquement responsables les entreprises en cas de violations de ces droits humains et sociaux et de dommages environnementaux sur l’ensemble de la chaîne de production (c’est-à-dire aussi si un fournisseur ou un partenaire en amont ou en aval – pour la distribution ou le recyclage par exemple – ne se comporte pas correctement). La proposition de la Commission européenne en la matière remonte à février 2022.
Tout avait pourtant bien commencé, et la présidence belge du Conseil de l’UE, aux manettes jusqu’à la fin du mois de juin, pensait qu’elle pourrait sans mal accrocher ce trophée à son tableau de chasse. Le processus législatif européen avait en effet suivi son cours, la proposition ayant d’abord été négociée en interne par chaque institution de son côté, Parlement européen et États membres au sein du Conseil de l’UE, afin qu’elles établissent chacune leur position de négociation. Celles-ci ont ensuite servi de base pour des négociations interinstitutionnelles (entre Parlement et Conseil), durant la phase des «trilogues». Un accord entre les institutions a finalement pu être trouvé au mois de décembre dernier. Il ne restait alors plus qu’une seule étape : la validation de cet «accord politique provisoire» par les députés et par les États européens afin que ceux-ci puissent vérifier que le texte de l’accord ne s’éloignait pas trop des positions de négociation initiales.
Et c’est là que tout a dérapé, au grand dam de la présidence belge. L’enceinte dans laquelle tout s’est passé s’appelle le «Coreper», un de ces drôles d’acronymes dont l’Europe est friande et qui cache en fait un haut lieu de pouvoir, où se jouent les plus fortes batailles d’ego. Ce «Coreper» rassemble chaque semaine 27 ambassadeurs nationaux (beaucoup d’hommes, quelques femmes) auprès de l’UE. Et c’est par son biais que les Etats étaient censés valider l’accord politique provisoire. Pour cela, il fallait que 55% des États membres expriment un vote favorable et que l’accord soit soutenu par des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l’UE. Or l’Allemagne s’est opposée au texte, et l’Italie et la France, entre autres, lui ont emboîté le pas, invoquant des motifs variés allant de «l’incertitude légale» que provoquerait la nouvelle législation au «fardeau administratif» qu’elle représenterait, en passant par «la crainte de conditions inégales de concurrence à l’échelle globale». Résultat: le train législatif a déraillé. Et la présidence belge a dû se rendre à l’évidence: avant la fin de son mandat, le 30 juin, il sera, sauf coup de théâtre, impossible de parvenir à un accord sur cette législation.
«C’est un très mauvais signal que l’on envoie là, un signal selon lequel l’UE considère que les droits humains sur la planète sont moins importants que de faire du business», soupire l’eurodéputé français Pascal Durand (Renaissance), fustigeant des États membres qui «sont dans une logique de destruction de tout ce qui pourrait créer des contraintes pour les entreprises, qui veulent déréguler au maximum, là où il y a quelque temps encore, ils considéraient que ce n’était pas une contrainte, mais une opportunité de pouvoir avoir des informations plus précises concernant les chaînes de valeurs ou les droits humains».
La dégringolade
Ce texte n’est pas le seul avec lequel la présidence belge du Conseil de l’UE est à la peine. Il en va de même pour la directive sur les «travailleurs des plateformes numériques». Son sort a été tranché par les ministres européens au sein du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» le lundi 11 mars. Mais là non plus, rien ne laissait présager que ce texte crucial en vue de continuer à bâtir «l’Europe sociale» doive «remonter» au plus haut niveau politique. Et là encore, c’est sous présidence belge et au «Coreper» que tout est allé de travers.
Cette directive prévoit en effet que les personnes travaillant par l’intermédiaire de plateformes (comme Uber, Bolt, Deliveroo et bien d’autres) se voient accorder le statut professionnel légal correspondant à leurs modalités de travail réelles. En d’autres termes, si un indépendant travaille sans cesse pour la même plateforme, qu’il effectue le travail d’un salarié, alors il doit pouvoir jouir de ce statut – qui ouvre aussi d’autres droits comme des congés payés ou une cotisation pour la retraite. L’enjeu est de taille, car ces «travailleurs des plateformes» sont actuellement 28 millions dans l’UE, et devraient être quelque 43 millions d’ici à 2025, selon la Commission européenne. Aujourd’hui, pas moins de 5,5 millions d’entre eux seraient «erronément qualifiés de travailleurs indépendants».
Mi-décembre, les colégislateurs (Conseil de l’UE et Parlement européen) avaient réussi à accorder leurs violons sur le texte. Mais, dans la foulée, le cénacle des ambassadeurs auprès de l’UE n’a pas soutenu cet accord, qui prévoyait l’introduction d’une «présomption de relation de travail» dès lors que deux indicateurs de contrôle ou de direction étaient réunis (sur cinq au total). Les cinq critères envisagés étaient les suivants: premièrement, l’existence de plafonds applicables à la rémunération que les travailleurs peuvent percevoir, deuxièmement, la supervision de l’exécution de leur travail, y compris par des moyens électroniques, troisièmement, le contrôle de la répartition ou de l’attribution des tâches, quatrièmement, le contrôle des conditions de travail et la limitation de la latitude de choisir son horaire de travail et, cinquièmement, des limitations de la liberté d’organiser son travail et règles en matière d’apparence ou de conduite.
«C’est un très mauvais signal que l’on envoie là, un signal selon lequel l’UE considère que les droits humains sur la planète sont moins importants que de faire du business.»
Pascal Durand, eurodéputé
Dans la foulée, en fin d’année dernière (encore sous présidence espagnole du Conseil de l’UE), les États de l’UE ont rejeté le texte négocié de haute lutte avec le Parlement européen, refusant finalement l’approche reposant sur ces cinq critères. Puis Madrid a passé le flambeau à Bruxelles, obligeant la nouvelle présidence du Conseil de l’UE à rédiger au débotté une nouvelle proposition de compromis, en espérant qu’elle recueille le soutien nécessaire pour débloquer les travaux. En vain. Le 16 février, la France, l’Allemagne, l’Estonie et la Grèce ont formé une minorité de blocage, refusant de soutenir la nouvelle mouture d’accord sur la table. Pour la présidence belge, c’est la dégringolade: elle avait fait de ce texte l’un des fers de lance de son semestre à la tête du Conseil de l’UE. Elle a rattrapé le coup comme elle a pu, en défendant un texte vidé de sa substance, au niveau d’ambition finalement très réduit: dans la mouture finale qui a fait l’objet d’un accord en mars, l’hypothèse d’une présomption de salariat pour tous les travailleurs qui avait un temps été imaginée à l’échelon européen a été abandonnée: cette présomption ne sera mise en place qu’à l’échelon national. La différence est de taille puisque la législation restera fragmentée sur le Vieux continent.
Des mots au lieu des actions
À défaut d’action, en ne parvenant pas à placer sa présidence sur le signe de l’Europe sociale en ne réussissant pas à réunir les conditions nécessaires pour faire aboutir des législations cruciales comme le «devoir de vigilance» ou la directive sur les «travailleurs des plateformes», la Belgique a misé sur les mots, les promesses. Fin janvier, au château de Val Duchesse, au sud de Bruxelles, la présidence belge du Conseil de l’UE, la Commission européenne et leurs «partenaires sociaux» (comprendre: les organisations qui regroupent les syndicats ou le patronat, entre autres) ont signé une pompeuse «déclaration tripartite pour un dialogue social européen fructueux».
Rédigée 39 ans après le premier sommet de ce genre, convoqué au même endroit par l’ancien président de la Commission Jacques Delors, cette déclaration n’a pour autant rien de révolutionnaire. Elle vise notamment à renouveler «l’engagement à renforcer le dialogue social au niveau de l’UE». Les éléments les plus concrets ont trait au problème de la pénurie de main-d’œuvre et de compétences, qui, selon les signataires, «entrave la croissance durable». La Commission européenne a promis un plan d’action afin de s’attaquer à cette problématique d’ici au printemps 2024. La mise en place d’un «envoyé pour le dialogue social européen» et le lancement d’un «Pacte pour le dialogue social européen» ont aussi été évoqués. La Belgique s’en est félicitée. Mais, pour l’heure, derrière ces grandes promesses ronflantes, aucune action n’a suivi.
Il faut toutefois garder à l’esprit que la présidence belge du Conseil de l’UE intervient dans un contexte particulier, qui est loin d’être aisé: la dernière ligne droite avant les élections européennes qui seront organisées du 6 au 9 juin partout sur le Vieux Continent (en parallèle des élections fédérales belges). Tous les sujets, même les plus consensuels, revêtent soudain un potentiel inflammable, et les gouvernements européens rechignent à prendre des décisions fortes, craignant de froisser les électeurs. Dès lors, la Belgique semble avoir choisi une stratégie prudente: poursuivre, sans brusquer, les réflexions autour des «défis sociaux» auxquels l’UE fait face. Une réunion consacrée à ce thème sera organisée à La Hulpe mi-avril. Afin de réfléchir, donc, en attendant, un jour peut-être, d’agir.