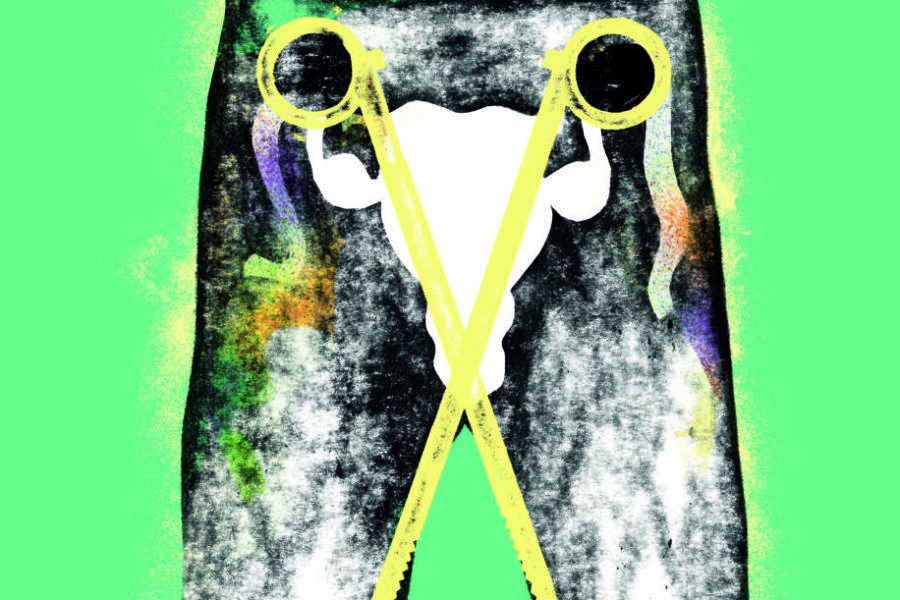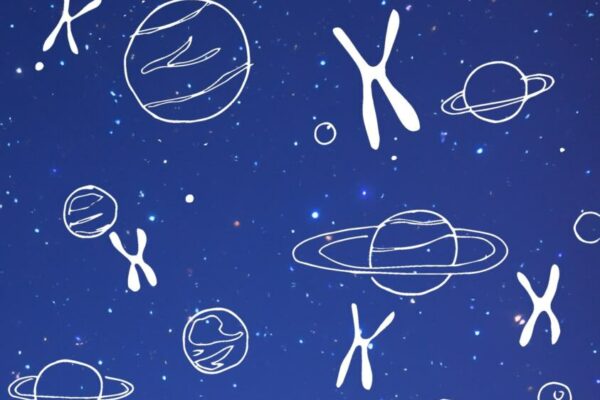Des rires s’échappent en sourdine de la pièce d’à côté. Un groupe de femmes en sort, qui s’échangent encore quelques taquineries avant de s’asseoir en cercle autour d’une table basse, sur laquelle l’une d’elles a déposé un Thermos de café et quelques biscuits. L’ambiance est bon enfant. Elle ne laisse en tout cas pas présager du sujet qui les rassemble, ce mardi après-midi, dans les bureaux namurois du mouvement «Personne d’abord», une association de personnes avec déficience intellectuelle qui militent pour leur autodétermination.
Seule Natacha, droite comme un «i» sur sa chaise, détourne le regard du groupe, ses yeux comme absorbés par la fenêtre. Quand vient son tour de parler, son visage se contracte, sa bouche se pince. Aucun mot ne sort. «Elle est très émotive», expliquent ses acolytes.
La jeune femme finit par articuler: «Un jour, ma mère m’a emmenée chez la gynécologue et lui a dit: ‘Il faut lui ligaturer les trompes.’» Natacha a alors 23 ans, est déjà sous contraceptif hormonal et vient d’intégrer un centre d’hébergement pour personnes en situation de handicap où elle a rencontré un garçon, ce que sa mère ne voit visiblement pas d’un bon œil. Quinze ans plus tard, entre deux sanglots, elle confie: «Aujourd’hui je m’en veux de ne pas m’être plus imposée… J’ai pris conscience il y a deux ans de mon souhait d’avoir un enfant. Mais je n’en ai jamais parlé.»
«Un jour, ma mère emmenée chez la gynécologue et lui a dit: ‘Il faut lui ligaturer les trompes.’»
Natacha, victime de stérilisation forcée
À ses côtés, Gaëlle, elle, a toujours su qu’elle voulait des enfants. À la vingtaine, la jeune femme «tombait souvent amoureuse», ce qui rendait ses parents «très fâchés». Jusqu’au jour où ils décident de lui «mettre des clips» – une technique de ligature des trompes de Fallope. «On me l’a expliqué, mais je n’étais pas très d’accord, témoigne la femme aujourd’hui âgée de 44 ans dans une diction laborieuse. On m’a dit que je n’étais soi-disant pas capable d’élever un enfant. Pourtant c’était mon souhait d’avoir des enfants, je n’ai même pas pu le dire. Après l’opération, j’étais très mal dans ma peau. Je n’étais plus vraiment là.»
Un «paternalisme énorme»
C’était en 2003, une époque pas si lointaine où les stérilisations de femmes en situation de handicap (le plus souvent mental) étaient, sinon courantes, du moins pas rares en Belgique. Généralement sans consentement, parfois même sans avertissement comme au détour d’une simple opération de l’appendicite. Taboues, la pratique et son ampleur sont impossibles à objectiver. D’autant qu’en matière de chiffres et de handicap, c’est un peu le «no man’s land»: les indicateurs manquent et, quand ils existent, ils diffèrent souvent d’une région à l’autre. Une seule étude, réalisée par trois médecins des cliniques universitaires Saint-Luc, révélait en 2004 que les femmes en situation de handicap mental et accueillies dans des institutions étaient trois fois plus stérilisées que la population générale (22% contre 7%) en Wallonie et à Bruxelles.
Mais neuf ans plus tard, le vent tourne. Avec sa loi du 17 mars 2013, la Belgique réforme ses systèmes d’incapacité juridique, faisant disparaître les statuts de «minorité prolongée» (sous lesquels la personne était considérée comme un enfant de moins de 15 ans aux yeux de la loi) et «d’interdiction judiciaire» (pour les personnes jugées inaptes à se gouverner et à administrer leurs biens) jusque-là conférés aux personnes handicapées dépendantes. Des statuts qui témoignaient d’«un paternalisme énorme, décrypte Baudouin Pourtois, juriste au sein du service résidentiel «La Pommeraie» et spécialiste des questions de handicap et de droits sexuels et reproductifs. En matière de stérilisations et de contraceptions, cela a permis qu’on décide pendant longtemps à la place des résidentes d’institutions».
Une seule étude, réalisée par trois médecins des cliniques universitaires Saint-Luc, révélait en 2004 que les femmes en situation de handicap mental et accueillies dans des institutions étaient trois fois plus stérilisées que la population générale (22% contre 7%) en Wallonie et à Bruxelles.
En lieu et place de ces statuts révolus, un nouveau régime de protection fait son entrée: l’administration de biens et/ou de la personne, confiée le plus souvent à un proche. En sus, l’article 492 du Code civil précise une série d’actes considérés comme «intimement personnels» pour lesquels la personne handicapée ne peut, sous aucun prétexte, être représentée ou assistée. «La stérilisation fait partie des points cités. C’est donc clairement précisé par le législateur: il est aujourd’hui impossible qu’une personne décide d’une stérilisation pour une autre», appuie le juriste.
Nul n’est censé ignorer la loi…
La Belgique fait ainsi partie de la poignée (neuf) de pays membres de l’Union européenne (UE) ayant rendu illégales les stérilisations non consenties sur des personnes handicapées. Bien qu’elle contrevienne à plusieurs conventions internationales, la pratique reste autorisée pour certains handicaps dans 14 pays de l’UE, selon le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), qui regroupe des associations de personnes handicapées en Europe – les informations étant indisponibles pour les quatre États membres restants. Après avoir adopté en décembre dernier un rapport sur l’égalité d’accès aux droits des personnes handicapées dans lequel il dénonce notamment la stérilisation des personnes avec déficience mentale, le Parlement européen débat, au moment où nous écrivons ces lignes, sur la possibilité d’interdire cette pratique dans tous les États membres.
Mais même en Belgique, «il y a la théorie et la pratique, et on sait que des médecins passent outre à ces dispositions légales, souvent sous l’influence de parents qui craignent une grossesse pour leur enfant», poursuit Baudouin Pourtois.
Dans un rapport consacré aux stérilisations forcées datant de septembre 2022, le FEPH pointait ainsi qu’en Belgique, «des asbl expriment leur inquiétude quant au fait que des femmes en situation de handicap, en particulier dans le cas de déficience mentale, sont encore sujettes à des stérilisations forcées».
En cause notamment, un manque d’information. Tant du côté des familles, rarement mises au courant des implications légales du changement de statut de 2013, que du côté des médecins. Carte sur table, le gynécologue Yannick Manigart, chef de clinique au CHU Saint-Pierre, admet être tombé de sa chaise lors d’un colloque récemment organisé par la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF) lors duquel Baudouin Pourtois présentait la législation en vigueur: «Avec mes collègues médecins, on s’est rendu compte que la loi ne permettait pas de stériliser une personne incapable de donner son accord et qu’on se retrouvait de facto dans des situations qui flirtaient avec la légalité», explique le gynécologue.
«Le pourcentage de femmes contraceptées dans les institutions est beaucoup plus élevé qu’au sein de la population.»
Noémie Schonker, chargée de mission «précarités et handicaps» à la FLCPF.
En contact fréquent avec des parents souvent âgés et qui, après une vie de sacrifice au service de leur enfant handicapé, craignent de devoir assumer la charge d’un bébé, le médecin juge la loi actuelle «trop stricte»: «Je me mets à la place des parents. Mais aussi à la place de ces femmes qui risquent de tomber enceintes sans comprendre ce qui leur arrive ou de se voir retirer leur enfant. La loi est là pour prévenir les abus, c’est évidemment indispensable. Mais, en tant que médecin, le fait que la stérilisation ne puisse pas faire partie des options me met parfois dans des situations impossibles.»
Des «zones grises» où l’éthique et la loi s’entremêlent auxquelles Benoit Denison, directeur de l’institution «Secteur des adultes» à Malonne, a lui aussi été confronté. L’une de ses résidentes, pourtant sous contraceptif, est parvenue à tomber enceinte deux fois. Découvertes sur le tard par l’entourage et l’institution, les grossesses ont été menées à terme. «Après la première, on lui a demandé de se faire ligaturer les trompes, mais elle a refusé.» À l’issue de la deuxième, sa famille, le médecin et l’institution obtiennent finalement gain de cause. «Elle avait un tel désir de maternité qu’elle risquait de recommencer. Il fallait prendre en compte l’intérêt de ces enfants à venir, qui auraient eux aussi fini placés par la justice1, explique le directeur. Mais ça a créé beaucoup de débats en interne et ça a été difficile à vivre pour elle. Aux États-Unis, elle serait peut-être devenue riche…»
Sexe et handicap: un impensé
L’évocation des stérilisations forcées de femmes handicapées renvoie inévitablement à des heures sombres de l’Histoire, qui ont vu l’eugénisme se développer en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle avant de se répandre en Scandinavie et dans d’autres pays d’Europe au cours du XXe siècle. Des lois visent alors explicitement à éviter la reproduction de ceux qu’on appelle les «idiots», «dégénérés» ou «imbéciles». Une politique qui connaîtra son paroxysme macabre sous l’Allemagne nazie, où les lois sur la stérilisation forcée de 1933 et sur l’avortement obligatoire pour les femmes «inférieures» seront suivies de l’extermination d’au moins 70.000 à 80.000 handicapés mentaux et physiques.
Mais comparaison n’est pas raison. Si on a continué par la suite à stériliser des femmes handicapées sans leur consentement, c’est pour des raisons souvent plus «pragmatiques» qu’idéologiques. Tant du côté des parents, soucieux d’éviter à leur enfant une maternité qu’ils risqueraient de devoir eux-mêmes assumer, que du côté d’institutions d’accueil pour personnes handicapées – lieux où la sexualité a pourtant longtemps été interdite – pour lesquelles la stérilisation était une condition d’accès.
«Les personnes handicapées sont des personnes à qui on a toujours dit ce qu’elles devaient faire, qui ont toujours été dans l’apprentissage du ‘oui’. Alors si un jour quelqu’un leur dit ‘Couche-toi là, écarte les jambes’, elles vont le faire.»
Christian Nile, référent VRAS à l’Aviq.
Un paradoxe, une hypocrisie même, selon de nombreux travailleurs du secteur rencontrés dans le cadre de cette enquête. «Quel est l’intérêt de demander à une résidente d’être stérilisée ou sous contraceptif et de dire, dans le même temps, qu’il n’y a pas d’activité sexuelle dans l’institution?, soulève ainsi Carène Samuele, ancienne directrice d’un service d’hébergement. En réalité, on reconnaît à demi-mot qu’il pourrait y avoir une activité sexuelle, mais celle-ci n’étant absolument pas prise en charge par l’institution, on en gère juste les conséquences visibles.»
La sexualité des personnes handicapées est longtemps restée un impensé. Jusqu’à ce qu’elle surgisse de façon plutôt inattendue vers la fin des années 90. En pleine vague du sida à Bruxelles, des centres de référence VIH voient alors affluer des femmes handicapées hébergées en institution. «Elles étaient supposées sans sexualité et on les découvrait infectées. C’est donc par le prisme de la santé publique qu’on s’est rendu compte qu’il y avait bien une sexualité dans les institutions, retrace Noémie Schonker, chargée de mission «précarités et handicaps» à la FLCPF. Et, la plupart du temps, cette sexualité n’était pas consentie. Il y avait clairement des abus.»
Quatre fois plus de violences sexuelles
Retour dans les bureaux du mouvement «Personne d’abord». Natacha, toujours remuée, remonte plus loin dans ses souvenirs. «À 18 ans, j’ai été violée. Je n’ai rien dit à ma mère, mais elle l’a lu dans mon journal intime. Elle m’a emmenée voir la gynécologue et m’a imposé la pilule. Aujourd’hui, même si ce n’est pas ce que je voulais, quelque part je me dis que c’est rassurant que je sois stérilisée… Parce que si je suis à nouveau victime d’une agression sexuelle, au moins je ne tomberai pas enceinte.»
La jovialité des femmes autour de la table s’étouffe. Les sourires laissent place à des regards incertains, un peu gênés. Silence. «Vous avez toutes été agressées sexuellement!», leur lance finalement Danielle Tychon, la coordinatrice de l’association, comme en guise de rappel.
Si la Belgique ne dispose d’aucun état des lieux des violences faites aux femmes handicapées, une étude d’Esenca2, l’asbl des mutualités Solidaris qui défend les personnes en situation de handicap, malades, invalides, relaie un chiffre commun à plusieurs études en Europe: 80%, des femmes en situation de handicap (institutionnalisées ou pas) auraient été victimes de violences. «La probabilité qu’elles subissent des violences sexuelles comparées à leurs homologues valides est quatre fois plus grande», poursuit l’étude. «Toutes les associations dans le secteur du handicap ont fait écho de violences sexuelles», confirme Gisèle Marlière, la présidente d’Esenca.
Dans ce contexte, la stérilisation et la contraception auraient longtemps permis aux institutions d’éviter de gérer de front ces agressions. Aline Rolis, une éducatrice spécialisée qui a fait ses armes dans plusieurs services pour personnes handicapées, se souvient du cas d’une famille ayant refusé une place en institution pour leur fille lourdement déficiente sur le plan cognitif (et donc incapable de consentir à une relation sexuelle), car on y exigeait sa contraception. «La seule manière de justifier cette contraception, resitue-t-elle, c’était d’éviter des grossesses non désirées et ainsi, pour l’institution, de se protéger des conséquences visibles d’une agression sexuelle.»
Confronté à des cas d’abus sexuels au sein de son service d’hébergement (commis par des professionnels sur des bénéficiaires), Benoît Denison n’a lui pas hésité à saisir la justice. «Il y a eu des condamnations. Ça nous a permis de mettre en place un protocole», un fait visiblement assez rare pour que l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) sollicite le directeur il y a quelques années dans le cadre d’un groupe de travail «suspicion d’abus», avec pour objectif d’inciter et d’aider les institutions à ne plus cacher les cas d’agressions sexuelles sous le tapis.
La «pointe de l’iceberg»
Où en est-on aujourd’hui? Des échos du terrain, on comprend que la loi de 2013 a eu un impact notable sur le nombre de stérilisations pratiquées sans consentement. Au point que celles-ci ne seraient plus, selon Noémie Schonker, que «la pointe de l’iceberg»: une problématique «éminemment grave et scandaleuse», mais finalement «peu fréquente» et sous laquelle se tapissent «toute une série d’autres violations ou limitations du droit des personnes handicapées». Exemple? Le nombre de mises sous contraceptif imposées, souvent sans explications, et qui serait, lui, «énorme». «Le pourcentage de femmes contraceptées dans les institutions est beaucoup plus élevé qu’au sein de la population.»
La contraception – moins «radicale», mais rarement consentie, souvent de longue durée, et pas toujours adaptée – semble donc avoir pris le dessus sur la stérilisation. «Il y a un contrôle hormonal très précoce dans la vie de la jeune femme handicapée, note Justine Dehon, coordinatrice de l’asbl Handicap & Santé et co-autrice de l’étude «Violences gynécologiques et obstétricales vécues par les femmes avec une déficience intellectuelle vivant en institution» (2023). Dans ce rapport, on s’interroge: une contraception forcée tout au long de la vie, n’est-ce pas une forme de stérilisation?»
Chose assez incroyable, la contraception figurait explicitement jusqu’à il y a peu dans de nombreux règlements d’ordre intérieur d’institutions d’hébergement, la rendant de facto obligatoire. Un chantier mené en 2019 par Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances – qui a notamment pour mandat de veiller à l’application en Belgique de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – a mis un terme à la pratique. Mais, comme pour la stérilisation, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde. La contraception resterait ainsi fortement suggérée aux parents. Qui, face au manque criant de places en institution, ont peu de marge de négociation. «Si officiellement la contraception ne figure plus comme condition d’accès aux institutions, ne soyons pas naïfs, cela reste une pratique», glisse le juriste Baudouin Pourtois.
«Anges asexués» ou sexualité débridée
Symbole de l’émancipation de la femme, la contraception se fait ici outil de contrôle, restreignant les droits plutôt qu’elle ne les élargit. «C’est pourtant un combat féministe de pouvoir jouir de relations sexuelles sans risques, recadre Noémie Schonker, qui rappelle que les femmes handicapées, comme les valides, peuvent faire le choix conscient de ne pas avoir d’enfants, d’une contraception, voire d’une stérilisation. Mais il faut que la personne soit bien accompagnée et qu’elle soit partie prenante du processus.»
C’est ce à quoi s’attellent les centres de planning familial et autres défenseurs de la vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) dans le secteur du handicap. En formant les professionnels d’institutions aux droits des personnes handicapées, en sensibilisant celles-ci au libre choix, au consentement… Et en tentant de faire évoluer, par la même occasion, la vision collective des personnes handicapées, longtemps coincées dans deux cases opposées: «anges asexués» ou «bêtes» à la sexualité débordante, insatiable et ingérable.
Autant dire que le chemin a été long depuis la ratification, en 2009, par la Belgique de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap (qui leur garantit notamment l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive). En Wallonie, le droit à la VRAS dans les institutions a été consacré par plusieurs arrêtés ces dernières années. Le dernier en date (2019) impose à tous les services de rédiger un contrat d’objectifs qui doit notamment intégrer la VRAS dans le projet de service et le projet individuel de la personne.
«J’y ai toujours vu les mêmes dysfonctionnements. Il n’y a rien qui bouge à l’intérieur de ces vieux bazars. Ou très peu, ou très lentement.»
Carène Samuele, ancienne directrice d’un service d’hébergement, à propos des institutions
«Globalement, la plupart des services s’ouvrent à ces questions; de façon encore très prudente chez certains, de façon plus rapide chez d’autres. Mais au niveau du handicap, l’amour et le sexe ne sont plus un tabou», assure, optimiste, Christian Nile, référent VRAS à l’Aviq.
Depuis 2020, l’Aviq a également mis sur pied un catalogue de formations d’éducation à la VRAS pour les professionnels d’institutions. Christian Nile en est convaincu: c’est par cette porte qu’on luttera contre les violences sexuelles en institutions. «Les personnes handicapées sont des personnes à qui on a toujours dit ce qu’elles devaient faire, qui ont toujours été dans l’apprentissage du ‘oui’. Alors si un jour quelqu’un leur dit ‘Couche-toi là, écarte les jambes’, elles vont le faire. Notre travail, c’est l’apprentissage du ‘non’, de conduire ces personnes dans l’autodétermination.»
Mais l’incitatif à ses limites. L’inscription aux formations relève du bon vouloir des responsables d’institutions. L’adoption d’une réelle ouverture aux questions de sexualité et d’intimité se révèle souvent proportionnelle à l’ouverture d’esprit (et la disponibilité en temps) des équipes de terrain. Certes, ça bouge, certaines institutions amorcent un vrai changement en offrant à leurs bénéficiaires le choix de leur moyen de contraception, en permettant le recours à l’assistance sexuelle, en créant des lieux d’intimité, en collaborant activement avec des centres de planning familial… Mais d’autres semblent ne pas (encore) avancer d’un iota. Celles où les simples bisous entre bénéficiaires sont interdits. Où les moments d’intimité sont utilisés comme des leviers de punition. Où la sexualité est officiellement tolérée, mais où rien ne permet concrètement de la vivre.
Peignoirs pour tout le monde
Carène Samuele, ancienne directrice d’un service d’hébergement, en sait quelque chose. À ses débuts dans le secteur, elle découvre, effarée, à quel point «on considère et protège peu le corps des personnes en situation de handicap mental»: «Les femmes étaient soit stérilisées, soit sous contraception obligatoire. Quand les bénéficiaires allaient à la douche, ils étaient nus, assis sur un banc à attendre leur tour…» Devenue responsable d’établissement en 2006, elle s’attaque à ces deux chantiers: la contraception et la protection de l’intimité.
«Les femmes contraceptées étaient toutes sous Depo-Provera, un contraceptif injecté par le médecin tous les trois mois. J’y ai mis fin, ça nous a pris du temps, mais on est arrivé à ce qu’elles choisissent elles-mêmes leur contraception», retrace-t-elle d’une voix rauque qui respire encore la détermination. Deuxio: la directrice achète des peignoirs aux bénéficiaires et réorganise l’ordre de passage aux douches pour éviter les embouteillages. «On peut, avec de simples trucs, changer les choses», assure celle qui a pourtant fini licenciée en 2020 au terme d’«un combat de celui qui allait gueuler le plus fort». Un affrontement de vision entre un conseil d’administration vieillissant et une travailleuse convaincue que l’institution «avait besoin d’un changement radical de paradigme».
Aujourd’hui responsable d’un centre de planning familial à Namur, Carène Samuele ne fait pas secret de son amertume vis-à-vis des institutions: «J’y ai toujours vu les mêmes dysfonctionnements. Il n’y a rien qui bouge à l’intérieur de ces vieux bazars. Ou très peu, ou très lentement.» Une inertie qui s’explique en partie par le passé de ces structures pour personnes handicapées, à l’origine congrégations religieuses, rejointes dans la deuxième moitié du XXe siècle par des asbl créées par des parents. «On comprend bien que, tant du côté catholique que du côté des parents, l’EVRAS (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, NDLR) n’a jamais vraiment fait partie des priorités du secteur du handicap, conclut Benoît Denison. Beaucoup voient encore le respect de ce droit comme une boîte de Pandore qui déversera des catastrophes si on l’ouvre. Moi je crois que c’est l’inverse: c’est quand on ne l’ouvre pas que les catastrophes se produisent…»
Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles
Alter Échos publiera, en 2024, le second volet de cette enquête consacré à la parentalité des personnes en situation de handicap.
- Le placement des enfants de personnes en situation de handicap sera notamment abordé dans le second volet de cette enquête, « handicap et parentalité », à paraitre en 2024.
- « Femmes en situation de handicap, une double discrimination violente », décembre 2020