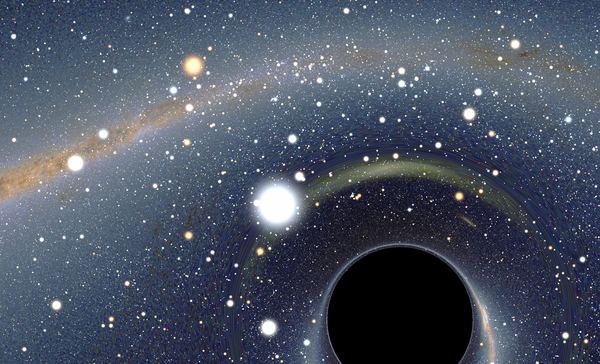Le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, mieux connu sous les noms de TTIP ou Tafta, suscite bien des débats. Quel est donc cet accord commercial que négocie la Commission européenne, dans une certaine discrétion, avec l’hyper-puissance américaine? Serait-on en train de céder aux multinationales et de brader nos services publics, nos normes sociales et environnementales? C’est ce que craignent les «anti», mais que nient les «pro».
Les anti-accord ont le vent en poupe. Portée par une brise océane, la plate-forme «No Transat», contre le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), a recueilli près de 40 000 signatures. Des associations, des ONG et autres syndicats y figurent en bonne place.
Leur courroux se manifeste sur plusieurs fronts. D’abord contre la façon de négocier des États-Unis et de l’Union européenne. Elle serait caractérisée par un «manque de transparence». Ensuite contre le traité lui-même qui préparerait la mise en coupe réglée des services publics au profit de multinationales. Enfin, ils dénoncent l’abandon de nos règles sanitaires, sociales et environnementales, au bénéficie d’un libéralisme échevelé.
Côté partisans, on insiste surtout sur les bénéfices économiques attendus d’un tel traité. En facilitant le commerce, on augmenterait la croissance et donc l’emploi. La Commission européenne avance même des chiffres, inspirés d’une étude qu’elle a commandée au Center for Economic Policy Research (CEPR) à Londres. Un demi-point de PIB en plus et 545 euros par an pour chaque foyer européen. Rien de moins. Un étude vertement critiquée, tant pour les conflits d’intérêts qui règnent à la tête de l’institut de recherche (dont la direction est composée de banquiers de renom) que par le sérieux de la démarche.
Beaucoup d’informations circulent au sujet du TTIP. Pas facile de faire le tri entre le fantasme – ce qui «pourrait» advenir – et ce qui est réellement négocié. Des documents circulent. La Commission, sur son site, publie les positions qu’elle défend lors des négociations, mais l’état réel des négociations reste inconnu.
Aujourd’hui, la Commission se veut rassurante. John Clancy, le porte-parole du commissaire européen au commerce Karel De Gucht, affirme que, «contrairement à ce que disent les anti-TTIP, ce projet n’est pas diabolique, il ne signifie pas la fin du monde que l’on connaît. C’est plutôt du bon sens. Il s’agit de voir comment aligner nos deux économies. C’est un projet de long terme qui ne va rien coûter aux citoyens». Malgré ces paroles apaisantes, les sujets de crispation restent nombreux.
Encadré
Le TTIP est l’acronyme pour «Transatlantic Trade and Investment Partnership», en français, partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. Ses adversaires lui préfèrent un autre acronyme : Tafta, pour Transatlantic Free Trade Area.
Les négociations ont commencé en juillet 2013 et sont censées aboutir en 2015.
Le but du TTIP est «d’éliminer les obstacles au commerce». Cela signifie que les États s’engagent à faire disparaître les droits de douane. Mais ceux-ci sont en moyenne d’un niveau peu élevé (4% selon la Commission).
Outre les droits de douane, ce sont surtout les «obstacles non tarifaires» qui font débat. On parle ici des normes et réglementations en vigueur aux États-Unis et en Europe. Elles sont très différentes, qu’il s’agisse de normes sanitaires, environnementales ou sociales.
C’est ce que la Commission appelle la «bureaucratie superflue». Un exemple : dans les deux entités (Europe et États-Unis), les nouvelles voitures commercialisées doivent passer une série de «crash-tests». La façon de les réaliser peut différer d’un pays à un autre. La position du mannequin peut varier. Ces différents types d’homologation seraient des obstacles au commerce d’automobiles entre les États-Unis et l’Union européenne. Le traité viserait soit à faire converger les façons d’homologuer, soit à reconnaître les certifications de l’autre.
Certains enjeux sont bien plus polémiques. Des exemples concernant l’agriculture ont été abondamment cités. OGM, gaz de schiste, bœuf aux hormones. Jusqu’ou s’étendront les négociations?
Enfin, le TTIP devrait intégrer un mécanisme, très critiqué, de résolution des litiges entre entreprises et États. Le fameux «ISDS», pour Investor-State Dispute Settlement ou règlement des différends entre investisseurs et États.
La fin des services publics?
Tout est négociable, sauf la culture. C’est en gros ce que l’on peut comprendre des communiqués de la Commission européenne. Les collectifs contre le TTIP en déduisent que les services publics feront une proie idéale pour les compagnies américaines. Dans le domaine de la santé par exemple. Ou de la gestion des eaux usagées, des crèches et d’autres domaines sensibles.
John Clancy s’offusque de cette accusation : «Jamais nous n’avons négocié un accord de commerce qui touche aux services publics, et nous ne le faisons pas.» Récemment, un document a fuité. Il s’agit de la position défendue par la Commission européenne lors des négociations relatives aux services. On y voit, effectivement, que les services considérés comme «d’utilité publique» sont mentionnés comme étant protégés. Pour Penny Clarke, de la Fédération européenne des syndicats de services publics, ce garde-fou est loin d’être suffisant. «La proposition de la Commission laisse la possibilité aux États de protéger ces services. C’est une possibilité. Alors que les services publics devraient simplement être exclus de la négociation. De plus, dans sa liste des services, la Commission ne cite pas les services sociaux, comme les crèches ou les institutions pour personnes âgées. Pourquoi?» Ce qui veut donc dire qu’à l’heure actuelle, l’organisation du système de garde d’enfants pourrait être soumis à la concurrence internationale.
Si l’on en croit cette «fuite», la Commission ne s’est pas lancée dans une grande braderie des services publics. Mais elle laisse des portes ouvertes. L’une des principales portes, pour Penny Clarke, est ce fameux tribunal arbitral (ISDS) qui permettrait aux entreprises d’attaquer les États lorsque leurs intérêts seront remis en cause par des politiques nationales. Et de citer l’exemple de l’assureur néerlandais Achmea qui a réussi à toucher 22 millions d’euros devant un tel tribunal (car ces ISDS sont déjà intégrés dans de très nombreux accords commerciaux dans le monde), lorsque la Slovaquie avait décidé de revenir partiellement sur une loi privatisant le système de santé.
Les normes : le grand chambardement?
Pour la Commission européenne, on l’a compris, ce partenariat transatlantique ne visera pas à changer la législation, «ni à modifier nos standards. Nous cherchons simplement des interconnexions avec les États-Unis», affirme John Clancy. Des discussions techniques, en somme. Un point de vue que ne partage pas Bruno Poncelet, du collectif No Transat. Pour lui, un tel accord, en touchant aux normes, aux règlements, aux lois, n’est pas que technique, il est «éminemment politique». Cultiver des OGM, exploiter des gisements de gaz de schiste, consommer du bœuf aux hormones sont des choix collectifs.
Bien sûr, les multinationales exercent un lobby transatlantique. Les grandes multinationales américaines de l’agroalimentaire font effectivement pression pour que l’Europe ouvre ses marchés au bœuf aux hormones, aux poulets chlorés. Des compagnies énergétiques voudraient exploiter le gaz de schiste européen. De même, les entreprises européennes rêveraient que les États-Unis ouvrent davantage leurs marchés publics ou leurs services financiers. Mais, pour l’instant, ces derniers ne font pas partie des négociations. Il faut dire que les États-Unis, suite à la crise des subprimes, ont davantage régulé leurs marchés financiers, par la loi Dodd-Franck, que l’Union européenne. Les autorités ne souhaitent pas spécialement… un abaissement des normes.
L’enjeu des normes, qu’elles soient sociales, environnementales ou sanitaires, est toutefois plus complexe. John Clancy, de la Commission européenne, prend l’exemple du bœuf aux hormones, dénonçant au passage la «propagande» des «anti» qui «divulguent de fausses informations» : «Le bœuf aux hormones est interdit en Europe. C’est illégal. Le TTIP ne change pas les législations comme ça. Si nous décidons de fixer un quota, on peut le décider par exemple sur les bœufs sans hormones.»
Lorsqu’on parle des normes, de nombreux chiffons rouges sont agités. Car la crainte est de voir le principe de précaution, cher aux Européens, disparaître peu à peu au profit d’une approche du risque plus «à l’américaine». Prenons l’exemple des produits chimiques. L’Europe s’est dotée en 2007 d’un règlement appelé Reach : Règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques.
Aïda Ponce est chercheuse chez Etui (European Trade Union Institute), l’institut de recherches de la confédération européenne des syndicats. Elle nous décrit le fonctionnement de ce règlement : «Le principe est “pas de données, pas de marché’’. Les industriels doivent fournir aux autorités européennes des données qui prouvent que ces produits sont sûrs. Puis les produits sont vérifiés par l’agence européenne des produits chimiques. Aux États-Unis, l’industriel met sur le marché son produit. L’autorité ne le vérifie que s’il y a une plainte.» Un problème très aigu pour les produits listés comme cancérigènes.
L’Europe va-t-elle se lancer dans des négociations qui déferaient les normes qu’elle s’est évertuée à adopter? Non, nous dit Aïda Ponce, «mais sur certaines lacunes de Reach. Par exemple sur des produits qui ne sont pas encore couverts par la législation, comme les perturbateurs endocriniens. Ils feront peut-être partie des négociations.» C’est bien sur des produits non encore réglementés que les enjeux se porteront principalement.
Un tribunal arbitral, pour quoi faire?
Les tribunaux internationaux d’arbitrage existent depuis des décennies. Ils permettent à des entreprises de régler un litige avec un État. Ils sont censés «protéger l’investissement». Trois «juges» sont nommés pour régler le différend. L’un par l’État, l’autre par l’entreprise, l’autre par le secrétaire général de la cour.
Le principe de tels mécanismes est inscrit dans plus de 1 400 accords commerciaux signés par des pays de l’Union européenne. À l’heure actuelle, huit pays ont déjà signé des accords d’investissement avec les États-Unis, comprenant une clause dite de «protection de l’investissement».
À l’origine ce dispositif a été créé pour dédommager une entreprise en cas d’expropriation. Ces dernières années, il est de plus en plus utilisé par de grandes entreprises pour contester des législations qu’ils considèrent comme des entraves au commerce. Des cas emblématiques sont régulièrement cités. Philip Morris qui attaque l’Uruguay et l’Australie pour leurs lois antitabac, ou encore Véolia qui a déposé une plainte au Centre international de règlement des différends relatifs à l’investissement contre l’Égypte car les autorités du pays avaient notamment décidé d’augmenter le salaire minimum.
Autant dire que le principe de l’ISDS recueille des critiques assez unanimes de la société civile. Interrogé sur ce point, John Clancy affirme que la Commission… adhère à ces critiques. «Il y a des problèmes avec l’ISDS. Certaines inquiétudes sont exactes. Dans les accords commerciaux, seulement deux paragraphes abordent l’ISDS, laissant de larges marges d’appréciation aux grands cabinets d’avocats». La Commission a donc ouvert une consultation publique à ce sujet. Alors que beaucoup d’ONG proposent de laisser tomber ce mécanisme, la Commission, elle, s’est engagée à «l’améliorer, afin d’avoir plus de clarté, de cohérence».
Au sujet de l’ISDS, comme de l’abaissement des normes, finalement, à l’heure actuelle «on ne sait pas grand-chose», comme le rappelle Xavier Miny, assistant au service de droit international économique de l’Université de Liège. «Le risque qu’un tel traité menace la souveraineté des États et leur capacité de légiférer sur des sujets sensibles est réel. Le risque d’un accroissement du dumping social aussi. Les ONG mettent en avant des risques sur lesquels il ne faut pas transiger. C’est à la Commission de veiller à mettre suffisamment de garde-fous, de limites.» Et pour l’instant, la confiance entre Commission et ONG n’est pas au beau fixe.
Aller plus loin
- Lobby contre lobby : interview croisée entre Martin Pigeon, chercheur chez Corporate Europe Observatory (CEO), et Pascal Keirnis, lobbyiste pour European Services Forum, un groupement d’entreprises européennes de services.
- Une fois finalisé, le traité transatlantique n’entrera pas d’office en vigueur. Le Parlement européen devra l’approuver avant cela. Et s’il disait «non»? Et si d’autres scénarios conduisaient à l’enterrement du TTIP?
- Pour comprendre les enjeux du traité, il convient de le resituer dans les coulisses d’un conflit économique implacable entre la Chine, les États-Unis, la Russie et l’Allemagne. Interview avec Jean-Michel Quatrepoint, auteur du Choc des Empire
En savoir plus
La plate-forme No-transat réunit à ce jour plus de 235 associations et plus de 4o.ooo citoyens. Voir la page Facebook de la plate-forme.