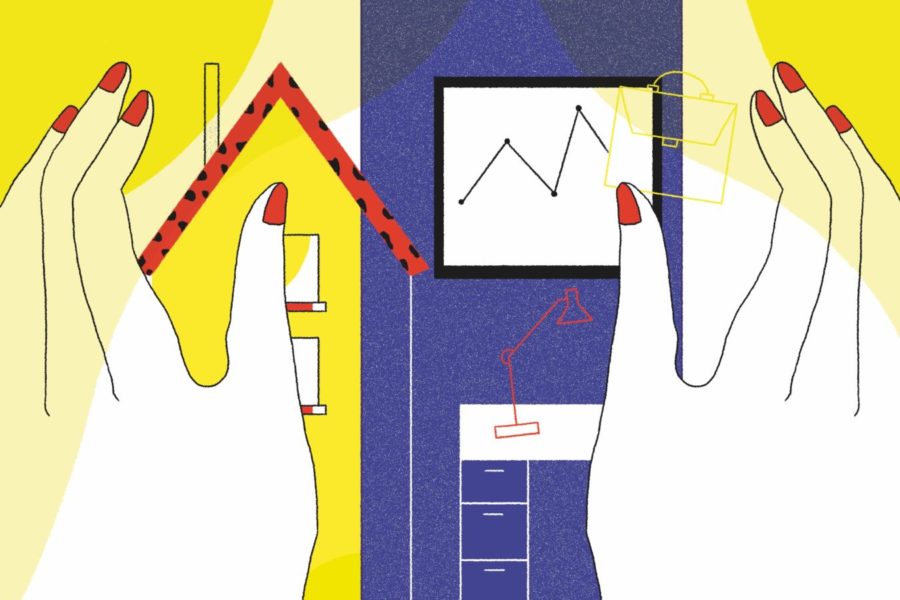Travaille-t-on de plus en plus? En principe, non. La durée légale du temps de travail n’a pas bougé. En pratique, oui. Ce qui a changé, c’est un management qui a fait de la disponibilité du travailleur un impératif économique et presque une règle morale. Et si on recommençait à compter ses heures?
«Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie, c’est l’amour du travail, la passion furibonde du travail poussée jusqu’à l’épuisement des forces vitales de l’individu», écrivait Paul Lafargue dans Le droit à la paresse (1880). Le droit à la paresse, une revendication qui, aujourd’hui, a du mal à trouver sa place dans une société où l’emploi est devenu un bien rare et précieux. Pourtant, l’explosion du nombre de dépressions et de burn-out liés au boulot montre un dysfonctionnement évident dans nos conditions de travail.
Dans une étude réalisée en 2017 pour la CSC, sur la réduction collective du temps de travail, Gérard Valenduc et Patricia Vendramin constataient que la réduction du temps de travail, cette tendance historique qui remonte au XIXe siècle, n’a plus évolué depuis le début de ce siècle à l’exception de la loi de 2001 qui instaure la semaine de 38 heures au lieu de 39. Mais, dans le même temps, relevaient les deux professeurs à l’UCL, les plaintes liées à la fatigue, les douleurs physiques provoquées par le travail n’ont cessé de croître, comme le montrent les «baromètres sur la qualité de l’emploi» qu’ils ont réalisés depuis une dizaine d’années. En Belgique, 51% des salariés disent travailler dans des délais serrés et 37% ont des problèmes de fatigue générale. Bref, «le temps de travail ne diminue pas mais les rythmes et la pression du travail s’accroissent alors qu’en même temps des changements dans les modes de vie et les modèles familiaux viennent bousculer encore plus les équilibres temporels du passé».
«Dans les ménages, le temps de travail cumulé a augmenté et cela laisse moins de place pour le reste.» Esteban Martinez, professeur en sociologie du travail, ULB
Esteban Martinez, professeur en sociologie du travail à l’ULB, confirme cette analyse: «Les statistiques donnent l’impression que le temps de travail a diminué mais c’est parce qu’on y inclut les temps partiels. Si on examine par contre le temps de travail déclaré par les gens, ce temps reste stable et a même tendance à augmenter depuis une vingtaine d’années. Par ailleurs, au sein des ménages, plus de femmes travaillent qu’il y a trente ou quarante ans. On est quasi à la parité sur le marché du travail. Cela signifie que, dans les ménages, le temps de travail cumulé a augmenté et cela laisse moins de place pour le reste, pour le ménage, le temps avec les enfants. Cela accentue le sentiment de pression du temps.»
Pour Esteban Martinez, cette impression s’explique directement par l’exigence de disponibilité que subissent la plupart des travailleurs. Elle n’est pas la conséquence directe des nouvelles technologies, même si celles-ci l’accentuent. «C’est un peu simple d’incriminer seulement le smartphone. La disponibilité est le moteur des nouveaux modes de management.» Depuis les années 80, observe le sociologue, «on assiste à l’augmentation de la flexibilité et à l’inversion de la tendance historique à la réduction du temps de travail. Toutes les législations mises en place sont le socle de cette disponibilité attendue de la part du travailleur. On a relâché les normes qui standardisaient le temps de travail à l’échelle de la journée, de la semaine avec notamment le principe de l’annualisation des heures en fin d’année. Cette flexibilité conventionnelle, légale, est l’outil utilisé par les entreprises pour exiger des travailleurs plus de flexibilité, plus de disponibilité. Le temps de travail régulé est considéré aujourd’hui comme quelque chose de vieillot, lié à l’ère industrielle».
Contractuellement, la durée de travail est fixée par jour (huit heures par exemple) et/ou par semaine (38 heures). Cependant, ces heures peuvent être comptabilisées sur des périodes plus larges, avec des semaines plus chargées et d’autres moins. C’est ce qu’on appelle l’annualisation du temps de travail. Soit le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période de référence (un trimestre, un semestre ou un an), et non pas sur la semaine. La possibilité de répartir la durée du travail sur une période de référence n’est pas illimitée. Des heures maximales de dépassement ont été identifiées et la récupération de ces heures doit avoir lieu avant la fin de la période de référence. Ainsi, la durée du travail est respectée en moyenne, sur une certaine période. La flexibilité du temps de travail a été poussée un peu plus loin avec le «plus minus conto». Créé avant tout pour le secteur automobile, ce système permet de comptabiliser les heures sur le cycle de production d’un produit, par exemple six ans pour un modèle d’automobile. Ici encore des normes doivent être respectées. La durée journalière du travail ne peut dépasser 10 heures et 48 heures pour la semaine. Depuis mars 2017, le gouvernement Michel a étendu le système du «plus minus conto», sous conditions, à l’ensemble des entreprises du secteur privé.
«C’est le boulot qui veut ça»
Cette disponibilité est désormais profondément ancrée dans la représentation que nous avons du travail. Esteban Martinez distingue plusieurs formes de disponibilité. Celle de type «corporatiste», surtout présente chez les cadres ou les professeurs d’université, où le fait de se détacher des limites du temps de travail envoie un signal pour promouvoir une carrière. Mais l’exigence de disponibilité la plus présente, dit-il, est liée à l’évolution vers une société de services, au sens large du terme. «L’emploi augmente principalement dans des activités qui ont un rapport avec des clients, des usagers, des patients. Dans ces emplois, il existe une ‘conscience professionnelle’ liée aux caractéristiques de la profession. S’il y a encore des personnes dans la salle d’attente, on ne va pas les mettre dehors. Dans un travail social, ce n’est pas facile de limiter le temps contrairement aux usines ou à certaines administrations où l’heure, c’est l’heure.» Dans les activités de services, les contraintes du temps sont intégrées. Ce n’est pas un hasard si le burn-out frappe durement dans les hôpitaux, les services sociaux ou dans les médias.
La seule qualification que l’on puisse faire valoir, c’est sa disponibilité.
«Avant, il y avait un compromis social: la subordination des travailleurs à l’employeur pour autant qu’elle soit délimitée dans le temps et donne lieu bien sûr à des compensations salariales. Ce compromis s’estompe parce que le management moderne mobilise différentes formes de disponibilité temporelle à tel point que l’on considère presque aujourd’hui que mettre des limites à son temps de travail est théorique. On peut parler d’un temps ‘forfaitaire’. Un prof d’université est censé travailler 38 heures mais tout le monde s’en fiche et lui le premier. Ce qui compte, ce sont ses résultats. C’est la production qui va donner lieu à une évaluation.» Martinez parle d’une «disponibilité vocationnelle» où le travailleur a intégré le fait de ne pas compter ses heures parce que c’est son métier qui l’exige. «Cette disponibilité liée à la nature de l’activité professionnelle est tirée dans des sens peu légitimes quand on prétend que les magasins doivent rester ouverts plus longtemps. On considère le client au même titre qu’un patient.»
Enfin, il existe aussi une forme de disponibilité obligée que le sociologue qualifie de «subsistance», celle qui touche les plus précaires qui cumulent les intérims ou les emplois, qui multiplient les heures supplémentaires dans le seul but d’atteindre un revenu suffisant. Ici, on compte ses heures. La seule qualification que l’on puisse faire valoir, c’est sa disponibilité.
Le temps de travail est désarticulé. Comment réagir? «En revenant à des normes», estime Esteban Martinez. Et au combat syndical. La réduction du temps de travail a toujours été une revendication du mouvement ouvrier. Est-elle devenue inaudible aujourd’hui? Des diminutions du nombre d’heures de travail à l’échelle de la semaine ont été testées dans le secteur bancaire, dans les commerces en passant à 36 ou 37 heures, le plus souvent sur une base annuelle en intégrant des jours de congé compensatoires «mais ça ne règle pas les problèmes à l’échelle de la journée où les contraintes sont les plus fortes». Pour Esteban Martinez, «si on prend pour objectif non pas la seule question de la redistribution de l’emploi mais aussi celle de la qualité de la vie, la semaine des quatre jours est une formule très intéressante».
«Le management met en avant la disponibilité temporelle comme une nécessité économique mais il parvient aussi à la présenter comme quelque chose de souhaitable pour le travailleur», Esteban Martinez, professeur en sociologie du travail, l’ULB
De fait, cette proposition est aujourd’hui portée tant par la CSC que par la FGTB. Les deux syndicats veulent la défendre lors des prochaines négociations interprofessionnelles. Et pendant la campagne électorale, l’idée a été reprise dans tous les partis (sauf le MR) comme une solution tant pour redistribuer l’emploi que pour lutter contre les burn-out et autres formes d’épuisement professionnel, notamment dans le secteur hospitalier (à condition bien sûr que les recrutements suivent). L’ex-ministre bruxellois de l’Emploi, Didier Gosuin, a voulu introduire la semaine des quatre jours chez les travailleurs de Bruxelles-Propreté. Le projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité par l’ULB et la formule s’est révélée positive. «Elle est très adaptée au partage du travail peu qualifié», précise Esteban Martinez, qui a participé à cette étude. Le sociologue reconnaît que ce type de diminution du temps de travail avec embauche compensatoire est surtout praticable là où les horaires sont calculés. Mais, l’essentiel, dit-il, c’est que la réduction du temps de travail revienne dans le débat social. «Le simple fait d’en reparler va à contresens de ce relâchement de la réglementation. Le management met en avant la disponibilité temporelle comme une nécessité économique mais il parvient aussi à la présenter comme quelque chose de souhaitable pour le travailleur (s’impliquer dans son travail, ne plus pointer, pouvoir télétravailler…). Remettre la réduction du temps de travail dans des cahiers revendicatifs, c’est réhabiliter le temps en tant que condition de travail qui a un impact essentiel sur la qualité de la vie et de la santé.»
Dans une étude réalisée en 2013, Gérard Valenduc, alors codirecteur du centre de recherches Travail et Technologies (lié à la Fondation Travail et Université – FTU), examinait la pression du temps chez les salariés et leur impression de ne plus disposer de temps libre pour la vie de famille et les loisirs. Il constatait que cette pression existait aussi, dans une moindre mesure, chez les demandeurs d’emploi. La situation n’a pas dû s’améliorer depuis lors. Les exigences de disponibilité pour les chômeurs mais aussi, depuis peu, pour les usagers des CPAS sont plus fortes que jamais. Le transfert du contrôle des chômeurs aux organismes régionaux n’a pas changé grand-chose. Les sanctions liées au manque de disponibilité des chômeurs restent particulièrement importantes au Forem (79% des sanctions contre 11% en Flandre et 9,2% à Bruxelles). «Avec 8.151 sanctions temporaires et 3.603 définitives, les sanctions sont moins nombreuses que lorsque l’Onem sévissait, mais le Forem a fait un copié-collé de ses méthodes», relève Yves Martens, coordinateur du Collectif solidarité contre les exclusions. La disponibilité active, c’est faire la preuve de recherche d’emploi. «Un système qui mobilise énormément les chômeurs. Ceux-ci passent leur temps à emmagasiner les preuves que le Forem attend et cela génère pas mal de stress.» Lorsque le chômeur reçoit un courrier d’avertissement, la convocation auprès de l’organisme de contrôle arrive très vite, après trois jours en moyenne. «Il faut être organisé, disposer à tout moment de sa farde remplie de ‘preuves’.» Peu de chômeurs échappent à ce type de contrôle. Après douze mois de chômage, on est déjà sur la sellette. «Un chômeur est toujours sur le qui-vive. Il n’a droit qu’à 24 jours de vacances sur l’année, où il échappe à cette obligation de justifier son temps.» Même les chômeurs âgés ne sont plus totalement «libérés». À 60 ans, un chômeur doit toujours pouvoir faire la preuve d’une «disponibilité adaptée» et tant pis si plus personne n’embauche les plus de 50 ans. Cette logique de la disponibilité absolue n’épargne plus les usagers de CPAS. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a décidé que les personnes qui émargent au CPAS ne pourront plus partir à l’étranger plus de quatre semaines par an et non consécutives «pour rester disponibles sur le marché de l’emploi», comme le justifiait à l’époque Willy Borsus. Le secrétaire d’État à l’intégration sociale utilisait le mot «disponibilité». La loi parle de «disposition» au travail. «Les exigences ne sont pas les mêmes que pour les chômeurs, relève Yves Martens, et des tribunaux du travail ont déjà dû rappeler cette règle à des CPAS qui exigent des recherches actives d’emploi sur les mêmes critères que l’Onem.» Jusqu’en 2004, les chômeurs (et seulement eux) devaient pointer régulièrement. Mais en 2016, l’ADAS (Association de défense des allocataires sociaux) a constaté que la commune de Braine-le-Comte avait fait pointer pendant vingt ans des usagers du CPAS «pour les socialiser». Une pratique totalement illégale et basée, comme pour les chômeurs, sur une «morale» qui exige de toujours rester occupé pour «mériter» son allocation.
En savoir plus
«Eh bien, paressons, maintenant», Alter Échos, n°470, Manon Legrand, 30 janvier 2019.