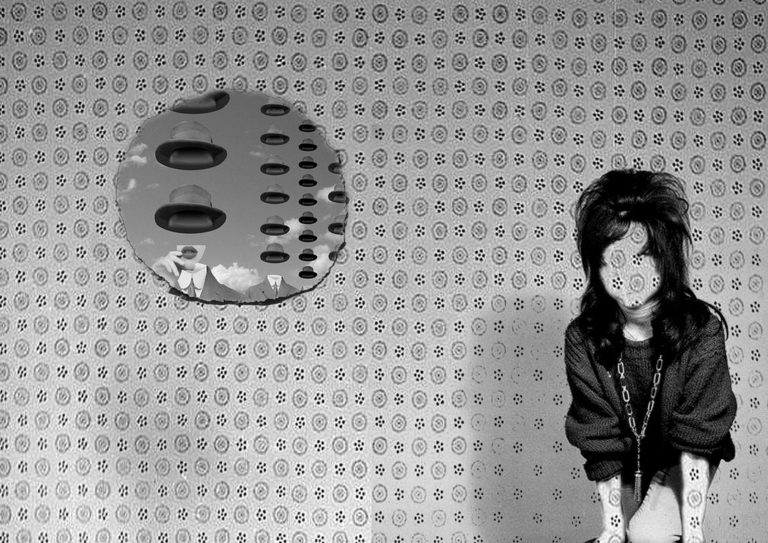Modifier ses organes génitaux ou changer le genre de son prénom? Pas si vite! Un petit détour par le cabinet d’un psychiatre s’impose. Cette étape obligatoire laisse entendre que la transidentité relèverait de la maladie mentale. Depuis des années, la communauté transgenre plaide pourtant pour une dépsychiatrisation de ses cheminements, multiples et singuliers.
Publié dans Alter Echos, n°430, dans le dossier « Des normes à prendre la tête ».
Maël, jeune prof, est actif depuis une grosse année dans l’association Genres Pluriels, qui s’attelle à soutenir et à défendre les droits des personnes trans et intersexes. Volubile et véhément, il communique avec entrain son engagement pour la cause de cette communauté dont il fait partie. Il relate la standardisation du parcours médical que doivent suivre – subir, pour certains – les personnes trans qui souhaitent évoluer dans leur identité de genre.
«C’est la médecine qui décide de ton parcours médical, des dispositifs nécessaires pour engendrer les caractéristiques du sexe opposé. Il y a une espèce de parcours de soins très standardisé qui passe par la psychiatrisation, l’endocrinologie (mais tous les trans ne veulent pas forcément prendre des hormones), puis de nouveau par un feu vert du psychiatre, puis par la chirurgie (encore une fois, tous ne souhaitent pas forcément passer par là). Le choix du moment est décidé par les équipes. On considère que, OK, tu veux sortir de la situation où tu étais, mais alors il faut le faire le plus vite possible, pour te réinscrire dans l’autre champ, pour rester dans une certaine norme. D’où une focalisation de la médecine sur les changements d’organes génitaux.»
Selon Genres Pluriels, la Belgique compterait entre 300.000 et 400.000 de citoyens transgenres. Pour l’association francophone, il est temps, aujourd’hui, de leur restituer leur autonomie. Sur leur identité, sur leur corps.
«Vers une pathologisation»
La psychiatrisation des questions transidentitaires remonte au milieu du XXe siècle. En 1953, le concept de «transsexualisme» voit le jour, avant de se glisser dans les manuels de diagnostics psychiatriques, que ce soit du côté nord-américain ou de l’OMS. «Depuis le début de l’observation des personnes trans, les définitions ont toujours penché vers une psychiatrisation et une pathologisation», explique Arnaud Alessandrin, sociologue à l’Université de Bordeaux. En 1980, alors que l’homosexualité est ôtée du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), la bible des psychiatres américains, le «transsexualisme» y prend place en tant que «trouble sexuel». L’idée se concrétisera ici et là sous la forme de protocoles de soins au cœur desquels campe, irréductible, le diagnostic psychiatrique.
En Belgique, la loi «relative à la transsexualité», votée le 19 mai 2007, s’est donné pour ambition de réguler les changements d’identité qui avaient jusque-là été laissés à la discrétion des juges. Pour ce faire, le texte exige le passage obligatoire par un diagnostic psychiatrique, mais aussi la réassignation sexuelle – autrement dit, la chirurgie des organes génitaux – et la stérilisation. Ces conditions sont vécues comme une violence.
«Quand on commence à introduire des protocoles de changement de sexe, précise le sociologue français, on considère que c’est pour aider les personnes trans. La psychiatrie est perçue comme un début de prise en compte et de prise en charge: les personnes trans passent du statut d’être anormal à être malade.» Paradoxalement, ce qui est aujourd’hui vigoureusement réfuté représente alors un premier pas vers la citoyenneté.
Un savoir «trans»
Ce n’est que dans les années nonante que les interrogations et les combats contre la psychiatrisation éclosent. Au même moment, un savoir «trans», les trans studies, s’immiscent dans les universités nord-américaines. «Beaucoup d’auteurs académiques trans considèrent que, traditionnellement, les personnes trans ont plus été des objets de savoir que des sujets à qui on reconnaît une autorité et qui peuvent produire du savoir. Elles étaient jusque-là étudiées comme quelque chose d’‘anormal’», explique Sara Aguirre, psychologue à l’ULB, qui étudie les discriminations à l’égard des personnes transgenres dans le monde du travail. Mais ce nouveau savoir qui émerge est nourri par l’expérience trans. Il fait basculer les présupposés sur les identités trans et, plus largement, sur le genre.
On commence alors à parler de la «performativité», explique la chercheuse. Pour faire simple, il s’agit d’en finir avec cette séparation entre le sexe, qui se réfère aux différences biologiques, et le genre en tant que construction sociale. Car la lecture que l’on fait de nos corps sexués est elle aussi sociale et culturelle. «Il y a beaucoup de corps différents, continue Sara Aguirre. À travers les pratiques, les discours, on contribue à reproduire cet idéal de l’homme et de la femme. Or personne n’atteint jamais cet idéal. L’existence des personnes trans en tant que telle remet en cause ce supposé déterminisme biologique de deux catégories hommes/femmes.»
L’idée sous-jacente de ces théories n’est pas d’abolir le genre, comme l’affirment certains détracteurs, mais plutôt d’en défendre la diversité. «Il existe des hommes, des femmes, mais il n’y a pas que ça», confirme Maël, le sourire aux lèvres. «Mais surtout, ces deux champs que sont le sexe et le genre n’ont que faire de la norme: une personne en bonne santé, si elle est confortable avec ça et que rien ne l’empêche de fonctionner dans la société, qu’elle soit mâle, femelle, intersexuée… elle fait ce qu’elle veut de son corps!»
Des ouvertures du côté des psys
Des brèches s’ouvrent dans les murs de la certitude de la science. Il y a trois ans, le «transsexualisme» cède sa place, dans le DSM, à la «dysphorie de genre», autrement dit l’inconfort d’une personne lié à sa condition transidentitaire. Si elle constitue toujours un trouble mental, cette définition est moins psychiatrisante, moins pathologisante, plus sociale: «Cela reste tout à fait imparfait, commente Arnaud Alessandrin, mais cela ouvre la voie à une reconnaissance des effets néfastes non pas du fait d’être trans, mais bien du fait d’être victime de transphobie. Les psychiatres veulent s’assurer que la mainmise sur ces quelques personnes trans ne leur sera pas ôtée. Je pense que c’est moins une question d’argent que de pouvoir définitionnel et moral. Mais ils vont pourtant bien devoir faire le deuil d’une conception de la transidentité comme une pathologie…»
Une équipe de psychiatres de Mexico s’est d’ailleurs récemment prononcée sur la question, après avoir interrogé environ 250 personnes trans dans la capitale d’Amérique centrale. «La classification de l’identité transgenre comme un trouble mental a contribué à la précarité du statut légal, à des violations des droits de l’homme et à des barrières dans l’accès aux soins chez les personnes transgenres», dénoncent les chercheurs de l’Institut national de psychiatrie Ramón de la Fuente Muñiz à Mexico. La détresse psychologique observée chez une majorité de personnes transgenres est davantage due au rejet social et aux discriminations dont elles sont victimes qu’à une «incongruence de genre», peut-on lire dans le résumé de l’étude, publié dans The Lancet Psychiatry en juillet dernier(1). Ces psychiatres appellent à supprimer les questions transidentitaires de la prochaine classification de l’OMS, la CIM, qui sera révisée en 2018.
Côté législatif, de nombreux pays ont voté des lois favorisant l’obtention d’un changement d’état civil sans psychiatrisation, sans condition de stérilisation. On peut désormais y changer son état civil sur la base d’une déclaration, ce qui met fin à cette idée selon laquelle une autorité externe est nécessaire pour confirmer que la personne trans ressent effectivement ce qu’elle affirme ressentir. «Globalement il commence à y avoir un bon mouvement contre la psychiatrisation, confirme Max Nisol, psychologue et formateur à l’asbl Genres Pluriels. L’Argentine a lancé le mouvement. En Europe, le Danemark, Malte, l’Irlande ont embrayé. Mais sans être parfaits. Ils n’ont légiféré que sur le changement d’état civil. Cela ne suffit absolument pas pour protéger les droits des personnes trans.»
Vers une nouvelle loi belge?
La Belgique fait figure de retardataire. «Les lois actuelles française et belge vont à l’encontre des droits de l’homme: que ce soit en matière de lutte contre les discriminations, de respect de l’intégrité physique et corporelle, de vie privée», se désole Arnaud Alessandrin. Un état de fait auquel Genres Pluriels compte bien s’attaquer. Depuis un an, l’association travaille avec les coupoles LGBT du pays, Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme et la «Equality Law Clinic» de la faculté de droit de l’ULB pour élaborer une proposition de loi qui évincerait la précédente. Au cœur de ce projet: la dépsychiatrisation. «Il faut rendre le droit à l’intégration physique et la possibilité, pour les personnes, de se nommer comme elles le désirent», défend Max Nisol. Mais ce n’est pas tout. Les soins de santé spécifiques des personnes trans devront être remboursés sur la base d’une autodétermination, propose le projet en question. Et que faire de l’argument selon lequel un remboursement ne peut avoir lieu s’il n’y a pas de reconnaissance d’un état pathologique? Arnaud Alessandrin le balaye d’un revers de la main: «On a déjà résolu cette question pour d’autres choses, comme la grossesse ou la vaccination, qui ne renvoient pas à la maladie, mais qui sont des nécessités de la vie.» Dernier enjeu du projet législatif, non des moindres: l’accompagnement des mineurs transgenres, jusqu’ici complètement niés par la loi.
Le texte sera déposé avant la fin de la législature. «Globalement, on constate une position d’ouverture de la part de presque tous les partis, se réjouit Max Nisol. Ce sera peut-être un peu plus difficile avec le CDH/CD&V…» Une position d’ouverture qui n’empêche pas l’asbl Genres Pluriels d’être menacée de la perte l’ensemble de ses subsides «égalité des chances» émanant du fédéral, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne.
(1) «Removing transgender identity from the classification of mental disorders: a Mexican field study for IDC-11», Lancet Psychiatry, vol. 3: 850-59, juillet 2016, Robles R. et alii.