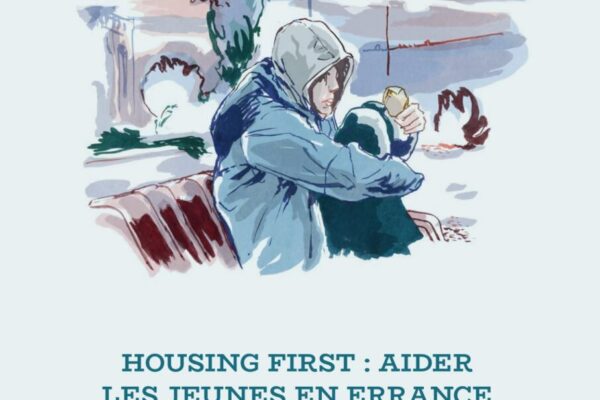Cet article est paru en mars 2022
Selon une étude publiée par les Mutualités libres, environ 9 jeunes femmes sur 1.000 âgées de 14 à 20 ans sont tombées enceintes en 2016 en Belgique. Pour les mineures en âge de scolarité (14-17 ans), cette proportion est de 3 pour 1.000. Les grossesses adolescentaires demeurent en effet un phénomène relativement rare dans les pays industrialisés, et particulièrement sur le Vieux Continent. «Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le phénomène est plus fréquent, notamment à cause de la pression qui s’exerce sur les questions de sexualité et qui empêche une bonne information», explique Jacques Marquet, sociologue de la famille et de la sexualité à l’UCLouvain.
Un déterminant socio-économique
L’étude des Mutualités libres montre que ces grossesses précoces sont trois fois plus fréquentes chez les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) – corrélée au faible revenu de leurs parents – que chez celles qui n’en bénéficient pas. «Ces constats confirment les résultats d’autres études qui montrent l’existence d’un lien entre grossesse précoce et précarité sociale, décrochage scolaire ou faible niveau d’attente dans des perspectives d’avenir», commente Güngör Karakaya, coauteur de cette étude. Une association qui s’explique en partie par un moins bon accès à la contraception, mais pas exclusivement, puisque plus de la moitié des grossesses des filles âgées de plus de 16 ans, bénéficiaires BIM, sont suivies jusqu’à l’accouchement, tandis que, chez les non-BIM, ce n’est qu’à partir de 20 ans qu’une grossesse sur deux va jusqu’à l’accouchement. Les jeunes femmes en situation socio-économique précaire ont donc moins recours à l’IVG. À 17 ans, elles sont 52% à poursuivre leur grossesse contre 32% chez les non-BIM.
«Souvent, il s’agit plutôt d’un acte manqué ou de ce qu’on pourrait appeler un ‘passage à l’acte’.» Latifa Ameluan, le Tremplin
Faut-il pour autant penser que ces grossesses ont été désirées, voire planifiées? «Beaucoup de ces jeunes filles sont dans l’ambivalence», résume Latifa Ameluan, intervenante sociale au sein du service d’accompagnement socio-éducatif (SASE) du Tremplin à Bruxelles. «Elles prennent la pilule, mais pas tout le temps, elles oublient… Souvent, il s’agit plutôt d’un acte manqué ou de ce qu’on pourrait appeler un ‘passage à l’acte’.» L’inconscient, le plus souvent, semble aux commandes.
Une identité refuge
L’inconscient de ces jeunes filles, et peut-être aussi celui de la société tout entière. Car, pour Jacques Marquet, ces grossesses adolescentaires doivent se lire comme le reflet de la valorisation persistante de l’identité maternelle: «Depuis trois générations, les trajectoires féminines s’écartent de plus en plus du rôle exclusif d’épouse et de mère. Mais il n’empêche que, même si les femmes réclament aujourd’hui une identité multifacette, l’identité de mère reste très valorisée. Or, dans un contexte où l’horizon semble bouché, où l’on est parfois déjà en échec scolaire, où l’on passe de l’enseignement technique au professionnel, avec des perspectives d’épanouissement professionnel qui s’estompent peu à peu, l’identité maternelle peut apparaître comme une identité ‘refuge’.» En devenant mères, ces adolescentes gagnent l’attention de la société et accèdent à certains droits comme le droit au logement ou le droit au revenu d’intégration, habituellement réservé aux seuls majeurs. «Aux yeux de la société, elles deviennent responsables», commente Latifa Ameluan. «Cet enfant est parfois une ‘revanche’ sur la vie», poursuit sa collègue, Valérie Vancalemont. «À travers lui, elles ont l’impression qu’elles vont combler un manque affectif. Certaines peuvent être très fusionnelles et refuser par exemple de le mettre à la crèche.» Malgré les structures d’accompagnement, peu de ces jeunes filles parviennent à poursuivre leurs études. «Le décrochage scolaire, c’est à la fois l’œuf et la poule», ajoute Latifa Ameluan.
Histoire de mères
Si la maternité intervient pour ces jeunes filles comme une tentative de trouver leur place dans une société qui semble leur en laisser peu, elle joue aussi ce rôle au sein de leur propre famille. Cet enjeu est d’autant plus présent lorsque l’enfance a été marquée par des carences et des dysfonctionnements. «Autour de la grossesse, il peut y avoir une remobilisation de l’environnement. Les parents de la jeune fille peuvent se montrer plus attentifs envers elle», poursuit Jacques Marquet. Il n’est d’ailleurs pas rare de retrouver plusieurs grossesses adolescentaires dans une même famille. «On pourrait croire que le fait d’avoir une sœur qui a eu un enfant très jeune agirait comme un repoussoir, mais c’est le contraire qui se produit. Cela montre que la fille enceinte fait sans doute en effet l’objet d’une attention qui est désirée par le reste de la fratrie.»
Ces très jeunes mamans sont en effet nombreuses à continuer à vivre chez leurs parents, dans une configuration où elles demeurent aussi les enfants de leurs mères. «On voit assez souvent des difficultés dans le rapport de ces jeunes mères à leur propre mère, qui peut se montrer assez intrusive. Certaines de ces grand-mères voient dans l’enfant l’opportunité de se racheter: elles n’ont peut-être pas été de bonnes mères pour leur fille, mais, cet enfant-là, elles vont en prendre soin.» Dans cette dynamique, le père – petit copain ou rencontre d’un soir – est rarement présent. «Les associations savent que, quand on essaie d’impliquer le père, en général ça fonctionne, mais pas nécessairement sur le long terme. La difficulté est souvent l’intégration au sein de la famille de la jeune fille», souligne Jacques Marquet. Certains pères ignorent du reste qu’ils le sont. D’autres sont déjà des ex. «Ce qu’on voit assez souvent, ce sont des jeunes filles qui laissent tomber le papa même avant l’accouchement, qui se mettent avec un autre jeune homme qui accepte de s’occuper de l’enfant et qui est ainsi établi en sauveur.»
«Même si les femmes réclament aujourd’hui une identité multifacette, l’identité de mère reste très valorisée. Dans un contexte où l’horizon semble bouché, l’identité maternelle peut apparaître comme une identité ‘refuge’.» Jacques Marquet, sociologue, UCL
Mauvaises filles
Bien sûr, si ces jeunes filles suscitent l’analyse sociologique comme psychologique, c’est avant tout parce qu’elles dévient de la norme. L’entrelacs de leurs motivations conscientes et inconscientes – désir de reconnaissance, de réparation narcissique, de complétude, de réalisation de soi, d’amour – n’épargne quant à lui aucun milieu social ni aucune tranche d’âge. «L’ambivalence, on la retrouve chez les femmes adultes comme chez les hommes, commente Jacques Marquet. Comme me l’a dit un jour une gynécologue, on peut avoir 100 bonnes raisons de ne pas avoir d’enfant et, un jour, une seule bonne raison qui vient toutes les balayer.» Ainsi, si les grossesses adolescentaires sont souvent traitées comme un «risque» à prévenir, qui peut dire si «la» bonne raison de ces jeunes filles ne vaut pas celle des autres? «Une chose est sûre, les jeunes mères ne sont pas de moins bonnes mères», affirment Latifa Ameluan et Valérie Vancalemont. «Sur le continent africain, il est normal d’avoir un enfant avant 20 ans, souligne par ailleurs Jacques Marquet. Parler de grossesse adolescente, c’est donc très relatif.»
«Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un glissement progressif de ‘l’enfant que l’on a’ à ‘l’enfant que l’on fait’», commente Aurore François, professeure d’histoire à l’UCLouvain et spécialiste de l’enfance et de la protection de la jeunesse. Avec l’avènement de la contraception et de l’enfant conçu comme «projet», l’âge moyen de la première grossesse s’est progressivement décalé: aujourd’hui, en Belgique, il est de 29 ans et davantage dans les couches les plus diplômées de la population. En ce sens, ces mères adolescentes, par ailleurs précaires et célibataires, contreviennent à tout ce qui est aujourd’hui socialement désirable en termes de parentalité.
Comme le rappelle Aurore François, au début du siècle précédent, il n’était pas rare que les jeunes filles qui tombaient enceintes hors mariage soient placées dans des institutions, souvent dirigées par des congrégations religieuses qui portaient un regard culpabilisateur sur la sexualité: l’accouchement était alors vécu comme la juste punition traumatisante du péché de chair. Progressivement, dès l’entre-deux-guerres, l’apparition des maisons maternelles allait infléchir la donne, par l’accompagnement et le soutien des mères, sans que la dimension moralisatrice s’efface pour autant. «La maternité continuait d’être vue comme le résultat d’une erreur, mais elle était en même temps salvatrice, comme une possibilité de réhabilitation sociale, toujours autour d’une vision assez essentialiste de la femme», commente l’historienne. De nos jours, les grossesses adolescentaires ne scandalisent plus comme stigmates d’une sexualité non autorisée. Mais elles continuent d’incarner avec insistance ce que la société préférerait cacher: les ambivalences de la maternité – projet ou acte manqué, désir profond ou seule issue, conséquence de l’amour ou de son absence, mal et remède.