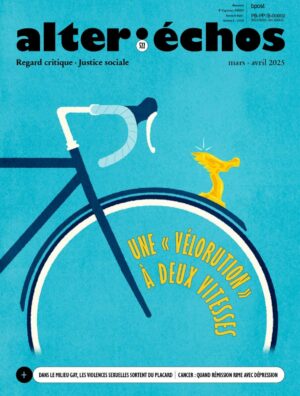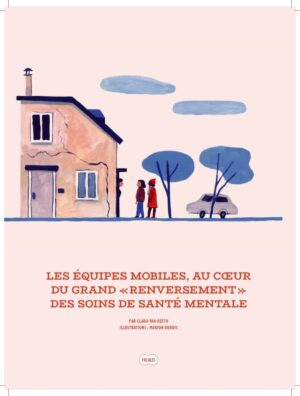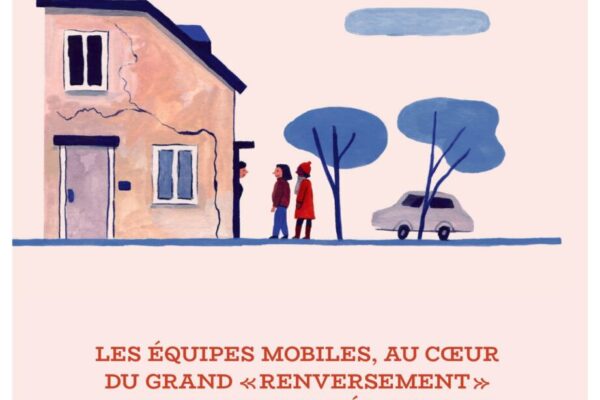C’est une découverte surprenante et troublante à laquelle a abouti une équipe de chercheurs d’Oxford. Dans une étude à paraître dans le prochain World happiness report 2025, ils ont identifié le premier prédicteur du vote pour Donald Trump. Et ce n’est pas le fait d’être un homme ou une femme, d’être blanc, noir ou latino, employé, indépendant ou sans emploi… Non, le facteur qui a le plus de chances de déterminer qu’une personne votera pour Donald Trump, c’est que cette personne dîne seule tous les soirs de la semaine. «Le niveau de solitude est le premier prédicteur de la défiance grandissante des citoyens, et de leur polarisation politique», appuie Yann Algan, professeur d’économie à HEC Paris, dans une tribune parue dans Les Échos.
Aux États-Unis, la proportion de personnes qui dînent seules tous les soirs de la semaine a doublé entre 2000 et 2023, passant de 15% à 30%. Un phénomène d’individualisation qui n’épargne pas les pays d’Europe de l’Ouest.
La solitude est aussi devenue un puissant marqueur d’inégalités, selon qu’elle est choisie ou non. Pour les plus privilégiés, elle est un luxe: celui de se mettre au vert, loin du bruit, de se «couper du monde». Celui d’assumer d’aller manger seul au restaurant. De se retrouver, de s’écouter. Autant de conseils qu’égrènent les nouveaux «gourous» du développement personnel et du bien-être.
Et puis il y a tous ceux qui la subissent, cette solitude. Les personnes âgées, isolées, exclues, séparées, abandonnées. Allez leur dire de profiter de ce «temps pour soi», elles qui n’ont que ça.
Selon les chiffres de Statbel (2022), 7,2% des Belges se sentent toujours seuls, ou la plupart du temps. Une étude menée par l’UGent la même année faisait état de 32% de la population belge se sentant «très seuls». Les deux études ont néanmoins en commun de préciser que la solitude concerne surtout les personnes âgées, mais aussi sans emploi, malades de longue durée et les familles monoparentales.
Ce constat est quasiment contre nature dans l’évolution de l’humain, animal grégaire par excellence. Tribus, clans, villages, familles: les groupes lui ont de tout temps permis, en s’appuyant sur d’étroites relations sociales, d’assurer sa survie d’abord, son essor ensuite.
Dès la fin du XIXe siècle, les hommes et femmes se sont rassemblés autour de visions communes, de grandes idéologies ou «piliers» (socialisme, libéralisme, catholicisme) et au sein de corps intermédiaires (syndicats, mutuelles, associations, collectifs…) – auxquels Alter Échos avait consacré le dossier de son 500e numéro, en février 2022. Ces corps intermédiaires ont longtemps structuré notre démocratie mais aussi nos relations sociales, notre participation au groupe. On les voit aujourd’hui en perte de vitesse, fragilisés par la révolution numérique et l’éclatement d’une société de plus en plus individualisée.
À cette «désocialisation», il faut ajouter d’autres phénomènes comme l’augmentation des divorces et le vieillissement de la population pour comprendre la propagation de la solitude.
À défaut de l’enrayer, rappelons l’importance de maintenir des sortes de filets de sécurité de sociabilité. Par exemple, en assurant la présence de personnel derrière les guichets d’administration, aux caisses des magasins. En maintenant le volume d’emploi des associations et services de première ligne. En favorisant la genèse de collectifs, d’initiatives citoyennes. Qui sont autant de visages, de mots échangés, voire de sourires, que peuvent espérer au cours d’une journée les personnes isolées.