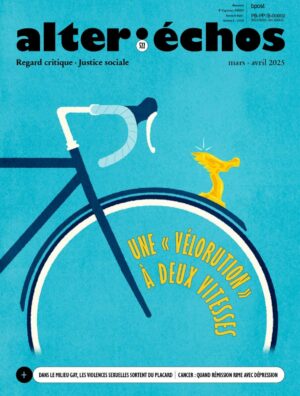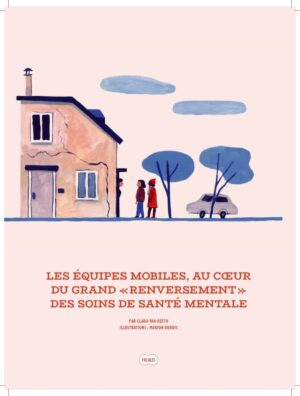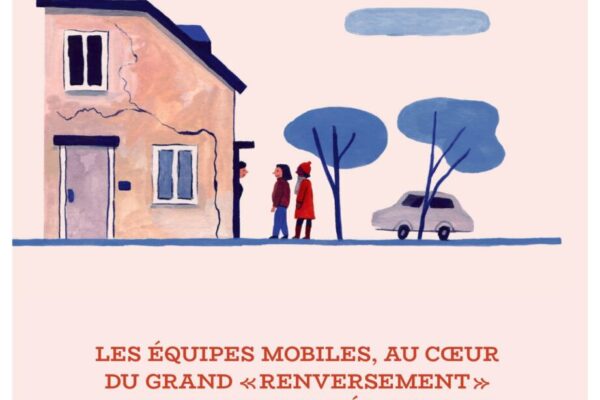On prend les mêmes et on recommence, ou presque. L’Allemande Ursula von der Leyen a réussi à conserver la présidence de la Commission européenne pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’à fin 2029. Cette conservatrice membre de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) outre-Rhin, aux méthodes de micro-management souvent décriées à Bruxelles, occupe un poste clef dans l’Union européenne (UE), car en détenant les rênes de l’exécutif européen, elle peut faire la pluie et le beau temps sur les politiques du Vieux Continent – en décidant de celles qui, selon elle, comptent vraiment. Or la «Commission VDL 2» («VDL» pour «von der Leyen», donc) semble bien plus intéressée par les enjeux de compétitivité que d’équité sociale.
Ce constat ne s’est pas imposé en un instant, non. Cette tendance de fond a pu s’observer depuis plusieurs mois, et alors qu’en ce début d’année 2025, la nouvelle Commission européenne entame ses travaux, rien ne l’empêcherait de renverser la vapeur. Il n’en reste pas moins que pour l’heure, les signaux favorables à l’approfondissement de l’Europe sociale se sont faits rares. Rembobinons. En juillet 2024, Ursula von der Leyen sait que la fin de son mandat est proche, mais l’ex-ministre fédérale du Travail et des Affaires sociales allemande (entre 2009 et 2013) n’a visiblement pas envie de raccrocher son tablier. En cinq ans à Bruxelles, elle a pris ses marques et a réussi quelques tours de force – comme parvenir à faire accepter par les États membres de l’UE et par le Parlement européen l’idée d’un endettement commun pour contrer la pandémie de Covid-19 ou ouvrir la voie à un soutien à l’Ukraine «en Européens», plutôt que pays par pays.
Ursula von der Leyen prend donc la décision de briguer un second mandat à la tête de la Commission européenne. Pour cela, il faut notamment convaincre le Parlement européen, renouvelé en juin dernier et qui rassemble actuellement 720 élus aux nationalités, couleurs politiques, mentalités et priorités variées. Ursula von der Leyen pond alors un programme de travail léché – 41 pages sur fond bleu, la couleur de l’Europe par excellence – dans lequel elle tente de démontrer qu’elle est toujours taillée pour le poste de présidente de la Commission.
Selon Ursula von der Leyen, il faut avant tout renforcer la compétitivité du Vieux Continent et miser énormément sur l’industrie – celle de la défense au premier chef, car la problématique de la sécurité de l’Europe est, elle aussi, absolument capitale à ses yeux.
Ces «orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029» donnent le ton: oui, l’Europe sera «sociale» ou ne sera pas, oui, il faut «assurer la justice sociale» (page 4), oui, il faut «soutenir les personnes et renforcer nos sociétés et notre modèle social» (page 23), évidemment, «nous nous attaquerons aux disparités régionales et sociales» (page 25) et, naturellement, l’accent sera mis sur «nos priorités communes, notamment la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale» (page 38).
It’s the economy, stupid!
Mais le message prioritaire d’Ursula von der Leyen est tout autre: selon elle, il faut avant tout renforcer la compétitivité du Vieux Continent, et miser énormément sur l’industrie – celle de la défense au premier chef, car la problématique de la sécurité de l’Europe est, elle aussi, absolument cruciale à ses yeux. En ménageant la chèvre et le chou (en d’autres termes, en s’adressant à tous les bords politiques dans l’hémicycle), Ursula von der Leyen a réussi à assurer sa réélection. Elle rassemble alors autour d’elle une vaste équipe de 26 vice-présidents et commissaires européens, chacun responsable d’un portefeuille spécifique (pour la Belgique, il s’agit de l’ex-ministre fédérale des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales Hadja Lahbib, qui hérite, entre autres, de l’aide humanitaire européenne).
Fin novembre, c’est la consécration: à Strasbourg, les députés européens approuvent le «collège des commissaires» tel qu’imaginé par Ursula von der Leyen – par 370 voix pour, 282 contre et 36 abstentions. Le score n’est pas mirobolant, mais suffit à permettre à la «Commission VDL 2» d’entrer en fonction, le 1er décembre dernier. S’adressant aux eurodéputés, Ursula von der Leyen ne le cache pas: «Notre liberté et notre souveraineté dépendent plus que jamais de notre puissance économique. Notre sécurité est tributaire de notre capacité à nous montrer compétitifs, à innover et à produire. Notre modèle social, quant à lui, a besoin d’une économie florissante dans un contexte de changements démographiques.» En clair dans le texte: «It’s the economy, stupid!» – ou l’économie, il n’y a que cela qui compte. Au grand dam de ceux qui, à Bruxelles, voudraient que l’accent soit davantage mis sur la composante sociale du projet européen.
Mains tendues vers la gauche
Certains députés européens, notamment, ne sont pas dupes: «L’ambition sociale ne sera pas au cœur du projet de la nouvelle Commission, et, pour nous, cela est un problème fondamental», regrette Raphaël Glucksmann, chef de file de la délégation française du groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D). Pour sa collègue écologiste Majdouline Sbai, «le modèle que défend Ursula von der Leyen n’est pas adapté: c’est un modèle qui fait augmenter les inégalités en Europe». Raphaël Glucksmann comme Majdouline Sbai ont voté contre l’entrée en fonction du collège, et ce, malgré les quelques mains tendues par Ursula von der Leyen en direction de la gauche de l’hémicycle.
«L’ambition sociale ne sera pas au cœur du projet de la nouvelle Commission, et, pour nous, cela est un problème fondamental.»
Raphaël Glucksmann, chef de file de la délégation française du groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D)
L’une des plus remarquées a consisté à nommer un commissaire responsable de l’énergie et du logement. C’est cette deuxième attribution – le logement – qui est novatrice: c’est en effet la première fois que ce portefeuille existe au sein du collège des commissaires. Il revient au Danois Dan Jørgensen, tandis que la Roumaine Roxana Mînzatu est en charge des «droits sociaux, des compétences, des emplois de qualité et de l’état de préparation». Au sein de la précédente Commission européenne, le Luxembourgeois Nicolas Schmit était responsable d’un portefeuille plus parlant, dédié à «l’emploi et aux droits sociaux». Dans la fiche de poste de Dan Jørgensen, l’on apprend notamment qu’il a «pour mission d’aider les États membres à s’attaquer aux causes profondes des problèmes d’offre de logements et à débloquer les investissements publics et privés en faveur de logements abordables et durables». Tout un programme.
Mais les premières annonces de la nouvelle Commission européenne ne vont pas dans ce sens-là: dès la mi-janvier, c’est sur une nouvelle stratégie concernant la compétitivité que l’institution a levé le voile, avant de mettre les bouchées doubles pour proposer de nouvelles mesures dans le domaine de l’agriculture, dès le mois de février, pour tenter de calmer la colère des paysans européens vis-à-vis de Bruxelles. Aucune échéance n’est en revanche donnée pour la présentation d’un éventuel plan en faveur des logements abordables et durables. Concrètement, les défenseurs d’une Europe sociale attendent notamment un réexamen complet des règles relatives aux aides d’État visant à permettre davantage d’investissements en matière de logement en Europe, de même qu’une nouvelle définition du logement qui affirmerait que celui-ci est un «service d’intérêt économique général».
Des leviers d’action manquants
Une enquête Eurobaromètre qui remonte à avril 2024 montre pourtant que «88% des citoyens européens considèrent qu’une Europe sociale est importante pour eux personnellement». D’après ce même sondage, ce sont surtout des avancées dans les domaines de soins de santé, des salaires et des revenus et pensions de vieillesse que les Européens attendent des initiatives concrètes de la part de Bruxelles. Mais l’Europe du «triple A social» que l’ex-président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker appelait de ses vœux dès 2014 n’a pas encore éclos.
En matière sociale, les États membres restent les premiers maîtres à bord, et les tensions observées durant les négociations de textes emblématiques comme les règles de l’UE relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale en disent long sur la complexité de l’ambition d’approfondir l’Europe sociale.
Le sujet de l’Europe sociale reste sensible, et Bruxelles a tendance à manquer de leviers d’action: en effet, en la matière, les États membres restent les premiers maîtres à bord, et les tensions observées durant les négociations de textes emblématiques comme la directive sur le travail détaché, le texte visant à équilibrer la vie professionnelle et la vie privée (en légiférant sur la durée minimum des congés parentaux et de paternité), les conditions d’emploi des travailleurs des plateformes ou les règles de l’UE relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale (qui n’ont au demeurant jamais fait l’objet d’un accord à l’échelon européen) en disent long sur la complexité de l’ambition d’approfondir l’Europe sociale. Car la compétence «sociale» reste avant tout entre les mains des capitales européennes. Et ces dernières n’ont aucune envie de lâcher du lest, redoutant notamment une forme d’uniformisation des modèles sociaux – qui, actuellement, diffèrent d’un pays à l’autre. Les longs débats autour des salaires minimums «adéquats» en Europe avaient par exemple grandement inquiété les pays scandinaves qui n’ont pas de salaires minimums en tant que tels, mais des systèmes reposant sur des conventions collectives négociées, branche par branche, entre les employeurs et les syndicats.
Résultat: à Bruxelles, les effets d’annonce se multiplient, sans toujours parvenir à des avancées concrètes. Pourtant, comme le rappelle dans une tribune l’économiste Bruno Coquet, la «finalité sociale» du projet européen est inscrite noir sur blanc dès «les premières pages du traité de Rome», qui mentionne la nécessité d’«assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l’Europe» et assigne «pour but essentiel […] l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples». Près de 70 ans plus tard, Ursula von der Leyen pourrait être bien avisée de ressortir ce traité de ses tiroirs.