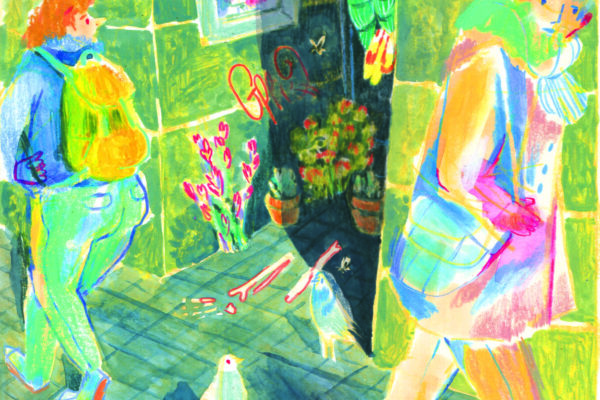Quand il s’agit d’indigence, le principe de base repose sur l’inhumation de la dépouille au cimetière communal dans un emplacement non concédé – c’est-à-dire en pelouse ordinaire – et ce pour une durée minimale de cinq ans. Les indigents ne peuvent donc pas être incinérés sauf s’ils l’ont spécifié aux autorités. En effet, chaque citoyen inscrit à l’état civil a le droit de déposer gratuitement ses dernières volontés auprès de sa commune, et ce peu importe son âge et/ou son état de santé. Les choix sont alors gardés précieusement dans le Registre national.
Problème, la mort demeurant taboue dans notre société, dans les faits, peu de gens connaissent ce droit. Et surtout, quid des personnes qui ne sont pas en règle administrative ou dont le système ne tient pas compte, comme les sans-papiers? Pour pallier ces inégalités, le collectif Morts de la rue distribue des carnets de volonté auprès de son public. «Nous œuvrons à sensibiliser les gens de la rue à ces questions et militons pour la reconnaissance de ce carnet auprès des autorités. Aussi, il faut savoir que les indigents sont enterrés dans la commune où ils meurent, pas dans celle où ils vivent, donc si quelqu’un décède à l’hôpital au fin fond d’Anderlecht alors que son réseau se trouve à Ixelles, eh bien, ça va le rendre encore plus esseulé… Pour ça aussi on essaye de faire bouger les lignes», éclaire Florence Servais.
Problème, la mort demeurant taboue dans notre société, dans les faits, peu de gens connaissent ce droit. Et surtout, quid des personnes qui ne sont pas en règle administrative ou dont le système ne tient pas compte, comme les sans-papiers?
Le collectif a dû militer pendant des années pour que toutes les communes indiquent le nom des personnes sur les tombes indigentes. «Et on demande que ce soit un système qui tienne pour que les proches de la personne puissent venir se recueillir. Il y a une idée reçue qui veut que les gens de la rue ne créent pas de liens, mais c’est faux!»
Repenser le rôle du politique
Place de l’Albertine, Bruxelles. Quelques personnes sont rassemblées autour d’un cerisier planté par le collectif des Morts de la rue. En ce 6 septembre, on célèbre Momo, 38 ans, décédé il y a un an. Sur l’écran d’un ordinateur, une vidéo affiche son visage en grand; lumineux, le jeune homme chante en play-back Oh Happy Day. Autour de la machine, certains pleurent, d’autres prennent la parole pour un hommage improvisé. «Tu étais comme mon frère, souffle une jeune femme. Nous sommes ensemble pour te dire au revoir, Momo.» À côté de la sono, Cléo Duponcheel reste discrète. Cette membre du collectif est entrepreneure de pompes funèbres depuis une dizaine d’années. C’est par conviction qu’elle a décidé de s’engager bénévolement. «Comme c’est mon métier, je peux parfois régler certains problèmes logistiques ou débloquer des situations auprès des autorités. La mort, elle est injuste aujourd’hui. Je trouve que l’État ne prend pas ses responsabilités. C’est un peu facile de dire ‘les vilains pauvres’, mais qui les met dans cette situation-là? Les funérailles d’indigents, je n’appelle pas ça des funérailles, c’est un acte technique; on met le corps dans une boîte et la boîte dans un trou, c’est tout.»
En France, le Collectif pour une sécurité sociale de la mort invite à repenser le modèle à travers des entreprises de pompes funèbres conventionnées.
De plus en plus de voix s’élèvent pour tenter d’imaginer les choses autrement. En France, le Collectif pour une sécurité sociale de la mort invite à repenser le modèle à travers des entreprises de pompes funèbres conventionnées. «C’est facile de demander à quelqu’un toute sa vie de payer des impôts et après de lui dire de se débrouiller. Je pense aussi que l’État devrait assurer un service minimal à tous, et après à chacun de choisir des options supplémentaires. Avant, la mort était gérée par le collectif, c’est la professionnalisation du métier qui en a fait un business», avance Cléo Duponcheel.