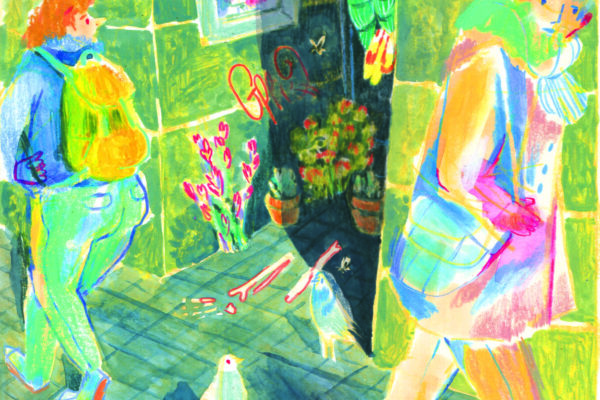Parmi les témoignages recueillis, l’incertitude quant à la date d’inhumation revient très régulièrement. Les services décès des communes s’organisent en fonction de leur agenda, de celui des employés du cimetière et du service de pompes funèbres mandaté. Parfois, les proches sont prévenus, parfois pas, c’est au cas par cas. Elodie Francart a longuement travaillé dans le secteur du sans-abrisme. En matière d’injustices administratives face à la mort, dans sa mémoire, une histoire est gravée à jamais. «C’était en 2019. Marcelle et Luc vivaient ensemble. Ils se sont fait expulser de leur logement. Durant leur première nuit de retour à la rue, Marcelle est tombée d’un banc et s’est brisé le crâne. Une ambulance est arrivée et l’a emportée. Voyant partir sa compagne, sous le choc, Luc a fait une crise d’épilepsie.»
L’homme est alors emmené dans un autre hôpital de l’autre côté de la ville. Le couple n’étant pas officiellement marié, personne ne prévient Luc de l’état de Marcelle entre-temps plongée dans le coma. Alertée par deux de leurs amis de la rue, Élodie Francart saisit l’urgence de la situation. Elle prend contact avec les deux hôpitaux, apprend que le pronostic de Marcelle se révèle très critique. «Luc était très angoissé. Je suis allée le chercher à l’hôpital, nous sommes partis ensemble pour aller la voir. Peu de temps après notre arrivée, Marcelle est morte devant nous. Luc ne pouvait pas le croire, il secouait son corps. Le personnel soignant nous a demandé de quitter les lieux, je leur ai laissé mon numéro en insistant pour être mise au courant de la date des obsèques en leur disant que j’assurerais le lien.»
Les services décès des communes s’organisent en fonction de leur agenda, de celui des employés du cimetière et du service de pompes funèbres mandaté. Parfois, les proches sont prévenus, parfois pas, c’est au cas par cas.
Sans nouvelles depuis plusieurs jours, Élodie Francart rappelle l’hôpital. À l’autre bout du fil, on lui annonce que la commune a enterré Marcelle la veille. «Luc n’a pas pu lui dire au revoir. Pendant des mois, il a continué de la chercher partout. Pour lui, elle ne pouvait pas être morte. Moi, j’ai vécu cette situation comme une véritable violence. C’est comme si personne n’en avait rien à faire de cette femme, de qui elle était, de ce qu’elle avait à raconter. Tout ça parce qu’elle venait de la rue. Ça m’a profondément révoltée.»
Loin de relever de l’anecdote, l’histoire de Marcelle et Luc témoigne d’une réalité systémique. «Si quelqu’un nous demande d’être tenu au courant du jour et de l’heure des funérailles, on le fait, mais c’est vrai que ça peut prendre du temps. Alors j’imagine que certains fonctionnaires estiment que ce n’est pas leur travail; nous, à l’administration, on ne connaît pas le passé des gens. Il faut aussi savoir que certaines pompes funèbres font leur job avec beaucoup d’éthique, tandis que pour d’autres c’est juste un business, et plus vite ils procèdent aux enterrements des indigents, mieux ils se portent», confirme anonymement un employé du service décès d’une commune bruxelloise.
«Le carré des indigents»
Septembre 2023, gare de Charleroi. Denis Uvier pointe le doigt vers le pont: «C’est ici dessous que j’ai trouvé le corps d’un sans-abri en faisant une tournée il y a quelques années. Ce jour-là, la presse a été alertée, ça a fait un ramdam pas possible et réveillé les consciences; après on ne pouvait plus faire comme si on ne savait pas.» Cet ancien SDF devenu travailleur social œuvre depuis des années à la reconnaissance des morts de la rue. Passeur d’âmes, il accompagne les sans-ressources pour leur dernier voyage. «Souvent, on apprend la mort des sans-abri par le bouche-à-oreille, mais parfois on découvre qu’ils sont décédés beaucoup plus tard, qu’ils sont partis sans un au revoir. Pour moi, ça, c’est vraiment difficile à accepter. C’est la précarité qui tue! La semaine prochaine, je vais à l’enterrement de Jordy, un gamin de la rue, même pas 35 ans. Saleté de vie.»
Il nous emmène au cimetière de Soleilmont à Fleurus. À quelques pas de la porte d’entrée, vers la gauche, «le carré des indigents». «Quand on les enterre, des fois, il y a quelques personnes, des fois, il n’y a que nous», murmure un fossoyeur occupé à laver ses outils. Ici, pas de stèles ni de pierres tombales, mais des tas de terre, des petits T et des croix en bois sur lesquelles sont collés des noms sur une plaque en plastique, ou juste des numéros, c’est selon. Denis Uvier fait le tour des tombes, ramasse un plastique ici, redresse une plante là. «Certaines plaques ont été arrachées, c’est peut-être le vent… C’est dommage, on ne peut pas savoir qui est qui. Aux yeux de l’État, ils étaient invisibles de leur vivant, et les voilà invisibles dans la mort. T’imagines, tu arrives au cimetière et le gardien te dit que ton frère, c’est le numéro 45 de l’allée 10. Elle est où l’humanité là-dedans?»
Ici, pas de stèles ni de pierres tombales, mais des tas de terre, des petits T et des croix en bois sur lesquelles sont collés des noms sur une plaque en plastique, ou juste des numéros, c’est selon.
Lui et quelques camarades sont à la base du collectif carolo des Morts de la rue, aujourd’hui coordonné par le Relais social de Charleroi. «On organise une déambulation dans la ville une fois par an pour amener le sujet dans le débat public, explique Arthur Mertens, chargé de projet. On tient un listing. La commune ne nous prévient pas systématiquement du moment des funérailles, mais on arrive à être au courant d’une manière ou d’une autre et on essaye d’y assister à chaque fois.»
Denis Uvier insiste sur le prix exorbitant de la gestion de la mort. En effet, un enterrement classique même en version low cost coûte en moyenne 2.500 euros. «C’est énorme pour quelqu’un de précaire! Moi j’ai connu des gens qui se sont endettés pour enterrer un copain histoire qu’il ne parte pas comme indigent. Franchement, quand tu as juste une mini-pension et que t’es dans un logement social, comment veux-tu?»