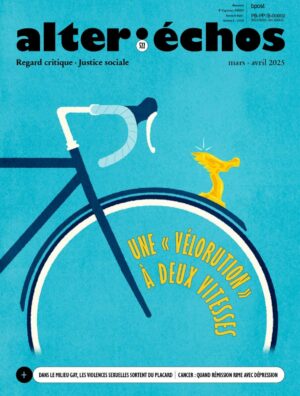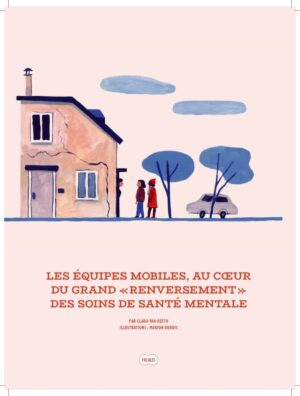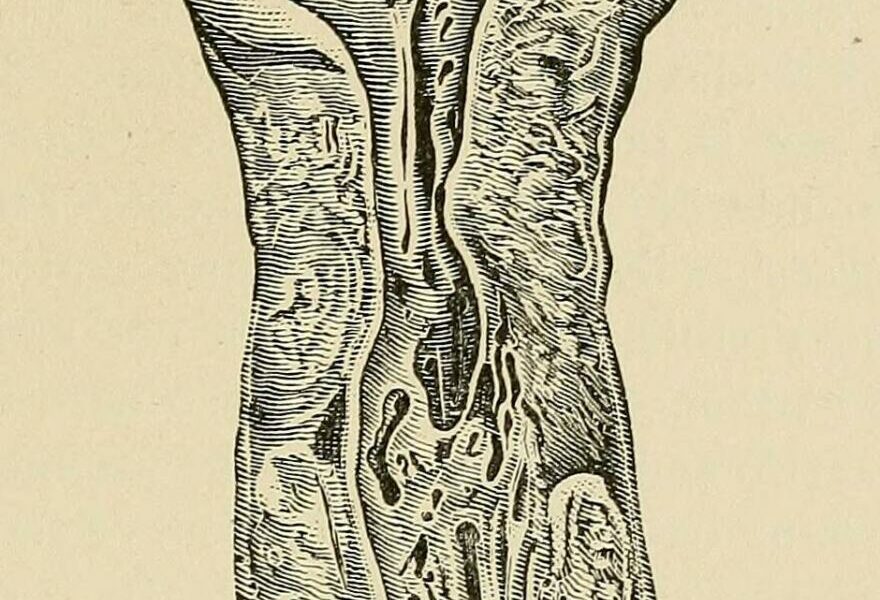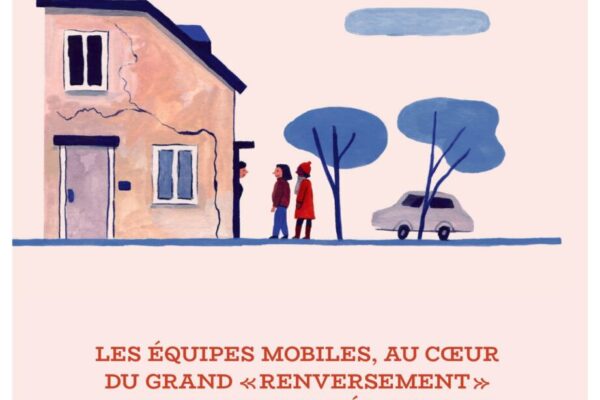Les diagnostics d’infections sexuellement transmissibles (IST) sont en augmentation en Belgique. Il suffit de jeter un œil au dernier rapport de surveillance des IST de Sciensano, évaluant la situation épidémiologique de 2023: les tendances générales des trois IST étudiées dans ce rapport sont à la hausse depuis plusieurs années. En comparaison avec les chiffres de 2019, ça donne une augmentation de 21% pour la chlamydia, 99% pour la gonorrhée et 13% pour la syphilis. Quant au VIH, si la tendance des nouveaux diagnostics reste à la baisse au cours de la dernière décennie, de nouvelles infections se déclarent encore chaque année. En 2022, 597 nouveaux diagnostics de VIH ont été enregistrés en Belgique.
S’ils ne font pas partie des catégories d’âge les plus touchées par les IST, les «50 ans et plus» ne sont pas pour autant épargnés par cette tendance à la hausse des diagnostics d’IST. Une situation d’autant plus interpellante que l’âge est un facteur de risque d’IST: certains changements liés au vieillissement augmentent le risque d’infection. Et en cas de diagnostic tardif, les conséquences sur la santé de la personne âgée atteinte d’une IST se révèlent plus importantes.
Pas concernés
«On a tendance à expliquer la hausse générale des diagnostics d’IST par le nombre de dépistages réalisés, en augmentation lui aussi. Mais ce n’est pas tout…, lance d’emblée Thierry Martin, directeur de la Plateforme Prévention Sida. Le fait est que les gens, tous âges confondus, continuent à prendre des risques.» Et du côté des seniors, on y pense peu, aux IST: «On constate que les adultes, bien plus que les jeunes, ne se sentent pas concernés par les IST. Il y a un sentiment de protection naturelle du public plus âgé, comme si ça n’allait pas les atteindre.» Par conséquent, les 50 ans et plus, comme le reste de la population, ont tendance à bouder le préservatif.
En comparaison avec les chiffres de 2019, ça donne une augmentation de 21% pour la chlamydia, 99% pour la gonorrhée et 13% pour la syphilis. Quant au VIH, si la tendance des nouveaux diagnostics reste à la baisse au cours de la dernière décennie, de nouvelles infections se déclarent encore chaque année. En 2022, 597 nouveaux diagnostics de VIH ont été enregistrés en Belgique.
D’autant que les seniors n’ont pas grandi avec la capote en poche. «C’est une génération qui, jeune, n’a pas été sensibilisée aux IST comme nos jeunes le sont aujourd’hui», lance Sandrine Cesaretti, chargée de projets Éducation permanente chez Liages (ex-Espace Seniors). Cette association de défense des droits des personnes de 50 ans et plus a développé des campagnes autour de la sexualité des aînés. L’occasion de se pencher sur la problématique des IST chez les seniors et de déconstruire certaines idées reçues auprès de ce public: «Ça vaut pour tous les âges, mais le préservatif est souvent perçu comme quelque chose qui va casser le moment. Par ailleurs, certains hommes, qui rencontrent parfois des troubles de l’érection avec l’âge, refusent de l’utiliser. Ce qu’on entend aussi, c’est que les femmes ménopausées n’auraient plus besoin d’utiliser un préservatif, car les risques de grossesse sont écartés. Il y a encore l’idée selon laquelle les personnes atteintes d’IST sont forcément volages, droguées ou homosexuelles et donc ‘ça ne me concerne pas’. Beaucoup d’idées erronées circulent et la prévention des IST n’est pas du tout ancrée chez les seniors.» Ce qui n’est pas sans conséquence… Ne se considérant pas «à risque» ou étant rarement considérés comme tels par les professionnels de la santé, certains seniors «ne se font pas dépister et n’entrent donc dans aucune statistique», souligne encore Liages dans une brochure consacrée aux IST chez les seniors.
Évolutions… et tabou du sexe
Les évolutions sociétales pourraient aussi avoir une incidence sur l’augmentation des IST chez les 50+. Aujourd’hui, on se sépare ou on divorce plus qu’avant. Et on refait sa vie aussi, peu importe l’âge qu’on a. C’est davantage accepté socialement qu’à l’époque de nos grands-parents. «Les temps changent, poursuit Sandrine Cesaretti. Les couples se font et se défont. Et il y a aussi plus de possibilités de se rencontrer.» Les plus de 50 ans sont donc davantage enclins à rencontrer d’autres partenaires et à s’exposer à certains risques.
Si les mœurs évoluent, il est des tabous qui ont la vie dure. Et la sexualité des seniors en est un qui joue un rôle dans la prévention des IST. Ne pas parler des relations sexuelles que pourraient avoir les seniors, c’est invisibiliser les risques. Yagos Koliopanos est sociologue et responsable de la recherche «VIH et vieillissement» au sein de l’Observatoire du sida et des sexualités. Il évoque «ce poids de la désexualisation des personnes à partir d’un certain âge» et souligne les normes sociétales qui en découlent: «Baiser quand on est fripé, c’est une transgression, ce n’est pas ‘normal’ dans le regard sociétal. À cela s’ajoute une forme d’autocensure des seniors eux-mêmes, qui diront qu’ils ont ‘dépassé l’âge’ ou qui feront tout pour avoir l’air plus jeunes.»
Du côté de l’asbl Liages, on constate des évolutions, toutes proportions gardées: «Les seniors osent davantage qu’avant parler de leur sexualité. Les professionnels de la santé en sont davantage conscients, remarque Sandrine Cesaretti. Mais au niveau sociétal, la sexualité reste très certainement l’apanage des jeunes. Des normes pèsent encore. On préfère véhiculer l’image de la sexualité des ‘vieux beaux’.»
Des préservatifs en maisons de repos?
«La sexualité des personnes âgées étant un tabou dans notre société, faire de la distribution de préservatifs dans les maisons de repos, ça ne va pas de soi. Il y a des résistances», constate Thierry Martin, de la Plateforme Prévention Sida. Tout comme proposer un dépistage IST aux résidents est encore loin de faire partie des réflexes du corps médical et du personnel de soin. Dans l’imaginaire collectif, les personnes d’un âge plus avancé et en perte d’autonomie sont souvent considérées comme dépourvues de désirs sexuels ou incapables physiquement de faire des galipettes.
Les évolutions sociétales pourraient aussi avoir une incidence sur l’augmentation des IST chez les 50+. Aujourd’hui, on se sépare ou on divorce plus qu’avant. Et on refait sa vie aussi, peu importe l’âge qu’on a.
«Les maisons de repos sont encore trop souvent vues comme des mouroirs, alors que ce sont des lieux de vie, notamment de vie intime, souligne Sandrine Cesaretti de Liages. Un travail de longue haleine doit être réalisé pour déconstruire les idées reçues en ces lieux et auprès du personnel.» Liages a rencontré plusieurs équipes travaillant en maisons de repos, lors de journées de sensibilisation sur la sexualité des aînés. «Ça bouge un peu dans les institutions, surtout quand ‘quelque chose’ se passe, parce que personne ne sait comment faire et comment aborder les questions de sexualité. C’est en amont qu’il faudrait sensibiliser et agir.»
Accompagner les personnes
Il y a quelques années d’ici, à Ixelles, la Résidence Malibran a accueilli une personne vivant avec le VIH. La Plateforme Prévention Sida a été sollicitée par cette maison de repos afin de sensibiliser son personnel. Gwendoline Oger, assistante sociale à la Résidence Malibran, revient sur cette expérience: «Ça a permis d’apaiser les peurs des membres du personnel et de leur fournir une information fiable. Mais on ne peut pas dire qu’une dynamique d’accompagnement ou des actions de prévention en matière d’IST se soient installées dans notre institution pour autant.» Car ici comme ailleurs, dans l’équation, il y a aussi le manque de moyens, de temps et de personnel formé à ces questions… La prévention des IST et l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes figurent rarement en haut de la liste des urgences.
Pourtant, dans le cas du VIH, l’accompagnement dépasse l’unique prise en charge médicale: «Il y a encore beaucoup de peurs, de préjugés et donc de discriminations vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Les maisons de repos et de soins n’en sont pas épargnées, souligne Thierry Martin. Il faut agir sur ces discriminations tout en entendant les réalités de travail du personnel. Des solutions et des outils adaptés existent, mais souvent les travailleurs n’en ont pas conscience.»
Axel Vanderperre, d’Utopia_Bxl, une association œuvrant pour la santé des personnes LGBT de 50 ans et plus vivant avec le VIH, va un pas plus loin: «Ça prend du temps de motiver les directions des maisons de repos et les associations n’ont pas les moyens financiers et humains de tout changer. Il faut aussi faire de l’approche descendante (top down), pour qu’au niveau politique tout soit mis en œuvre afin que les formations de base des professionnels intègrent ces enjeux.»
Vivant avec le VIH depuis 35 ans, Axel Vanderperre plaide pour une adaptation des modèles de soins aux personnes vieillissant avec le VIH, de plus en plus nombreuses. L’arrivée de la trithérapie a en effet augmenté l’espérance de vie avec le VIH. En Belgique, les 50 ans et plus représentent désormais 47% des personnes VIH (contre 19% en 2006), soit environ 18.000 personnes. «L’espérance de vie a augmenté, mais pas la qualité de vie», lance Axel Vanderperre, qui pointe les mécanismes de vieillissement prématuré: «Les personnes VIH ont plus de risques de rencontrer des problèmes de santé liés à l’âge: hypertension, diabète, cancer, problèmes cardiovasculaires, neurologiques… Les risques de comorbidités sont plus fréquents et plus précoces.» À cela s’ajoutent les retombées sur la santé mentale, l’isolement… «C’est un fait nouveau que les personnes vivant avec le VIH vieillissent, souligne le sociologue Yagos Koliopanos. La question est de savoir comment elles vivent, quelle est leur qualité de vie.» Et, en filigrane, comment les accompagner.
Besoin de campagnes adaptées
Quant aux campagnes de sensibilisation destinées aux 50 ans et plus, elles ne se bousculent pas au portillon. Du côté de la Plateforme Prévention Sida, on s’en explique: «Dans toutes nos campagnes, on essaie d’avoir une diversité: hommes, femmes, LGBT, origines, âges… Adapter sa stratégie de communication pour mieux coller aux réalités de cette tranche d’âge, c’est certainement nécessaire. Mais toucher différents publics avec leurs spécificités, cela demande du temps et des moyens.»
Vivant avec le VIH depuis 35 ans, Axel Vanderperre plaide pour une adaptation des modèles de soins aux personnes vieillissant avec le VIH, de plus en plus nombreuses. L’arrivée de la trithérapie a en effet augmenté l’espérance de vie avec le VIH. En Belgique, les 50 ans et plus représentent désormais 47% des personnes VIH (contre 19% en 2006), soit environ 18.000 personnes.
Cela demande aussi de savoir où trouver ce public, poursuit Thierry Martin: «Pour sensibiliser les jeunes, on passe par les écoles, universités, mouvements de jeunesse, réseaux sociaux… On a plus de difficultés à atteindre les plus âgés.» D’autant que la catégorie «seniors» englobe un public très large. «50 ans et plus, c’est une fameuse fourchette, souligne Sandrine Cesaretti. Les situations sont très différentes qu’on ait 50 ou 80 ans. Et, à l’image de l’ensemble de la population, tous les seniors ne sont pas pareils. On a trop tendance à généraliser ce public.»
Pour le sociologue de l’Observatoire du sida et des sexualités, «ces campagnes sont certainement à réfléchir avec les personnes concernées, donc les personnes âgées. Et à penser en regard des normes qui traversent notre société». Sortir des clichés du vieux beau, refléter davantage la réalité, partir des besoins et envies des seniors, aller à leur rencontre dans les espaces qu’ils côtoient et, conclut Sandrine Cesaretti: «Faire en sorte que l’image que l’on donne de la vieillesse et de la sexualité des aînés soit plus positive.»